TROISIEME PARTIE VERS UNE REDEFINITION DU ROMAN NOIR EN TANT QUE GENRE.
Notre hypothèse est que le trait commun à l’ensemble des romans du corpus est lié à des fonctions et des visées assignées au roman noir. Alain Viala signale d’ailleurs que « les genres (…) dérivent d’une fonction dévolue au texte, d’une finalitéNote657. . » Il construit à partir de ce constat la notion de registre, sur laquelle nous reviendrons, tant elle nous semble nécessaire pour définir le roman noir. Néanmoins, l’une des fonctions du roman noir ne nous semble pas ressortir à la notion de registre, mais plutôt à une finalité, qui serait de proposer des interrogations au lecteur et de répondre, éventuellement, à ces interrogations. Ainsi, le roman noir serait une fiction à visée heuristique (au sens large de « qui sert à la découverte »), selon diverses nuances qui vont de la simple observation au discours critique et démystificateur, voire militant. À ce titre, il peut être saisi comme texte littéraire réaliste, dont l’ambition est, comme le souligne Lorenzo Bonoli dans son article « Ecritures de la réalité », de fournir une représentation de la réalité, conformément à :
l’idée d’un mode d’écriture fictionnelle visant à transcender sa fictionalité pour se donner comme une description de la réalité (…)Note658. .
Le premier chapitre tentera de définir les modalités et les enjeux du roman noir en tant que texte réaliste. Fiction de la connaissance, le roman noir tente, en héritier des Réalistes et des Naturalistes du 19ème siècle, d’explorer la réalité contemporaine dans toutes ses facettes, sans barrière ni interdit. À cette amplitude « horizontale », le roman noir superpose une vision en coupe, s’assignant comme visée non pas seulement la connaissance totalisante via le témoignage et l’observation, mais bien plus la plongée dans l’au-delà des apparences, dans un mouvement « vertical » de dévoilement, de décryptage, de démystification. Les centres d’intérêt se sont en partie déplacés depuis le 19ème siècle, ou ont accentué tel sujet de préoccupation ; là où les Réalistes et les Naturalistes exploraient les turpitudes sexuelles, le roman noir de cette fin du 20ème siècle va plus encore que Zola ou Balzac explorer les aspects sociaux, car comme le dit Pierre Bourdieu, « l’inavouable n’est plus aujourd’hui le sexuel, mais le socialNote659. ». Les romans noirs prennent d’ailleurs à contre-pied le constat de Jacques Dubois sur les romanciers du réel, qui selon lui font « montre de prudence, veillant à ne pas aborder la problématique sociale trop frontalement et choisissant d’en euphémiser la violence en la croisant avec d’autres élémentsNote660. . » Développer la question de ces enjeux et fonctions du réalisme dans le roman noir amènera à proposer une analyse des modalités de la représentation réaliste saillantes dans le genre : choix de sujets et travail sur l’effet de réel, cohérence et vraisemblance, choix narratologiques retiendront particulièrement notre attention. Mais tous les romans du corpus ne s’alignent pas sous la bannière d’un réalisme uniforme, et l’on peut distinguer entre plusieurs postures réalistes, dépendantes des finalités assignées au réalisme. Plus que par une écriture réaliste, le roman noir se définit par une écriture sociale, ou du social, qui cherche à saisir les enjeux collectifs par le prisme de l’individualité et de la singularité. Ce projet est souvent mis au service d’un réalisme critique, et peut aller jusqu’à une forme d’engagement, sinon de militantisme. Fresque sociale totalisante, le roman noir est aussi une entreprise de démystification, qui peut porter sur les institutions sociales, politiques, sur les enjeux idéologiques de la mémoire historique. Sans être un acte militant, le roman noir est, chez nombre d’auteurs, une parole engagée ou un relais à l’action et à l’engagement directs.
Mais cette écriture réaliste n’est pas sans poser de problèmes et présenter d’ambiguïtés, car derrière la volonté de démystifier le réel, de prendre le contre-pied de la pensée et l’action communes, se cache parfois une nouvelle doxa, une doxa « polareuse », pourrait-on dire, qui a à voir avec les enjeux du réalisme, souvent adossé à un déjà-dit prévisible et redondant, fût-il propre au roman noir. En outre, une écriture réaliste est-elle encore possible, quand le Nouveau Roman en a dit l’inanité ? Le roman noir parvient-il à sortir de l’impasse de l’écriture réaliste, laquelle, déjà à la fin du 19ème siècle, s’épuisait à dire et à lire un réel complexe, voire opaque ? Les choix mêmes de l’écriture réaliste opérés par le roman noir des années 1990-2000 semblent postuler cette impossibilité. Enfin, avec la critique formaliste et la linguistique, l’écriture réaliste n’a-t-elle pas été envisagée comme un leurre, une impossibilité liée à l’essence même du langage et de la littérature ? Le roman noir est avant tout une fiction réaliste, qui met au service de son projet tous les artifices de la fiction.
Ainsi, il s’affirme en tant que fiction paradoxale. Il ne cesse de mettre en avant son ancrage référentiel, à tel point que l’effet de fiction est parfois suspendu au moment de la réception. Le deuxième chapitre s’efforcera d’explorer les modalités spécifiques de la fictionalité dans le roman noir. La fictionalité n’est en effet pas une option de lecture, elle est inscrite dans le texte même, et elle est liée dans ce cas précis à la notion de genre. À la référence au réel se substitue une référentialité générique, le texte étant avant tout inscrit dans une relation aux stéréotypes génériques. Or, c’est probablement ce qui entraîne, dans certains cas, la suspension de l’effet de fiction : la dissémination générique qui caractérise le genre dans les années 1990-2000 tend à estomper les indices de fictionalité liés à la généricité ; à cela s’ajoute le choix d’une écriture réaliste. Ainsi, le roman noir tel qu’il est représenté dans notre corpus se donne comme une fiction paradoxale, occupant à certains égards un espace de transition entre le factuel et le fictionnel. Plus qu’une exploration du monde réel par ancrage référentiel, le genre retrouve sa fonction heuristique en construisant des mondes fictionnels qui sont autant de constructions de mondes possibles, à la fois regard sur le monde réel et reconstruction de ce monde réel. Les analyses de Paul Ricoeur sur la fiction nous aideront à le démontrer.
Cette notion de regard, de construction de monde possible permet d’envisager l’autre grande fonction du roman noir, qui est de proposer une vision tragique du monde et de l’homme. Ainsi que nous le verrons dans le chapitre trois, le genre est donc indissociable de la notion de registre, telle qu’elle a été définie par Alain VialaNote661. .
Le registre dominant semble bien être le registre tragique. Il l’est d’abord parce que le roman noir réactualise des motifs du tragique, par des choix thématiques, des « types » de personnages, des choix narratifs, par la redéfinition d’un fatum tragique lié à des déterminations sociales et psychologiques. Il l’est surtout parce qu’il est lié à l’angoisse face à la souffrance inéluctable inscrite dans toute existence humaine. Mais il faut ici apporter une nuance à cette saisie du roman noir comme roman tragique. En effet, sous les effets conjugués de l’impossibilité d’une écriture réaliste permettant de produire du sens et de la dissémination générique qui se traduit en écriture dysphorique (au niveau de la structure et du personnel romanesque), on peut se demander si le roman noir n’exprime pas plutôt l’impossibilité du tragique dans notre société et à notre époque. On pourra alors se hasarder à cette hypothèse : le genre « roman noir » ne se dissoudrait-il pas en registre noir, apte d’ailleurs à ce titre à s’éparpiller à la fois dans d’autres genres (hybridité générique) et dans la littérature blanche et d’avant-garde ?
Enfin, à la lueur de ces trois axes fondamentaux, nous tenterons dans un quatrième et dernier chapitre un retour sur le corpus, qui nous permettra notamment d’envisager les romans qui sont des cas-limites, en ce sens qu’ils actualisent certains des traits génériques fondamentaux mais délaissent au moins l’un des deux axes qui nous semblent centraux dans le roman noir, l’écriture réaliste ou l’écriture tragique et désenchantée.
CHAPITRE UN. UN ROMAN REALISTE.
La notion de réalisme appelle quelques précisions, car le terme est polysémique. Le dictionnaireNote662. indique entre autres significations possibles celle de « conception de l’art, de la littérature, selon laquelle l’artiste ne doit pas chercher à idéaliser le réel ou à en donner une image épurée », incarnée notamment par une école littéraire française qui, vers le milieu du 19ème siècle, « préconisa la description minutieuse et objective des faits et des personnages de la réalité banale et quotidienne ». Deux acceptions sont ici liées, l’une historique et l’autre trans-historique. Le réalisme, dans un sens général, manifeste la volonté de représenter le réel avec fidélité, conformément à la mimesis aristotélicienne. Cette tendance va s’illustrer avec plus ou moins de force tout au long de l’histoire de la littérature occidentale, être au fondement de l’esthétique classique en France, et finira, comme le souligne Henri Mitterand, « par coïncider avec [la question] d’un genre : le romanNote663. ». Le terme désigne également un mouvement littéraire (et artistique) du 19ème siècle. Les deux acceptions sont bien sûr liées, et Erich Auerbach a démontré dans son essai MimesisNote664. que l’ensemble de la littérature occidentale se caractérise par l’émergence et l’approfondissement du réalisme, et que celui-ci trouve son apogée au 19ème siècle, à travers les mouvements réaliste et naturaliste. Il dépasse ainsi l’opposition entre sens historique et sens trans-historique, et propose de définir l’œuvre réaliste comme une œuvre sérieuse – qui est portée par un programme, un projet –, mêlant les registres stylistiques, qui n’exclut la description d’aucune classe ni d’aucun milieu, et qui intègre l’histoire des personnages dans le cours de l’Histoire. Ces traits s’appliquent très largement aux œuvres de notre corpus. Notre hypothèse est donc que le roman noir est un genre réaliste, caractérisé par l’ambition de représenter la réalité, à l’aide de différentes techniques littéraires. Dans son projet comme dans sa réalisation textuelle, le roman noir va à la fois reprendre des traits de la littérature réaliste dans son ensemble et se poser comme l’héritier de la littérature réaliste et naturaliste du 19ème siècle. C’est pourquoi nous reprenons la définition du texte littéraire réaliste proposée par Lorenzo Bonoli :
Le terme de réalisme est employé ici en référence à un style d’écriture particulier qui se présente comme une tentative littéraire de représenter la réalitéNote665. .
Pour reprendre les termes de Susan Rubin Suleiman à propos du roman réaliste dans son ensemble, le roman noir, « fondé sur une esthétique du vraisemblable et de la représentation, (…) met en scène et suit les destins de personnages fictifs donnés comme réels, qui évoluent dans un monde qui correspond, au moins virtuellement, au monde de l’expérience quotidienne du lecteurNote666. . » Cerner avec davantage de précision les enjeux et les fonctions de l’écriture réaliste telle qu’elle est actualisée par le roman noir permettra de définir quelques modalités d’écriture du réalisme noir. Par les nuances critiques et idéologiques qu’il revêt, le genre est d’ailleurs social autant que réaliste.
1.1. Enjeux et modalités de l’écriture réaliste.
1.1.1. Enjeux et fonctions du réalisme dans le roman noir.
Comment le roman noir des années 1990-2000 peut-il être réaliste, quand on sait que le réalisme fournit des arguments à ses détracteurs ? En effet, le 20ème siècle a instruit le procès du réalisme et de l’illusion référentielle qu’il génère. Ce ne serait qu’un leurre pour lecteur naïf, détourné des enjeux esthétiques de l’œuvre par sa volonté de trouver dans le texte des traces du réel. Les critiques formalistes ont rejeté l’idée de la référence au réel, le prétendu rapport entre littérature et réalité, arguant notamment de l’impossibilité du langage littéraire de référer à autre chose que du langage. La critique se fait plus acerbe encore dans la bouche des détracteurs de la paralittérature, qui reprochent à cette dernière à la fois l’invraisemblance rocambolesque d’intrigues peu conformes à la réalité et son excès d’illusionnisme. Le réalisme serait un leurre tendant à faire adhérer le lecteur à la fiction par un excès de conformité au monde réel, selon une « esthétique de la transparence » évoquée par Daniel Couégnas dans Introduction à la paralittératureNote667. . Tantôt versé dans un irréalisme et une invraisemblance échevelés, tantôt « englué dans l’illusion référentielleNote668. », le récit paralittéraire oscillerait entre deux tendances de manière fort néfaste.
Or, outre le fait que le caractère paralittéraire du roman noir des années 1990-2000 est très discutable, en tout cas fort complexeNote669. , le genre se situe à l’opposé de ces « erreursNote670. ». Le réalisme est ici un projet assumé, parfois revendiqué comme tel, et qui fait avant tout penser aux engagements éthiques et esthétiques des romanciers du 19ème siècle. Il ne s’agit pas de dénier toute « esthétique de la transparence » au roman noir, mais de saisir le réalisme en tant qu’il est lié à la visée que s’assigne le genre. En effet, le roman noir entend proposer, par la fiction romanesque, une exploration du réel, ainsi que des interrogations sur l’homme la société et le monde – et des réponses à ces interrogations. Autrement dit, le genre se définit par sa visée heuristique, cet adjectif étant ici retenu dans son sens large de « qui sert à la découverte ». Cela est à mettre en relation avec ce que Susan Rubin Suleiman appelle l’impulsion réaliste, soit le « désir de faire voir, de faire comprendre quelque chose au lecteur à propos de lui-même, ou de la société ou du monde où il vitNote671. ». En ce sens, le roman noir n’est pas seulement une imitation de la réalité, mais aussi un dévoilement du réel selon une exigence de vérité, qui peut à l’occasion se doter d’une intention didactique, délivrant un enseignement au lecteur, voire l’exhortant à l’action. L’auteur de roman noir ressemble ainsi à l’écrivain selon Sartre :
L’écrivain a choisi de dévoiler le monde et singulièrement l’homme aux autres hommes pour que ceux-ci prennent, en face de l’objet ainsi mis à nu, leur entière responsabilitéNote672. .
D’ailleurs, parce qu’il entend révéler les mécanismes cachés qui régissent la société et les comportements, le roman noir va le plus souvent dévoiler des failles, des dysfonctionnements, prendre une position critique et se donner comme ce que Jacques Dubois nomme un contre-savoir, face à la doxa jugée aliénante. On peut reprendre à propos du roman noir les propos qu’il tient sur le roman réaliste :
Ce savoir du discours réaliste aime aussi à prendre les allures d’un contre-savoir, c’est-à-dire à divulguer ce que la doxa ne rend pas public. Le réalisme se fait alors dévoilement toujours plus ou moins scandaleuxNote673. .
Avant même de voir en quoi les romans eux-mêmes instaurent cette contre-doxa, on peut se référer aux déclarations des auteurs sur le genre ou sur leurs romans pour voir apparaître clairement ce projet. Tous ne s’expriment bien sûr pas à ce sujet, mais certains ont une position claire sur la question des enjeux réalistes du roman noirNote674. . Plusieurs auteurs revendiquent clairement la fonction mimétique du roman noir, comme Paul Borrelli, qui parle de « reflet de la sociétéNote675. », Thierry Jonquet de « portrait de la société », « effet de miroirNote676. », ou Didier Daeninckx qui loue sa « proximité avec la réalitéNote677. ». Gérard Delteil y voit le genre « qui convient le mieux pour parler du monde contemporain, le décrireNote678. », alors que selon Jean-Bernard Pouy, « décrire le monde » est une « nécessité du polarNote679. ». Le roman noir est donc intrinsèquement mimétique. Chez d’autres prévaut sur ce réalisme-miroir la conception d’un réalisme à visée heuristique. Si les auteurs dépeignent la réalité, c’est parce que l’enjeu est d’en révéler les faces cachées, les aspects occultés par les institutions et les différents pouvoirs. Le roman noir se veut une contre-doxa, capable de démasquer les discours mensongers et aliénants, de lever les voiles sur les manipulations d’état. Ainsi, pour Claude Amoz, « le polar soulève les masques, regarde derrière les apparencesNote680. », pour Paul Borrelli, « il a entre autres pour fonction de faire surgir au grand jour ce genre de réalités » occultées. Thierry Crifo confirme que « le roman noir met un coup de projecteur sur les failles, fêlures, dysfonctionnements d’une société ou d’un individuNote681. ». Tout comme Zola affirmait dans la préface de L’Assommoir avoir écrit « une œuvre de vérité, le premier roman sur le peuple, qui ne mente pas et qui ait l’odeur du peupleNote682. », rappelons que Dantec résume ainsi son projet d’écrivain :
Une volonté d’éclairer, de montrer des choses qui sont généralement refoulées. Ce n’est pas politiquement ou culturellement correct de parler de la mort, du mal, de la barbarie, du sang, de la violence, mais 80% de l’activité humaine est basée là-dessus. À mon sens, il doit y avoir, dans le polar, un niveau d’exigence par rapport à ça, il s’agit de soulever le tapis sous lequel la société occidentale a planqué toutes ses merdesNote683. .
Pascale Fonteneau se déclare intéressée plus que tout par le « derrière des choses », « l’envers des choses, la face cachéeNote684. ». Maurice Gouiran « adore planter [ses] intrigues dans l’Histoire du 20ème siècle, pas l’Histoire officielle qui est enseignée dans les collèges et les lycées mais celle que l’on cache ou que l’on maquilleNote685. . » En tant que lectrice comme en tant qu’auteur, Sylvie Granotier espère par le roman noir « passer de l’autre côté… de l’autre côté des apparences, de l’autre côté du miroirNote686. ». Patrick Raynal lie cette quête heuristique à la portée sociale du roman noir :
L’objet de l’enquête est de mettre à jour ces faits et cette violence, et d’en désigner les responsables. Ceci amène à dépasser le cas particulier du héros pour aller vers une critique sociale. Le roman noir est une enquête sur les failles et les marges de la sociétéNote687. .
La visée heuristique du roman noir suppose donc une dimension mimétique, puisqu’il s’agit de dire le réel, d’en démonter les mécanismes, mais cela passe par une entreprise de dévoilement, d’identification des causalités et des responsabilités. L’opacité du réel fait que le roman noir, s’il veut décrire, doit démonter, décrypter. À travers ces deux aspects du réalisme – réalisme-miroir et réalisme-dévoilement – on retrouve les deux tendances du discours réaliste évoquées par Philippe Hamon :
La première, que l’on pourrait appeler horizontale (dérouler les paradigmes lexicaux et technologiques, faire l’inventaire des champs anthropologiques proposés par le réel et des champs lexicaux proposés par la langue, et renvoyant à une compétence lexicale commune à l’auteur et au lecteur) aboutissant à une esthétique du discontinu et du non-récitNote688. .
On est proche dans cette dimension horizontale de l’ambition balzacienne et plus largement réaliste d’embrasser la totalité du réel. Elle est présente dans le roman noir, non à travers une œuvre précise ou le projet d’un auteur en particulier, mais dans le genre lui-même. En effet, si l’on prend pour échantillon l’ensemble du corpus, on ne peut que constater la diversité des milieux géographiques, sociaux, culturels, traités par le roman noirNote689. . Tous les milieux sont balayés, même si certains auteurs s’attachent particulièrement au monde des marginaux et des exclus. Nombre de romans, quel que soit le milieu social qu’ils prennent comme sujet, entendent l’explorer avec une précision parfois très documentée. Certains auteurs choisissent d’ailleurs comme cadre de leurs premiers romans noirs l’univers professionnel dont ils sont issus, comme Michèle Rozenfarb, qui explore roman après roman un univers médical spécialisé, les hôpitaux psychiatriques. Si la fantaisie n’est pas bannie des romans de cette psychiatre, on sent la précision du regard de la professionnelle dans les milieux dépeints. De même, Thierry Jonquet va utiliser dans ses premiers romans son expérience professionnelle en gériatrie, tandis que Tonino Benacquista peint de roman en roman des milieux sociaux et professionnels qu’il connaît, comme ceux de l’art et des galeries dans Trois carrés rouges sur fond noir, ceux de la nuit parisienne dans Les Morsures de l’aube, et la communauté italienne immigrée dans La Commedia des ratés. D’autres se livrent à un véritable travail de documentation voire d’investigation avant de livrer une interprétation de faits inspirés d’événements réels, comme Lakhdar Belaïd, Didier Daeninckx, Dominique Manotti. Lakhdar Belaïd met à profit ses compétences de journaliste – l’un des protagonistes de Sérail Killers est d’ailleurs journaliste – pour construire son observation du réel, et Dominique Manotti travaille avec la rigueur de l’historienne. Chacun des trois romans du corpus explore un milieu familier ou sur lequel elle s’est longuement documentée : Sombre sentier revient sur les luttes des clandestins dans les années 80, dans le quartier du Sentier à Paris, lutte dans laquelle elle-même s’est engagée, Kop explore le milieu du football et À nos chevaux celui des courses hippiques. On retrouve des méthodes proches de celles de Zola ou des frères Goncourt qui élaborent une représentation documentée et fidèle des conditions de vie et de travail du peuple (qui peut passer par l’utilisation d’un technolecte, comme celui des mines dans Germinal, par exemple), par la reproduction du lexique caractéristique de telle ou telle classe sociale (la langue du peuple contaminant la narration même dans L’Assommoir). Les auteurs de romans noirs vont explorer de nouvelles régions exclues de la littérature, porter sur le devant de la scène romanesque des catégories sociales bannies de la représentation littéraire, comme les immigrés, les habitants de banlieues.
Néanmoins, on se souvient qu’un peu plus d’un quart seulement des romans du corpus entendent peindre la marginalité, et de fait s’intéressent à des couches de la population qu’on pourrait estimer exclues du personnel courant du roman dans les années 90. C’est que là n’est pas l’enjeu. Le scandale n’est pas tant de parler des vieillards abandonnés dans un mouroir ou des SDF, que d’exposer la face sombre de l’humain et de la société. Ainsi que le dit Dantec, le roman noir est un roman de violence, de mal, de mort, de barbarie. De même que le roman naturaliste était un roman de la morbidité, du corps malade ou en proie à des appétits mortifères ou dépravés, le roman noir évoque le mal sous toutes ses formes criminelles, les transgressions des normes morales quelles qu’elles soient. Cela explique la récurrence des thèmes de la déviance, de la folie criminelle, par exemple dans les romans de Stéphanie Benson ou de Maurice G.Dantec.
De fait, la spécificité du roman noir est plutôt d’exploiter la seconde tendance du roman réaliste, la tendance verticale, ainsi définie par Philippe Hamon :
Décrypter, chercher à lire les signes de l’être intime, vrai et profond, aboutissant à une esthétique de l’unité, réintroduisant le récit comme quête de savoir, et rétablissant une relation de type pédagogique (l’auteur transmet une information à un lecteur non ou moins informé)Note690. .
Dans le corpus, de nombreux romans exploitent les thèmes de la folie meurtrière en tant qu’elle est dissimulée sous des dehors ordinaires, en tant aussi qu’elle est liée dans ses fondements à des secrets familiaux tels que l’inceste, la maltraitance, comme dans Fin de chasse de Jean-Paul Demure, ou Bouche d’ombre de Pascal Dessaint. C’est alors la famille, garante de l’ordre social, qui est démasquée et dénoncée comme institution aliénante voire mortifère. De plus nombreux romans encore vont s’attacher à dévoiler les dessous barbares de notre société capitaliste, dont le vernis craque à l’occasion de jeux ou de séminaires et stages de formation, comme dans Parcours fléché de Jean-Pierre Bastid, ou dans Chasseurs de têtes de Michel Crespy.
1.1.2. Modalités de l’écriture réaliste.
Il ne s’agit pas ici de prétendre à l’exhaustivité dans l’analyse des procédés réalistes à l’œuvre dans le roman noir. Outre que le corpus ne sera pas épuisé par cette étude, ce sont certains procédés jugés emblématiques de l’écriture réaliste telle qu’elle est utilisée par le roman noir qui seront ici retenus. Pour procéder à une telle étude, Philippe Hamon envisage le projet réaliste comme une pragmatique, une situation de communication constituée de présupposés, dont l’ensemble forme ce qu’il appelle un « cahier des charges » :
le monde est riche, divers, foisonnant, discontinu, etc. ;
je peux transmettre une information (lisible, cohérente) au sujet de ce monde ;
la langue peut copier le réel ;
la langue est seconde par rapport au réel (elle l’exprime, elle ne le crée pas), elle lui est « extérieure » ;
le support (le message) doit s’effacer au maximum (la « maison de verre » de Zola) ;
le geste producteur du message (style, énonciation, modalisation) doit s’effacer au maximum ;
mon lecteur doit croire à la vérité de mon information sur le mondeNote691. .
Mais par sa nature fictionnelle, le texte réaliste ne réfère pas directement et simplement au monde réel, il est au contraire coupé de la réalité. Lorenzo Bonoli rappelle que le pacte de lecture fictionnel se caractérise certes par la suspension de l’incrédulité mais aussi par « la construction d’un monde textuel qui prend forme dans la progression des lignes du texte et qui se présente comme un monde autonome, indépendant du monde réel (…) ». Pourtant, ajoute-t-il, « la fiction réaliste a la particularité de construire des mondes fictionnels qui présentent une sorte de continuité avec le monde d’expérience du lecteurNote692. ». Tout le « jeu » du texte réaliste obéit en quelque sorte à la règle suivante : faire admettre, par un certain nombre de subterfuges littéraires, sa conformité au domaine d’expérience, afin de retrouver une relation au monde réel. En cela, le texte réaliste est une « fiction réelle », « un mode d’écriture fictionnelle visant à transcender sa fictionalité pour se donner comme une description de la réalitéNote693. ». Quels sont les subterfuges empruntés par le roman noir, qui lui seraient propres ou non, pour assurer cette continuité avec le monde réel et délivrer une information à laquelle le lecteur serait susceptible de croire ? Si Philippe Hamon ordonne à partir de son « cahier des charges » les pistes d’analyse selon les deux axes de la lisibilité et de la description, nous nous contenterons ici de proposer quelques points, comme autant de procédés par lesquels les auteurs de romans noirs satisfont au projet réaliste qui est le leur.
1.1.2.1. Assurer la continuité entre monde fictif et monde réel.
Pour autant qu’elle affirme son caractère fictionnel et la liberté qui en découle, la fiction réaliste qu’est le roman noir va construire son univers diégétique en s’appuyant sur un certain nombre de connaissances relevant du monde réel, créant ainsi un effet de continuité épistémique entre le monde romanesque et le monde d’expérience du lecteur. Lorenzo Bonoli analyse ainsi cet effet :
Il semblerait par là que le réel tende à coïncider avec les connaissances que nous avons. Autrement dit, est réel, ou mieux, m’apparaît comme réel, tout ce qui m’est familier, tout ce qui est déjà catégorisé et conceptualisé, tout ce qui fait partie de mes connaissances établiesNote694. .
On peut distinguer deux niveaux dans cet effet de continuité : l’effet de réel, au sens où l’entend Roland Barthes, et l’enracinement de la diégèse du roman noir dans un substrat événementiel emprunté au monde réel (fait divers, événement historique). Roland Barthes a défini dans son article de 1968 « l’effet de réelNote695. ». Le critique relève dans les récits un certain nombre de notations de détail sans aucune fonction, des « notations insignifiantes », qui contreviennent à la loi du récit, selon laquelle tout est signifiant. Le sens de cette apparente insignifiance est en réalité de dénoter le réel concret :
Tout cela dit que le « réel » est réputé se suffire à lui-même, qu’il est assez fort pour démentir toute idée de « fonction », que son énonciation n’a nul besoin d’être intégrée dans une structure et que l’avoir-été-là des choses est un principe suffisant de la paroleNote696. .
Ce détail concret expulse le signifié, dans une collusion directe entre le signifiant et le référent :
C’est là ce que l’on pourrait appeler l’illusion référentielle. La vérité de cette illusion est celle-ci : supprimé de l’énonciation réaliste à titre de signifié de dénotation, le « réel » y revient à titre de signifié de connotation ; car, dans le moment même où ces détails sont réputés dénoter directement le réel, ils ne font rien d’autre, sans le dire, que le signifier. (…) C’est la catégorie du « réel » (et non ses contenus contingents) qui est alors signifiée ; autrement dit, la carence même du signifié au profit du seul référent devient le signifiant même du réalisme : il se produit un effet de réel (…)Note697. .
L’effet de réel est bel et bien présent dans les romans de notre corpus, à des degrés divers. Les références à des lieux ou à des personnes réelles sont si nombreuses que l’univers que produit la fiction ressemble au monde réel. Les romans de Jean-Claude Izzo dessinent avec précision et exactitude la carte de certains quartiers de Marseille. Dès le début de Total Khéops (Izzo, 1995), les noms de rue se multiplient, rue des Pistoles, Montée-des-Acoules, et les romans sont parsemés de « notations insignifiantes », qui n’ont d’autre effet que d’enraciner la diégèse dans une réalité topographique et géographique extra-textuelle, empruntée au monde réel. Ainsi, dans Total Khéops, le narrateur, Fabio Montale, relate ses escapades gastronomiques avec Leila :
Nous nous étions lancés dans une grande tournée des cuisines étrangères, ce qui, d’Aix à Marseille, pouvait nous occuper de longs mois. Nous donnions des étoiles par ci, des mauvais points par là. En tête de notre sélection, le Mille et Une nuits, boulevard d’Athènes. On y mangeait sur des poufs, devant un grand plateau de cuivre, en écoutant du raï. Cuisine marocaine. La plus raffinée du Maghreb. Ils servaient là la meilleure pastilla de pigeon que j’aie jamais mangé. Ce soir-là, j’avais proposé d’aller dîner aux Tamaris, un petit restaurant grec dans la calanque de Samena, pas loin de chez moiNote698. .
Si nous n’avons pas trouvé trace des Mille et Une nuits – qui peut avoir disparu depuis la parution du livre – le restaurant grec existe bien à l’adresse indiquée. Dans Solea, le narrateur prend le temps d’évoquer sa pause à la terrasse d’un café qui existe sur le port de Marseille :
Je pris une bière, puis deux, puis trois. J’étais à l’ombre, à la terrasse de la Samaritaine, sur le port. Ici, il y avait toujours un peu d’air de la mer. Ce n’était pas à dire vrai de l’air frais, mais c’était suffisant pour ne pas dégouliner de transpiration à chaque gorgée de bière. J’étais bien ici. À la plus belle terrasse du Vieux-PortNote699. .
De la même façon, René Belletto enracine Régis Mille l’éventreur dans sa ville de Lyon et ses environs, et l’effet de réel, pour être une « notation insignifiante », ne s’en fait pas moins envahissant dans certains passages :
Blanche Botello descendait le cours Lafayette. Elle roulait trop vite, elle fumait sans arrêt. (…) Elle s’enfonça dans Villeurbanne désert. Elle atteignit la place Albert Thomas, contourna l’étrange mât multicolore, l’espèce de totem planté au milieu, laissa à droite le cours Tolstoï puis la rue du Quatre-Août, prit le cours de la République jusqu’à la rue Francis de Pressensé, tourna à droite, et très vite, juste avant les panneaux de déviation, à gauche, dans la rue du Lieutenant PadilleNote700. .
On pourrait ainsi multiplier les exemples de romans noirs enracinés dans une ville, un quartier, et relever nombre de notations géographiques et topographiques, noms de rue, allusions à des commerces existant réellement, descriptions de lieux réels. Cependant, le choix des lieux a généralement un sens dans la diégèse. Ainsi, Dominique Manotti retient et décrit le quartier du Sentier à Paris parce qu’il est un foyer d’immigration clandestine fort, et que son roman, Sombre sentier, enracine son intrigue dans les luttes des sans-papiers et des travailleurs cladestins ; de même, La porte de derrière, de Marc Villard, prend pour décor le quartier de Barbès, parce que l’auteur entend écrire une chronique barbésienne de la misère et de la fatalité qu’elle entraîne.
Les effets de réel ne reposent pas seulement sur l’évocation de lieux. Le roman noir peut également faire référence à divers éléments culturels qui lui sont extérieurs, et que le lecteur connaît ou dont il peut vérifier l’existence. Ainsi, Chantal Pelletier, dans Le Chant du bouc :
Sur Europe 2, Francis Cabrel menaçait d’aller dormir chez la dame de Haute-Savoie, Momo y serait bien allé aussi. Un peu de repos chez une nana qui a fait toutes les guerres lui aurait peut-être fait oublier qu’il était un quarantenaire sans femme ni maîtresse, qui habitait un bouge et ne vivait nulle part. Un vieux bouc dont la violente odeur de suint n’électrisait plus aucune femelle. Lorsqu’il sortit de chez lui après trois Nescafé, une douche, et Osez Joséphine chanté avec Bashung alors qu’il se rasait au-dessus du lavabo, Momo se sentait un peu mieux malgré la pluie qui lui tombait sur la casquette. Il grimpa directement vers le haut de la rue Lepic par la rue Ravignan et la rue de la MireNote701. .
Quelle que soit la variété des référents de ces effets de réel, peu de romans y échappent. Quelques romans construisent un univers assez éloigné du monde du lecteur, soit qu’ils élaborent une société imaginaire dans des lieux imaginaires, comme Guillaume Nicloux dans Zoocity, ou Philippe Thirault dans Speedway, deux romans dont la diégèse prend place dans une Amérique irréelle ; soit qu’il s’agisse de fictions futuristes comme Trajectoires terminales de Paul Borrelli, Cœur-Caillou de Virginie Brac, À sec ! de Jean-Bernard Pouy, ou Babylon Babies de Maurice G.Dantec. Mais en réalité, aucune de ces fictions ne se dispense de l’effet de réel. Il peut s’agir d’allusions à des lieux et à des objets : La Plaine Saint-Denis ou les véhicules (leurs fabricants) dans À sec !, Marseille dans Trajectoires terminales. Même Babylon babies, qui est le plus futuriste et le plus irréaliste de ces romans, parsème son univers d’objets qui ont une réalité extra-textuelle pour le lecteur des années 1990-2000 : des « tubes de crème Nivea » sont mentionnés page 135, et Marie Zorn se délecte d’un Nesquik pour le petit-déjeuner à la page 138.
À côté de ces détails totalement inutiles, certaines notations semblent avoir une double vocation, celle d’effets de réel et celle d’éléments de signification pour la diégèse, à des niveaux différents. Dans le passage suivant, tiré d’un roman de Marc Villard, le récit évoque la chambre de l’un de ses personnages, dans une énumération de ses possessions, qui superpose à l’effet de réel une autre signification :
Ses vêtements sont suspendus sur un présentoir de cintres braqué dans un supermarché d’Aubervilliers et, à droite des vêtements, une bibliothèque supporte un foutoir sympathique. Sur le rang du haut, les incontournables : Le cheval sans tête et Le piano à bretelles de Paul Berna, Brouillard au pont de Tolbiac de Malet en collection poche, Astérix période Goscinny, Le Comte de Monte Cristo, Les Quatre fils Aymon et, pêle-mêle, des récups voire des larcins : Sartre, Camus, San Antonio, La pêche à la truite en Amérique de Richard Brautigan, la bio d’Elvis par Goldman, Comment vivre sa ménopause, Eviter la chute des cheveux et les œuvres complètes de Rimbaud en collection Club. Juste en dessous sont compilées les revues : Akira, Strange, Maxi Basket, Fluide Glacial, Tintin. Enfin viennent les disques serrés sur le niveau le plus bas pour faire de la place à une mini-chaîne de contrebande bidouillée par un magicien de l’électronique. Stevie se redresse sur son coude droit et jette un coup d’œil sur son vinyl : Stevie Ray Vaughan, Hendrix, Elliott Murphy, Public Enemy, Clapton (le coffret), six Dylan dont Blonde on blonde, Bob Marley, Springsteen, trois Ray Charles, un Fats Domino décati et deux J.J.GoldmanNote702. .
Cette série de notations permet en effet de caractériser, quoique indirectement, ce personnage d’adolescent : la totalité des éléments évoqués forme un ensemble composite qui trahit les goûts du garçon (Dylan, Springsteen, Marley), des restes de son enfance (Astérix), ses goûts sportifs (Maxi Basket), ainsi que le caractère butineur d’un jeune homme qui récupère des ouvrages qui ne lui correspondent guère (Comment vivre sa ménopause, Eviter la chute des cheveux). Mais la plupart des éléments qui composent son patrimoine culturel constitue, individuellement, un effet de réel, car chacun existe en dehors de la fiction. Ces éléments assurent ainsi la continuité entre le monde de la fiction et le monde réel.
Plus généralement, le roman noir construit des univers fortement ancrés dans la réalité événementielle et historique extra-textuelle. Il va alors s’appuyer sur des connaissances déjà établies pour le lecteur, afin de lui délivrer de nouvelles informations, soit sur ces événements mêmes, soit sur la société plus largement. C’est ce que Philippe Hamon appelle « l’histoire parallèle » :
Le récit est embrayé sur une méga (extra) Histoire qui, en filigrane, le double, l’éclaire, le prédétermine, et crée chez le lecteur des lignes de frayage de moindre résistance, de prévisibilités, un système d’attentes, en renvoyant implicitement ou explicitement (par la citation, par le nom propre, par l’allusion, etc.) à un texte déjà écrit qu’il connaît. (…) Le texte réaliste privilégiera sans doute le texte profane (l’Histoire), qu’il situera aussi proche que possible de son lecteurNote703. .
De fait, l’écriture du roman noir est une écriture du contemporain, de l’immédiatement contemporain très souvent. Quelques années peuvent séparer la date de publication du roman de la date de la diégèse, mais l’effet de familiarité n’en est pas affecté. De même, certains romans noirs choisissent d’enraciner l’action dans le futur, mais il s’agit toujours d’un futur proche, aussi futuriste et décalé que soit l’univers diégétique. C’est le cas de Trajectoires terminales, de Paul Borrelli, qui se déroule en 2034, ou de Cœur-Caillou de Virginie Brac, qui se passe à une date indéterminée, mais dans un univers très proche du nôtre, à ceci près qu’une ville a été totalement détruite par une explosion nucléaire : cela n’implique d’ailleurs pas la projection dans le futur, tout au plus la création d’un monde imaginaire. Par ailleurs, ces fictions futuristes peuvent intégrer des événements historiques contemporains à la date de publication du roman. C’est le cas dans Babylon babies, qui fait référence à des événements des années 90 – ce qui renforce la crédibilité de l’univers futuriste créé, héritier d’une réalité historique familière au lecteur. Babylon Babies s’ouvre sur une évocation du mercenaire Toorop, et si les conflits évoqués sont pour la plupart fictifs (au sens où ils prennent place dans le futur), certains sont bien connus du public :
Toorop s’était toujours demandé pourquoi le don s’était révélé à lui durant les derniers mois de la guerre en Croatie et en Bosnie. Il faut dire que pendant la première partie du conflit bosniaque, l’armée gouvernementale fut incapable de réagir de façon coordonnée face aux assauts conjugués de l’armée yougoslave et des milices de Karadzic, d’Arkan ou de Seselj. ( …) Des villes détruites, Toorop en avait croisé un bon paquet depuis 1991, certes, mais la plupart du temps il s’agissait de bourgades aux architectures balkaniques traditionnelles. De Dubrovnik à Vukovar, de Zenica à Donje Vakuf, des mosquées et des églises en ruines, ça il en avait vu son compte. Pendant l’automne 92, alors qu’il se battait à Sarajevo même, c’était encore une vieille ville historique qu’on bombardait, idem lorsqu’il était passé par Mostar, en revenant de l’offensive sur BihacNote704. .
Si Dantec évoque la guerre de Bosnie, ce n’est pas seulement pour accroître la crédibilité de son personnage dans une perspective réaliste, c’est aussi parce que l’univers qu’il s’apprête à mettre en place est pour lui l’héritier de ce conflit et de ses enjeux, de ses conséquences.
Plus généralement, le roman noir peut être défini comme une écriture du contemporain : la diégèse s’enracine dans le présent immédiat ou un passé très proche. Généralement, aucune date n’est nécessaire : l’enracinement dans l’époque immédiatement contemporaine, avec une amplitude de quelques années, semble être un attendu du genre, si bien que les auteurs n’ont pas besoin de préciser l’année de mise en place de la diégèse. Le plus souvent, des détails (relevant de l’effet de réel, éventuellement) confirment la contemporanéité de la diégèse et de l’époque de publication du roman. Cependant, dans un certain nombre de romans, des notations temporelles précises interviennent dans les premières pages. Il peut s’agir d’une notation temporelle en ouverture de chapitre ou de partie :
Lundi 22 septembre 1997, dix heures et demie. (P.Carrese, Tue-les à chaque fois, 1999)
Vendredi 9 juin 1989 (D.Manotti, À nos chevaux !, 1997)
16 juillet 1994. Samedi. (R.Slocombe, Un été japonais, 2000)
Parfois, l’indication temporelle se glisse dans le récit même ou dans des dialogues :
Elle est la 124ème dans ce cas en 1999. (M.Crespy, Chasseurs de tête, 2000)
Le 27 avril 1993, quelques minutes avant que sa vie ne bascule tout à fait, Hugo Cornelius Toorop avait contemplé son visage dans la glace (…). (M.G. Dantec, La Sirène rouge, 1993)
Geneviève Dussolier mourut dès son arrivée à l’hôpital, le 22 septembre 1993, à vingt heures et quinze minutes. (M.G.Dantec, Les Racines du mal, 1995)
Dans La Dette du diable de Jean-Jacques Busino (1998), un article de journal daté de 1994 est reproduit dans les premières pages. Mais il est parfois nécessaire de déduire la date de la diégèse d’informations indirectes, comme dans L’Ancien crime, de Claude Amoz où, à propos d’un événement survenu sous l’Occupation, il est dit : « cette histoire a plus de cinquante ans, maintenant », alors que le roman est paru en 1999. Dans Nazis dans le métro de Didier Daeninckx, paru en 1996, il est précisé :
L’éphéméride (…) lui rappela l’assassinat de Jean Jaurès, quatre-vingt-un ans plus tôt, jour pour jour, le 31 juillet 1914.
Dans Otto de P.Fonteneau, paru en 1997, il suffit de croiser deux informations, celle qui précise page 14 qu’un personnage est né en 1946, et celle qui précise deux pages plus loin qu’après « quarante années », il souhaite prendre un nouveau départ. Plus indirectement encore, on peut inférer la date de la diégèse de Né de fils inconnu de P.Raynal, paru en 1995, d’après l’information délivrée par un personnage : Juliet Berto vient de mourir ; il suffit de savoir que la comédienne est morte le 10 janvier 1999 pour connaître la date de la diégèseNote705. .
Quels que soient les moyens qu’utilise la fiction pour informer le lecteur de la date de la diégèse, le roman noir confirme son statut de roman du contemporain, de « polaroïd » de l’époque, pour reprendre une expression de Patrick Raynal. Les auteurs ne prennent pas seulement pour cadre l’actualité, ils en font parfois la matière même de leurs romans. Il peut s’agir de l’actualité des faits divers. Ainsi, Thierry Jonquet s’inspire d’un fait divers pour écrire Moloch, ce qui lui a d’ailleurs valu un procès, sur lequel nous reviendrons ultérieurement. La simultanéité des faits réels et de la diégèse est ici à son comble, puisque le roman est publié alors que l’affaire dont il s’inspire n’était pas encore jugée mais en cours d’instruction. Il en va de même pour le deuxième Poulpe écrit par Didier Daeninckx, Ethique en toc. Le romancier évoque directement l’incendie criminel qui ravagea les locaux de la bibliothèque universitaire de Lyon en juin 1999. L’auteur n’avait d’ailleurs pas besoin de préciser au début du roman que l’action est immédiatement contemporaine du moment de l’écriture du texteNote706. , car le lecteur dispose de l’information fournie par l’actualité. Cette actualité que d’aucuns pourraient qualifier de fait-diversière est utilisée comme matière politique et historique par Didier Daeninckx qui, conformément au cahier des charges du Poulpe et à ses engagements, réinterprète le fait divers en lui donnant une portée politique et y voit l’œuvre des milieux négationnistes et révisionnistes. Cela lui permet de lier passé et présent, comme il l’avait fait pour l’Algérie dans Meurtres pour mémoire en 1983.
L’Histoire intervient par ailleurs de deux manières dans le roman noir. Il peut s’agir de l’Histoire immédiatement contemporaine, comme l’évolution historique et politique de l’Algérie dans les romans de l’Algérien Yasmina Khadra, ou dans Sérail Killers de Lakhdar Belaïd, lié à l’actualité algérienne et aux développements de l’intégrisme musulman dans le nord de la France. Jean-Claude Izzo fait de la montée de l’extrême-droite le thème principal de sa trilogie marseillaise, dressant le portrait d’une société gangrenée par le racisme et la corruption, par les réactions communautaires et la montée de l’intégrisme musulman. Stéphanie Benson réinterprète un passé proche dans son dyptique Synchronicité, qui évoque l’Angleterre ultra-libérale et les grèves des dockers de Liverpool. Dominique Manotti retrace dans Sombre sentier la chronique de la lutte des sans-papiers turcs dans le quartier du Sentier en 1980. Il peut s’agir aussi du passé et d’une Histoire plus lointaine. En effet, si le roman noir est un roman du contemporain, le passé n’est pas banni de ses préoccupations, et le genre ne s’interdit pas des actions qui prennent place dans les décennies antérieures. On a d’ailleurs vu précédemment que l’Histoire était une thématique possible, faisant apparaître des périodes privilégiées, dont l’analyse et le récit par l’Histoire officielle sont jugés particulièrement opaques, comme l’Occupation, la guerre d’Algérie. Quand le roman noir s’intéresse au passé, c’est à un passé qui fait l’objet de polémiques et dont les zones d’opacité ont des conséquences sur le présent. Ainsi, nul roman noir ne se déroule uniquement dans le passé, mais c’est toujours à partir d’un point d’ancrage contemporain que le passé est revisité, comme dans Le Pied-rouge de François Muratet, La Nuit apache de Patrick Mosconi, Otto de Pascale Fonteneau, Ferdinaud Céline de Siniac, Les Orpailleurs de Thierry Jonquet, L’Ancien crime de Claude Amoz, La Nuit des bras cassés de Maurice Gouiran, Treize reste raide de René Merle. On peut adjoindre à ces romans qui traitent des périodes de l’Occupation (et de l’avant-guerre, avec la montée de l’extrême droite) ou de la guerre d’Algérie La Belle Ombre de Michel Quint, qui traite à la fois de la Première Guerre Mondiale et du scandale du sang contaminé dans les années 80 et 90, ou Petites morts dans un hôpital psychiatrique de campagne dans lequel Michel Steiner, défenseur de l’anti-psychiatrie, évoque les pratiques barbares qui parsèment l’histoire de la psychiatrie et des hôpitaux psychiatriques.
Les auteurs n’hésitent pas à se documenter pour traiter de ces événements d’actualité ou historiques, et l’on trouve parfois trace de ce travail préalable dans le paratexte auctorial. Ainsi, Jean-Claude Izzo dote Solea d’une postface où il est fait mention de documents ayant servi de point d’appui pour le roman, comme des documents officiels des Nations Unies, des articles de presse. L’intrigue, quoique fictive, fait référence à un certain nombre de faits réels, comme l’opération Mani Pulite, l’assassinat de Yann Piat. Une analyse des romans de Dantec a également montré le travail de documentation effectué par l’auteur au moment de l’écriture des Racines du Mal, puisque le roman s’ouvre sur une page de remerciements bibliographiques mentionnant des ouvrages scientifiques. Le Pied-Rouge est suivi de « Remerciements bibliographiques », où François Muratet cite les ouvrages qui lui ont servi de documentation, à la fois sur la guerre d’Algérie et sur l’histoire des mouvements gauchistes. Le roman noir, à l’instar du roman réaliste et naturaliste du 19ème siècle, se documente sur les sujets qu’il aborde, parce qu’il entend proposer un témoignage aussi juste que possible, conforme à la vérité des faits.
Ainsi, le roman noir s’intéresse aussi bien à l’Histoire qu’à l’actualité, et se montre d’ailleurs très réactif à cette dernière. Le texte n’est pas seulement vraisemblable. Parce qu’il intègre des documents et des événements réels, il est un discours sur le monde réel. Nous verrons que cela n’est pas sans poser de problème quant au statut fictionnel du genre, mais cela participe de l’écriture réaliste du roman noir.
Il est un dernier point qui accroît l’adhésion du lecteur à l’univers fictionnel, c’est la sérialité, qui contribue à enraciner le roman noir dans la culture médiatique, on l’a vu précédemment. Mais la sérialité, lorsqu’elle consiste en l’utilisation de personnages récurrents, crée aussi un effet de réel. Jacques Dubois constate cela à propos de Balzac, dont l’entreprise romanesque totalisante pouvait pâtir selon lui d’un aspect cumulatif sans véritable cohérence ou cohésion :
On sait que Balzac a su remédier à ce défaut par quelques procédés dont le plus astucieux et le plus sensible est le retour de certains personnages d’une séquence à l’autre. Puissant effet de réel qui instaure la grande structure macrocosmique en réseau relationnelNote707. .
Dans le roman noir, de la même façon, la récurrence d’un personnage crée un effet de continuité, de cohérence et de familiarité d’un roman à l’autre, ce qui accroît la croyance en l’univers créé.
1.1.2.2. Effacer les traces du geste producteur de l’écriture romanesque.
Le roman noir, en tant que récit réaliste, va s’efforcer de gommer les indices de son avènement en tant que texte de fiction, affirmer l’immédiateté et la naturalité de la représentation, en s’efforçant de manifester le « déjà-là » du monde, comme si le récit était prélevé sur la continuité du réel, et en essayant de masquer la médiation de l’instance énonciatrice qu’est l’auteur.
L’incipit est un lieu de transaction essentiel, car l’auteur, ainsi que le fait remarquer Jacques Dubois, « est contraint d’établir le lieu de son énonciation et le protocole de sa lecture ». Il ajoute :
À cet égard, le texte réaliste rencontre deux exigences difficilement conciliables. D’un côté, il se doit de mettre la fiction en train, d’en instaurer l’appareil (sujet, personnage, décor, instance narrative…). De l’autre, il vise à produire les garanties de l’authenticité de son dire, en faisant référence à un hors-texte et en masquant le caractère fictif de son geste initialNote708. .
Nous ne procèderons pas ici à une étude et à un classement exhaustifs des incipit des romans du corpus ; quelques tendances seront dégagées. Il faut préalablement remarquer qu’un certain nombre d’entre eux ne cherchent pas à masquer l’instance narrative, s’exhibant même parfois en tant que récit. On se souvient que Michel Quint inaugure ses romans par une écriture poétique et lyrique, une atmosphère onirique :
Un grand bélier noir dormait aux galets de la grève. Le fleuve lavait sa toison et des chevauchées de nuages passaient dans ses orbites devenues vides où stagnait l’eau. (Le Bélier noir)
Je suis un peuple sans destin. Et jamais je n’eus de maison vraie. (La Belle Ombre)
D’autres récits – homodiégétiques exclusivement – se présentent comme tels :
Je m’appelle Henri, Henri Davezac. Cette histoire pourrait commencer comme une bande-son de Ben Webster et Coleman Hawkins. (P.Mosconi, La Nuit apache, 1990)
Flic à la crim. Service de six heures à vingt-trois heures, pas d’horaires, pas de temps mort. Tempo meurtre, à toutes les sauces. Le creuset de l’humain ; déchiré, écartelé. (T.Chevillard, The bad leitmotiv, 2000)
Au fond, j’ai un faible pour les dingues. Les barjots, les cinglés, les mal-cuits, les cinoques, les névrosés, les psychotiques, les fous. C’est peut-être comme ça qu’on devient un bon psy. Ou bien le contraire. Au début, j’observais mes patients à distance confortable, sans m’investir, comme on dit. J’étais une psy très comme il faut, à part ce vide dans ma poitrine. Aujourd’hui, les choses ont un peu évolué. Je travaille sans filet. (V.Brac, Tropique du pervers, 2000)
Tout a commencé, tout commence avec le vent, ce bruit de mer que nous aimions écouter dans les arbres, et le livre est dédié à l’ami disparu qui avec moi a vécu cette histoire. (J.P.Bastid, Parcours fléché, 1995)
Dans ces exemples, le narrateur se présente, sauf dans le dernier qui fonctionne comme une dédicace. Cependant, si l’on considère que ces exemples constituent un relevé quasi exhaustif de ce type d’incipit, on conviendra que ce n’est guère représentatif des débuts de roman noir. Plus généralement, le récit va se masquer en tant que tel.
Yves Chevrel, analysant un échantillon d’incipit de romans naturalistes, note que « l’incipit naturaliste s’efforce (…) de devancer l’interrogation « quand ? » en insérant le récit dans une continuité déjà en trainNote709. . » C’est le cas aussi pour l’incipit du roman noir, qui propose dans quelques cas seulement un marquage temporel historique explicite, comme on vient de le voirNote710. , préférant occulter la datation historique et inscrire la diégèse dans le temps historique de manière indirecte. Surtout, les incipit montrent une action inscrite dans la durée, et instaurant le cas échéant une rupture dans cette continuité. En voici quelques exemples, chacun étant suivi de l’analyse :
À deux heures moins cinq, une main descendait un rideau de fer en manque d’huile. Le bruit provenait de la rue de Paris. Chaque nuit, elle envoyait en orbite des bagnoles bourrées de gosses. Le nez collé aux vitres, ils ouvraient des yeux plus gros que leur destin, avec la tête pleine de rêves qui grilleraient sur la Ville Lumière. Une Safrane bleue métallisé se gara deux minutes plus tard dans une rue pavillonnaire. (M.Akkouche, Les Ardoises de la mémoire, 1999)
Le procédé est ici très classique : à une amorce à l’imparfait qui introduit un procès en cours (dont l’origine n’est pas déterminée), succède une rupture au passé simple.
L’homme au regard de glace jeta un dernier coup d’œil sur l’ennemi vaincu et l’oublia aussitôt. Marie l’attendait. Elle recouvrait le matelas sale de sa présence de jeune femme, les courbes de son corps un tourment de douceur. (S.Benson, Une chauve-souris dans le grenier, 1995)
Nous avons ici le cas inverse du précédent : la première phrase au passé simple indique un regard qui est le « dernier », autrement dit le procès se clôt au moment où s’ouvre le roman, tandis que la deuxième phrase indique un procès en cours, dont le début n’est pas déterminé.
Le miroir renvoyait toujours la même image. Un mètre quatre-vingts, soixante-dix-neuf kilos mal répartis, un nez cassé dans une cour de récréation de la DASS, des yeux pâles. Elle n’avait jamais pu s’y habituer. D’ailleurs, elle n’avait même pas essayé, trop occupée à survivre en attendant son heure. (V.Brac, Cœur-Caillou, 1997)
Cet incipit représente une variation du premier cas : l’imparfait indique un procès en cours (l’action de se regarder dans le miroir), souligné par l’adverbe « toujours ».
Elie survit ici, à l’hospice, et depuis si longtemps qu’il a perdu le sens du temps. (C.Amoz, Dans la tourbe, 1998)
Cet incipit a été retenu parce qu’il offre une alternative à l’emploi de l’imparfait ; pourtant, la valeur est la même, le présent de narration indiquant un procès en cours (on pourrait aisément le remplacer par l’imparfait), souligné par « depuis si longtemps ».
Et puis les murs ont commencé à trembler. C’était mon voisin qui remettait ça. (P.Dessaint, Les Paupières de Lou, 1992)
Ce cas est plus atypique : le roman s’ouvre sur une rupture, mais l’amorce de la phrase avec la locution « et puis » induit un « avant », un préalable temporel. En outre, le préfixe du verbe « remettre », dans la deuxième phrase, indique une répétition, suppose cet « avant ».
- … en conséquence condamne Pereira Pinto Da Silva à quinze ans de réclusion criminelle. (M.Embareck, Dans la seringue, 1999)
Cet incipit introduit le lecteur dans un procès en cours – dans tous les sens du terme ! – en livrant la fin d’une phrase, qui est par conséquent incomplète syntaxiquement, même si son sens est clair.
Si ce type d’incipit est fréquent, il est moins représenté que l’incipit in medias res, qui permet de commencer abruptement une action, d’inaugurer le roman en pleine action, sans mise en place préalable du cadre de la diégèse (décor, personnages, temporalité, etc.). Très souvent, l’incipit se donne à lire comme scène, faisant l’objet d’un récit à la 1ère personne ou à la 3ème personne :
José-Alonso Enriquez ordonna qu’on lui apporte sa mallette et logea une balle de 7,65 dans la tête de Jacques Bariod qui mourut sans s’en rendre compte. (J.J.Busino, La Dette du diable, 1998)
La première rafale atteint l’homme et la femme dans le dos, les corps s’écroulent sur l’esplanade déserte devant le centre commercial. La moto accélère deuxième rafale en passant à hauteur des cadavres, qui tressautent sous les balles. (D.Manotti, Kop, 1998)
Le mardi, il y eut quatre brebis égorgées à Ventebrune, dans les Alpes. Et le jeudi, neuf à Pierrefort. « Les loups, dit un vieux. Ils arrivent sur nous. » (F.Vargas, L’Homme à l’envers, 1999)
Comment ne pas penser que j’allais passer un sale quart d’heure ? J’en transpirais déjà, tout affolé à cette idée, un œil rivé quelque part sur un bouton de sa blouse immaculée – allez savoir pourquoi je fixais ce bouton, et pas ses yeux, sa bouche ou son front –, un autre du côté de ce fichu plateau et des engins de torture posés dessus. Je déglutissais avec peine. (P.Dessaint, La Vie n’est pas une punition, 1995)
Le degré d’intensité de l’action est très variable, du non-événement (le dernier extrait évoque en jouant avec les codes du roman noir une séance chez le dentiste…) au meurtre.
L’autre grand type d’incipit est celui qui propose directement des paroles ou des pensées de personnages, via le discours rapporté, discours direct ou style indirect libre :
Putain de ville, pensa Susan Cranford alors que le minibus s’éloignait du centre. Putain de putain de ville. Murs de brique et de béton, rues de macadam, habitants enfermés à l’intérieur de leur univers stérile, et elle-même dans tout ça ? (S.Benson, Brumes sur la Mersey, 1999)
Lucy n’en saurait rien. Une passade ? Une de plus ? Et pourquoi pas ? (P.Dessaint, Une pieuvre dans la tête, 1994)
- Je vous préviens, c’est un véritable poème… murmura Di Meglio. (T.Jonquet, Les Orpailleurs, 1993)
Enfin, il est quelques incipit atypiques, qui n’entrent pas dans ces catégories, et qui tendent aussi à gommer les indices de l’instance énonciatrice. C’est par exemple l’utilisation de phrases non verbales, posant le décor comme des didascalies :
Château-Rouge. Terrasse, sur un trottoir, au milieu des travaux. Ils sont assis côte à côte. Claudine est blonde, courte robe rose qui semble sage mais laisse un peu voir sa poitrine, parfaite poupée bien arrangée. (V.Despentes, Les Jolies Choses, 1998)
Dans quelques cas, l’incipit reproduit un énoncé qui n’appartient pas à la narration au sens où il est pris en charge par une autre instance énonciatrice que l’instance énonciatrice principale, censée être authentique. Ainsi, Sombre sentier de Dominique Manotti s’ouvre sur un article de journal – un article de Libération daté du 15 janvier 1980. C’est une manière d’ancrer le récit dans une réalité extra-textuelle, de masquer son caractère fictionnel. On trouve un procédé analogue dans Tir au but de Jean-Noël Blanc, qui s’ouvre sur une interview journalistique d’un joueur de football – l’un des personnages du roman – mais l’article est ici fictif, et il a avant tout pour but de contextualiser l’action. Enfin, Tue-les à chaque fois de Philippe Carrese s’ouvre sur le journal intime d’un personnage.
Tous les types d’incipit envisagés – ancrage diégétique classique, début in medias res, restitution d’une parole ou d’une pensée vivante, insertion d’énoncés pris en charge par une autre instance énonciatrice – visent à naturaliser le début de la diégèse, à l’inscrire dans une relation de continuité avec le monde extra-textuel et à gommer les indices de la fiction et de l’instance narrative.
Cette instance narrative a d’ailleurs tendance à se faire oublier dans l’ensemble du récit. Le genre du roman noir laisse peu de place aux narrateurs extra-diégétiques, représentants directs de l’auteur, intervenant avec toute leur superbe dans le récit même. Le roman noir reprend une fois encore une ambition réaliste : construire une énonciation qui s’absente de l’énoncé, selon le rêve d’un récit qui se raconterait tout seul. C’est le récit de type historique, dans lequel « les événements semblent se raconter eux-mêmesNote711. », sans narrateur à proprement parler. Toute médiation d’un narrateur viendrait en effet suspendre l’illusion référentielle. Cela peut aller de pair dans le roman noir avec une écriture de type comportementaliste, dans laquelle rien ne vient interférer entre l’événement et le lecteur : aucun effet d’annonce métanarrative, aucune subjectivité. Les chapitres s’enchaînent alors sans que rien ne vienne soutenir l’intelligence du lecteur dans des récits parfois complexes, faits d’ellipses et d’analepses. On a vu cependant que le roman noir des années 1990-2000 a peu recours à ce type d’écriture.
Le plus souvent, le récit, s’il efface toute trace du procès d’énonciation, ouvre le champ au regard et à la subjectivité des personnages, en ayant recours à la focalisation interne, au discours indirect libre et au monologue intérieur. C’est par exemple le cas dans les prologues qui ouvrent les trois romans de ce que l’on appelle aujourd’hui la trilogie marseillaise de Jean-Claude Izzo :
Il surveilla les alentours. Anxieux. Il avait misé que personne ne viendrait prendre le bus. Si quelqu’un se pointait, il renoncerait. Si, dans le bus, un passager voulait descendre, ça, il ne le saurait que trop tard. C’était un risque. Il avait décidé de le prendre. Puis il se dit qu’à prendre ce risque, il pouvait tout aussi bien prendre l’autre. Il se mit à calculer. Le bus qui s’arrête. La porte qui s’ouvre. La personne qui monte. Le bus qui redémarre. Quatre minutes. Non, hier, cela avait pris trois minutes seulement. Disons quatre, quand même. Zucca aurait déjà traversé. Non, il aurait vu la mobylette et la laisserait passer. (Izzo, Total Khéops, p.30)
Puis il fit une grimace, en songeant à sa mère. Sûr qu’au retour, il passerait un mauvais quart d’heure. Non seulement, il s’était taillé sans autorisation, à trois jours de la rentrée des classes, mais, avant de partir, il avait piqué mille balles dans la caisse du magasin.(…) Sa mère, il s’en arrangerait. Comme toujours. Mais c’est l’autre qui l’inquiétait. Le gros connard qui se prenait pour son père. (Izzo, Chourmo, p.14)
Elle eut à l’esprit la beauté du coucher du soleil, et voulut terminer par ces mots. Juste dire à Fabio que, malgré tout, le soleil était plus beau sur la mer, non pas plus beau mais plus vrai, non, ce n’était pas ça, non, elle avait envie d’être avec lui, dans son bateau au large de Riou et voir le soleil se fondre dans la mer. (Izzo, Solea, p.19)
Le regard et les pensées du personnage se substituent à la parole du narrateur, réduite à l’événementiel. Le roman noir peut cependant adopter une stratégie radicalement différente, qui tend non pas à effacer le procès d’énonciation, mais à l’incarner, sous forme d’un narrateur homodiégétique. C’est une autre manière de masquer le récit en tant que fiction, car le texte se livre alors comme la transcription sans filtre d’une parole de témoignage. Très fréquemment, c’est le personnage de l’enquêteur qui prend en charge la narration : enquêteur ne signifie pas nécessairement que l’on soit en présence des deux personnages les plus récurrents dans le roman noir, policier ou privé, et ne signifie pas non plus qu’il y ait une enquête de type criminel, mais simplement qu’on a affaire à une investigation et à une quête de quelque chose ou de quelqu’un. Le roman a recours à des artifices destinés à donner l’illusion que nous lisons un énoncé factuel. Le narrateur serait l’auteur du texte, sans se confondre avec l’auteur dont le nom est réellement inscrit sur la couverture, dans un procès d’énonciation non romanesque. C’est le cas dans le roman déjà cité de Thierry Jonquet, La Vie de ma mère ! :
J’ai fini, monsieur le juge. Vous m’avez demandé de tout dire sur la cassette avec le magnétophone, de bien prendre mon temps, style ça vous aiderait à mieux me connaître, j’ai bien pigé quand je suis venu dans votre bureau.
J’ai tout dit, je sais pas si j’ai bien expliqué avec les mots qu’il faut. J’espère que vous écouterez bien d’abord la face A avant la face B, sinon forcément vous allez être paumé. J’ai bien marqué sur le boîtier pour pas que vous vous gourriez. J’ai rien fait, monsieur le juge. La vérité, la reum à Clarisse, je l’ai même pas touchée ! La vie de ma mère si je mens ! (…) Maintenant j’arrête de causer, monsieur le juge, parce que de toute façon on arrive au bout de la cassette. (Jonquet, La Vie de ma mère, p.141-142)
Dans ces récits à narrateur homodiégétique, comme dans les récits à narrateur extradiégétique laissant une place à la subjectivité des personnages, tout est fait pour que le lecteur soit totalement immergé dans la fiction : la syntaxe, le lexique miment « l’oralité » supposée de ces pensées ou paroles, gomment autant qu’il est possible toute trace d’artifice littéraire. Les phrases non-verbales y sont fréquentes, l’ellipse ou la parataxe suggérant la spontanéité et l’absence d’élaboration de la pensée et de travail. On trouve des marques plus spécifiques d’oralité, même si, le plus souvent, ce sont des marques lacunaires d’oralité (qui ne sauraient transcrire tous les traits constitutifs de l’oralité), témoignant d’un registre différent de celui de l’écrit, a fortiori de l’écrit littéraire : absences de morphèmes de la négation, ellipse ou redoublement du sujet, entre autres. Le lexique quant à lui puise des ressources dans l’argot, dans un registre de langue courant voire familier ; là encore, il s’agit de mimer l’immédiateté de la pensée, de simuler l’absence d’artifice. Voici quelques exemples :
Y avait une banque du Crédit Lyonnais. Djamel il a mis la carte dans la machine, il a fait le code et ça a marché. Il a taxé trois mille balles, cool. (…) C’était pas un plan nul, de la thune, j’en avais jamais eu autant ! (Jonquet, La Vie de ma mère, p.45)
Sonia.
J’ignorais quelle tête pouvait avoir son assassin, mais c’était certainement une tête de mort. Tête de mort sur drap noir. Pavillon qui se hissait certaines nuits dans ma tête. Flottant libre, toujours impuni. Je voulais en finir avec ça. Au moins une fois. Une fois pour toutes.
Sonia.
Et merde ! Je m’étais promis d’aller voir son père, et son fils. Plutôt que d’aller boire des coups, je devais faire au moins ça ce soir. Le rencontrer. Lui et le petit Enzo. (Izzo, Solea, p.114-115)
Sans être des indices de non-fictionalité, soulignons que ces choix énonciatifs et linguistiques ancrent le texte dans une réalité extra-littéraire. Ce sont des modes de récit proches de récits factuels, de témoignages.
1.1.2.3. Motiver la représentation.
Parce que l’auteur de roman noir entend rendre visible le réel et délivrer au lecteur une information et des connaissances sur le monde, il doit avoir recours à des descriptions. Le roman noir ne saurait être qualifié de littérature descriptive, et privilégie toujours l’action. Toutefois, il ne peut faire l’économie de descriptions qu’il va alors s’attacher à motiver le plus possible. On retrouve dans le roman noir deux des scénarios descriptifs analysés par Philippe Hamon dans Introduction à l’analyse du descriptifNote712. , le scénario du « regard-descripteur », consistant à attribuer la responsabilité de la vision à un personnage placé dans des conditions qui l’obligent à observer, et éventuellement à analyser ce qu’il observe. Parce que les romans noirs sont peuplés d’enquêteurs et de personnages amenés à découvrir de nouveaux milieux, la description est très souvent prise en charge et médiatisée par ces regards. C’est le cas dans Total Khéops de Jean-Claude Izzo, où le personnage revient sur les lieux de sa jeunesse :
Il n’avait que son adresse. Rue des Pistoles, dans le Vieux Quartier. Cela faisait maintenant des années qu’il n’était pas venu à Marseille. Maintenant il n’avait plus le choix. On était le 2 juin, il pleuvait. Malgré la pluie, le taxi refusa de s’engager dans les ruelles. Il le déposa devant la Montée-des-Acoules. Plus d’une centaine de marches à gravir et un dédale de rues jusqu’à la rue des Pistoles. Le sol était jonché de sacs d’ordures éventrés et il s’élevait des rues une odeur âcre, mélange de pisse, d’humidité et de moisi. Seul grand changement, la rénovation avait gagné le quartier. Des maisons avaient été démolies. Les façades des autres étaient repeintes, en ocre et rose, avec des persiennes vertes ou bleues, à l’italienne. De la rue des Pistoles, peut-être l’une des plus étroites, il n’en restait plus que la moitié, le côté pair. L’autre avait été rasée, ainsi que les maisons de la rue Rodillat. À leur place, un parking. C’est ce qu’il vit en premier, en débouchant à l’angle de la rue du Refuge. Ici, les promoteurs semblaient avoir fait une pause. Les maisons étaient noirâtres, lépreuses, rongées par une végétation d’égoutNote713. .
On trouve également le scénario descriptif du travailleur-descripteur, qui permet à la description de se transformer en narration et de s’inscrire dans la linéarité de l’action. Dans le roman noir, il prend très souvent la forme du savoir technique et technologique de l’enquêteur et des différents corps de métier relatifs à l’investigation. Alors que chez Zola, la description passe par les gestes du mineur, du conducteur de locomotive, dans le roman noir, elle passe par les gestes des professionnels de l’enquête, par exemple sur les lieux d’une scène de crime. Dans cet extrait de Moloch, ce sont d’abord les officiers de police qui entrent sur la scène de crime, l’un d’entre eux, Di Meglio, se livrant à un geste professionnel, le dessin des lieux. Ce geste va motiver la description :
Il tira un calepin de sa poche, esquissa un plan grossier du séjour, de la cuisine, des toilettes, du petit couloir, en fait de simples rectangles qu’il agrémenta d’étoiles pour désigner l’emplacement des corps. Il se souvenait parfaitement du premier, à gauche en entrant. Les jambes étaient intactes, seuls le torse, la tête et les membres supérieurs avaient été atteints. Le second, au centre de la pièce, celui-là était totalement carboniséNote714. .
Dans Les Orpailleurs, la découverte du crime est suivie de la ronde de plusieurs professionnels, dont les gestes vont permettre de nouvelles descriptions. C’est tout d’abord le médecin légiste, puis les photographes :
Pluvinage était médecin légiste. La nature l’avait affligé d’une anosmie intégrale ; la plus extrême pestilence le laissait de marbre. Aussi étudia-t-il avec indifférence le corps étalé à ses pieds, sans toutefois le manipuler. De la pointe de son stylo – un vulgaire bic au capuchon copieusement mâchonné – il effleura la soie des bas sous laquelle pullulaient les insectes et remonta de la cuisse à l’entrejambe. (…) Il fut dérangé dans ses méditations par l’arrivée des photographes de l’Identité judiciaire alertés par Di Meglio. Ceux-ci se mirent à l’ouvrage avec une méticulosité exemplaire. Ils flashèrent abondamment les jambes, les cuisses ouvertes, sans oublier les chaussures, des hauts-talons au cuir très fin, moisi par le séjour dans le réduit, et qui gisaient sur le lino, à quelques centimètres des pieds de la morteNote715. .
Le geste professionnel permet de justifier la description, et par là-même, d’informer le lecteur.
1.2. D’une écriture réaliste à une écriture sociale.
Le roman noir, plus qu’une reproduction fidèle du réel, se donne comme un instrument de connaissance, de dévoilement et de décryptage, qui va chercher des causes profondes aux comportements des hommes. Comme dans tout roman réaliste selon Jacques Dubois, ces déterminations sont sociales et politiques. À cet égard, le critique propose de substituer à la notion de réel, trop vague, celle de social. De fait, le roman noir ne s’intéresse pas au réel dans toute son étendue et en tant qu’objet brut, mais aux causalités sociales et politiques qui sous-tendent le réel. Le roman noir rejoint l’acception du réalisme selon Brecht dans son essai Sur le réalisme : « Réaliste veut dire : qui dévoile la causalité complexe des rapports sociaux ». Ainsi que le souligne Jacques Dubois, « là où le réel était donné en tant qu’objet brut, le social présuppose un minimum de traitement ou de constructionNote716. ». Il propose d’utiliser la notion de socialité ainsi définie par Claude Duchet :
Tout ce qui manifeste dans le roman la présence hors du roman d’une société de référence et d’une pratique sociale, ce par quoi le roman s’affirme dépendant d’une réalité socio-historique antérieure et extérieure à lui, ses ancrages dans l’expérience réelle ou imaginaire que le lecteur a de cette sociétéNote717. .
Le roman noir est orienté par la vision du social qu’il entend proposer. On peut alors reprendre les propos de Jacques Dubois sur les romanciers du réel dans leur ensemble :
Ils ambitionnent de démonter les mécanismes cachés qui régissent le grand dispositif social et où, par exemple, les relations humaines s’expriment en rapports de domination abusifs et violentsNote718. .
Il faut néanmoins dégager plusieurs nuances dans cette écriture sociale, aussi bien dans le degré, qui va du simple témoignage à la parole militante, que dans les sphères d’analyse, pour lesquelles on peut convoquer la notion de sociogramme proposée par André Vanoncini dans sa synthèse sur le roman policier.
1.2.1. Les « sociogrammes » du roman noir.
André Vanoncini voit dans le roman noir « un témoignage sur la spécificité d’une communauté humaine, d’un espace urbain, d’un processus économique ou politiqueNote719. ». Il propose ainsi la notion de sociogramme, pour des romans dont l’enjeu essentiel selon lui est d’offrir au lecteur les éléments suivants :
étude sociologique d’un milieu, analyse idéologique des modes d’existence modernes, mise au jour des refoulements de la conscience historique d’une communauté, portrait psychopathologique d’une société aliénéeNote720. .
Ces quatre éléments, qui ne sont d’ailleurs pas exclusifs les uns des autres, permettent d’analyser bon nombre des romans du corpus. Sans souci d’exhaustivité, nous prendrons ici quelques exemples de romans illustrant chacun de ces aspects.
1.2.1.1. L’étude sociologique d’un milieu.
Le roman noir se déroule volontiers dans un milieu social ou professionnel précis, dont il entreprend de dévoiler les fonctionnements cachés, opaques, voire criminels. Les aspects sociologiques peuvent être évoqués à travers des personnages, qui incarnent un aspect précis d’une profession ou d’un groupe social ; mais c’est parfois à l’enquêteur qu’incombe la responsabilité d’établir les caractéristiques de ce groupe, soit qu’il en retrace le parcours (criminel, en l’occurrence) à partir d’indices et d’hypothèses, soit qu’il se contente d’observer les us et coutumes du milieu dans lequel son enquête le plonge.
Ainsi, Christian Lehmann, qui est médecin, entreprend dans La Tribu de relater une intrigue criminelle qui s’enracine dans le milieu médical, notamment hospitalier. Le roman dépeint les comportements des médecins, les difficultés qu’ils peuvent avoir à établir leur carrière à l’hôpital ou en cabinet, et les compromissions qu’ils sont parfois amenés à faire pour celle-ci. C’est plus généralement une démystification de la figure romanesque idéalisée du médecin qu’entreprend l’auteur, via les comportements de ses personnages mais aussi via leur propre regard sur eux-mêmes. Ainsi, le personnage principal, Olivier Rohan, est un jeune médecin établi en ville, qui continue à faire des gardes pour l’hôpital ou pour remplacer des collègues. Au cours d’une de ces soirées de garde, il est appelé par un autre confrère au chevet d’un jeune garçon victime d’un malaise cardiaque ; parce que ces collègues sont reconnus et puissants, parce qu’ils lui offrent une somme d’argent, il va se laisser compromettre et accepter que le garçon ne soit pas hospitalisé, ce qui va coûter la vie à ce dernier. L’intrigue repose sur les conséquences de cette compromission, mais le roman comporte d’autres scènes démystificatrices du milieu médical. Ainsi, sont évoquées les pratiques des laboratoires pharmaceutiques, qui mettent sur le marché des produits à l’efficacité non démontrée, et qui achètent les médecins par des cadeaux, escomptant ainsi que le produit soit prescrit, ou tout simplement testé, via les prescriptions :
Cinquante observations par personne, spécialement conçues pour vous causer un minimum de perte de temps. Il est même possible de ne les remplir qu’en fin de journée…
Et la rémunération, pour ceux qui ne choisissent pas le voyage…
C’est pourtant la formule la plus intéressante au plan fiscal. Mais vous pouvez aussi recevoir un chèque de 6000 francs pour votre participation à cette étude volontairement simplifiée.
Il me semble surtout que la simplicité de l’étude, comme vous dites, est surtout liée à l’absence de critères d’inclusion ou d’exclusion en début d’étude, et à une évaluation purement subjective de l’efficacité du produit. (…) J’ai l’impression qu’il s’agit surtout de nous inciter à prescrire Diffuveynil, moyennant paiement. (…) Vous vendez votre camelote comme si nous étions des gogos en train de jouer à La Roue de la Fortune. Je suis médecin, et avant de prescrire un produit, il faut que je sois persuadé de son inefficacité… je veux dire, de son efficacitéNote721. .
Un autre médecin incarne la corruption et le manquement à l’éthique professionnelle :
Il parcourut rapidement la fiche du prochain patient. Une femme de trente-cinq ans, d’un milieu modeste, très croyante, à qui il avait changé la pilule trois fois déjà depuis le début de l’année, créant ainsi un dérèglement hormonal et des règles très espacées. Elle était mûre cette fois. Il l’examinerait, la déclarerait enceinte, puis, contre l’assurance de sa discrétion et un dédommagement moral de quelque trois mille francs, lui ferait passer sa grossesse avec un court traitement de progestatifsNote722. .
Au-delà même de ces pratiques condamnables, le roman démystifie les pouvoirs des médecins, obligés de mentir pour masquer leur impuissance, comme l’explique Rohan à un externe :
Tu ne me juges pas, mais tu t’étais fait une idée de moi qui ne colle pas à la réalité, et soudain ça te gêne. Laisse-moi t’expliquer une chose : aucun des membres de la Tribu n’était innocent. Tu ne peux pas faire ce métier-là et rester pur. Tu es forcé de mentir pour atténuer la douleur des proches. Dites-moi, docteur… Il est mort sans souffrir ? Bien sûr, madame. Nous maîtrisons parfaitement la situation. La mort n’est qu’une escale technique sans importance, vous avez cent fois raison de nous confier vos agonisants… Ils bénéficient du dernier confort… Un jour, dans la foulée, tu mens pour te couvrir. Parce que personne à l’extérieur ne te pardonnera la moindre erreur, la moindre hésitationNote723. .
Dans les romans de Jean-Noël Blanc comme dans Du bruit sous le silence de Pascal Dessaint, l’enquête permet d’explorer des milieux sportifs. Pascal Dessaint entend montrer le monde du rugby dans toute sa réalité, sans toutefois dénoncer des pratiques frauduleuses. Il préfère analyser avec précision les rituels attachés à ce sport, comme l’avant-match :
Marc Aury avait évoqué l’accouchement et il était dans le vrai. L’image qui me revenait le plus souvent était également de cet ordre-là. Le vestiaire, d’une certaine façon, était un peu comme le ventre de la femme, un espace clos, un espace chaud. Le rugbyman est comme un acteur dans sa loge, avant d’entrer sur scène. Les arrières et les avants sont chacun dans leur coin. Ça sue la concentration et le trac. Chacun observe un rite précis. Chacun attend que le match commence. Chacun se rassure en répétant les mêmes gestes. Debout, un gros enduit ses oreilles et ses arcades de vaseline. Un autre, assis sur un banc, l’air absent, ceint son crâne cabossé d’un serre-tête. Un autre encore procède à des étirements et suçote son protège-dentsNote724. .
Dans Tir au but, Jean-Noël Blanc fait un portrait à charge du milieu du football et de ses compromissions, en construisant une intrigue autour du meurtre d’un gardien de but et d’une affaire de match truqué. L’enquête de Tavernier va révéler les manœuvres qui permettent de faire venir des joueurs réputés dans des clubs qui n’ont en réalité pas les moyens de les payer. Un dialogue entre l’enquêteur, Tavernier, et un journaliste, ici retranscrit en style indirect libre, permet au lecteur de cerner les pratiques illégales liées au foot :
Parce que c’était un des problèmes du recrutement en France, à en croire les clubs : ils se plaignaient de la fiscalité nationale qui rebutait selon eux les meilleurs joueurs mondiaux. Par conséquent, il fallait se débrouiller. Se débrouiller ? Par exemple ? Tavernier voulait des détails. Eh bien, par des dessous de table évidemment. Ou par des voies détournées. Par exemple en ne faisant pas payer le véritable loyer pour une maison luxueuse où on loge le joueur. Ou alors en lui accordant des prêts importants qu’en réalité on ne lui demandera jamais de rembourser. Ou en versant les primes exceptionnelles sur un compte discret situé dans un paradis fiscal. Ou autre chose encore, le sport professionnel n’est pas avare d’imaginationNote725. .
Dans Kop, Dominique Manotti peint elle aussi les agissements criminels du monde du football, utilisé pour blanchir de l’argent sale par des hommes politiques aux activités criminelles. Lavorel, l’un des personnages de policiers de Manotti, résume les choses ainsi, au terme de l’enquête :
Suivez-moi bien, patron. Delgado Bonilla donne cent millions d’argent noir à Reynaud, qui utilise cette somme pour son club, primes occultes aux joueurs, achat de joueurs adverses, d’arbitres et autres, ou pour son entreprise de bâtiment. La SBE se charge de rééquilibrer les transferts entre les deux comptes. À travers la mécanique des transferts de joueurs, Reynaud expédie dans divers clubs étrangers, disons pour simplifier, deux cents millions de francs qui sont à ce moment-là tout ce qu’il y a d’officiel, de propre. Ce n’est qu’un exemple, évidemment, les sommes réelles peuvent être plus ou moins importantes. Et les clubs étrangers, qui sont dans la combine, reversent cent millions dans des paradis fiscaux sous forme de commissions à des intermédiaires divers et variés, qui sont en fait Delgado Bonilla et ses commanditaires. Les transferts n’ont réellement coûté que cent millions, et ont permis de blanchir cent autres millions, qui représentent la somme versée en liquide par Delgado à Reynaud. Vous me suivezNote726. ?
Dans les deux cas, les pratiques illégales sont évoquées par un personnage, enquêteur ou journaliste, qui vise à rendre intelligibles les faits qui se sont déroulés, faits criminels qui en masquent d’autres, liés au système sportif et politique. Mais le roman de Dominique Manotti a également recours aux descriptions, utilisant le scénario du « regard-descripteur » (P.Hamon), pour peindre les matchs eux-mêmes et l’atmosphère des stades :
En débouchant sur les gradins, Daquin est carrément soufflé par le spectacle. Le stade est plein à craquer. Sur la pelouse, deux groupes d’une quarantaine de personnes chacun se sont alignés, de part et d’autre du terrain, près des buts. Ils portent en bandoulière de gros bidons métalliques, qui leur descendent jusqu’aux pieds, et tapent dessus en rythme avec des manches de hache. Tribune nord et virages sont peuplés d’une foule très colorée, où dominent, dans le plus grand désordre, l’orange et le vert, les couleurs du club. Par endroits, d’immenses banderoles verticales ont été déployées, peintes de portraits de guerriers sauvages, avec des couleurs contrastées, plates, des traits caricaturés, soulignés au noir, dans le style violent de certains graffeurs. SaisissantNote727. .
La romancière procède de même dans À nos chevaux !, explorant cette fois l’univers des courses hippiques, et dans Sombre sentier, où elle peint le quartier du Sentier, ses ateliers de confection, ses travailleurs clandestins et leurs luttes, via le regard d’officiers de police en filature :
2 passage de l’Industrie. Au pied de l’escalier obscur, une plaque : Bérican, deuxième droite. Odeur de cuir dans tout l’escalier. Au deuxième droite, derrière une porte classique d’appartement petit-bourgeois du dix-neuvième siècle, les bruits d’une intense activité, des voix, des pas, des ronflements de machines, une radio en langue étrangère dans le fond. (…) Arrivent deux Pakistanais avec leurs diables. Ils grimpent chez Berican, redescendent avec de volumineux ballots enveloppés dans du plastique blanc et fermés par du scotch marron. Trois aller et retour et les diables sont surchargés. Les Pakistanais foncent avec une dextérité remarquable à travers la foule qui encombre les trottoirs, les deux inspecteurs à leur suiteNote728. .
Quel que soit le procédé utilisé, il s’agit de motiver la description ou le récit à visée sociologique, en utilisant le prisme d’un personnage, dans sa caractérisation ou dans son regard d’enquêteur. Le lecteur est alors un double de ce protagoniste, il est informé en même temps, et par les mêmes voies, en quelque sorte, que lui.
1.2.1.2. L’analyse idéologique des modes d’existence modernes.
De nombreux critiques et certains auteurs considèrent que le genre du roman noir fournit des états précis de la société à un moment donné, et qu’il constitue une source d’informations exactes sur certains aspects de la civilisation urbain ou rurale. De fait, certains romanciers se livrent à une étude clinique du mode de vie d’un groupe social, dans un milieu donné. Ainsi, Romain Slocombe analyse dans Un été japonais le mode de vie des habitants de Tokyo à travers les tribulations de son personnage, Gilbert Woodbrooke. Des yakuzas aux lycéennes, le roman peint les mœurs nippones. Contrairement aux exemples précédents, l’analyse passe ici à la fois par le regard et les mésaventures du personnage, mais le narrateur homodiégétique s’autorise de véritables pauses explicatives sur les mœurs nippones, comme au début du chapitre 5, où il semble s’adresser au lecteur :
Le plus étrange pour nous Occidentaux est que les gangsters japonais ont pignon sur rue. Leurs bureaux ou immeubles affichent au-dessus de leur porte l’emblème ou le blason de la société, qu’on retrouve en insignes arborés au revers des vestes de leurs membres. Les gangs les plus importants, comme le Yamaguchi-gumi, publient leurs propres revues et journaux. En fait, héritiers d’une tradition de milices de quartier, de syndicats de joueurs et de colporteurs, ainsi que de quelques Robin des Bois des siècles derniers, tel le célèbre bandit d’honneur Chobei, les yakuzas se considèrent tout simplement comme des samouraïs en complet-veston. D’où leur rigoureux code d’honneur, incluant l’ablation d’un ou de plusieurs doigts en réparation de fautes commises, et la relation spécifiquement japonaise entre le parrain (oyabun) et son disciple (kobun) : l’oyabun garantit sécurité, conseils et protection, en échange de la loyauté et de la fidélité du kobunNote729. .
Mais plus généralement, c’est bien sûr la société française que peint le roman noir, à travers le regard de ses personnages. Le roman noir traverse des milieux variés, on l’a vu précédemment, mais il marque tout de même une prédilection pour certains modes de vie, comme celui des banlieues, résidentielles ou populaires, révélatrices de tous les dysfonctionnements de la société et des aliénations de l’individu. Hervé Prudon, auteur qui a débuté sous l’égide du néo-polar, prend pour cadre de Nadine Mouque un grand ensemble de banlieue, une cité délaissée par les pouvoirs publics, évoquée avec une affection très ambiguë par le narrateur :
Ce n’est pas tant que j’y sois bien, mais c’est chez moi, chez M’man, j’ai mes habitudes. Une certaine familiarité avec ce petit nulle part, cette nullité topographique. Une certaine bienveillance aussi, qui ne cherche pas de répondant, de remerciements. Les gens me plaisent bien, je les trouve plus vivants qu’ailleurs, bien qu’ici ça soit mortel à de nombreux points de vue. On s’ennuie beaucoup par exemple, mais ce n’est pas une névrose, une nécrose, cet ennui, c’est un vertige. Ce vertige, parfois, fait tomber une femme de son huitième étage, une autre d’un pont de chemin de fer, ou dans la Seine. Hier soir la télé marchait et j’entendais un voisin taper sur sa femme ou sa mère et un autre faire gémir ses conquêtes. Les bruits étaient un peu les mêmes, pour un amateur, mais à vivre ici on distingue bien les nuances, les intonations, les temps forts, les accents toniques, les soupirs musicaux. Sur la dalle, les gosses jouaient à la mort, en se lançant sur des caisses à savon sous les roues des voitures. Des gosses de six ou sept ansNote730. .
L’évocation du narrateur – un personnage de simplet – est très révélateur d’un mode de vie caractérisé par la mort, l’ennui, la violence, et les conduites à risque pour les jeunes.
À travers le dialogue de Confidences sur l’escalier, Pascale Fonteneau brosse elle aussi par petites touches le quotidien d’une cité, tandis que Jean-Paul Demure évoque son pendant petit-bourgeois, la résidence. Les personnages de Demure ont bien un patronyme, mais ils sont le plus souvent désignés par leur fonction dans la résidence, comme le Président ou l’Observateur, ou bien encore le Jardinier. Une scène de réunion des co-propriétaires est ainsi l’occasion de dresser le portrait des habitants :
Ainsi qu’à chaque réunion, il fut décidé de changer de syndic à la prochaine assemblée générale. Mme Alkirch entama alors son sujet favori : les enfants destructeurs de pelouse. Ne pourrait-on pas instaurer un système d’amendes ? Obliger le jardinier à imposer la discipline ? Des enfants de locataire, évidemment. (…) Mais il fallait compter avec l’ingénieur qui recommençait à exposer son projet de modification de la répartition des charges d’ascenseur en fonction de l’étage et pas des millièmes. (…) Le Président participait à tout ce bavardage avec beaucoup de complaisance. De jour comme de nuit, le Président soignait sa réélection. A sa petite échelle, il pratiquait le clientélisme : ne vous inquiétez pas, je m’en occupe, lançait-il pour un chat à enterrer, du gravier à répandre dans les allées, une canalisation bouchée, des débris à évacuer. Il disposait toujours d’un camion et d’une poignée d’immigrés qu’il surveillait de ses yeux froids. Chacun vantait son dévouement. L’Observateur ricanait depuis son balcon : Di Stampa est en campagneNote731. !
Obsession sécuritaire et autoritaire pour l’une, quête du pouvoir pour un autre, chacun est montré ici dans ses aliénations. La micro-société de la résidence représente l’ensemble de la société moderne et urbaine, aliénée jusqu’au meurtre. Rappelons que le milieu rural n’est pas oublié dans le roman noir, et que, loin de toute imagerie d’Epinal, il est décrit comme un milieu tout aussi étouffant et aliénant que les zones urbaines. C’est du moins ainsi que nous le dépeignent Jean-Paul Demure dans Fin de chasse ou Claude Amoz dans Le Caveau.
1.2.1.3. La mise au jour des refoulements de la conscience historique d’une communauté.
Au début des années 80, Didier Daeninckx avait fait une entrée remarquée dans le monde du polar, grâce à son roman Meurtres pour mémoire. Dans ce roman noir, un assassinat commis en 1981 permet de mettre à jour le passé d’un haut fonctionnaire de l’Etat, responsable de la déportation de juifs en 1942 puis d’un massacre de manifestants algériens en 1961. L’époque contemporaine, loin d’être un prétexte à l’évocation historique, est le point de départ et le révélateur d’une conscience historique enfouie, et contient les traces idéologiques de ce passé refoulé. En ce sens, l’Histoire permet de comprendre le présent et les crises politiques et sociales contemporaines, car les véritables responsabilités n’ont pas été établies et les coupables sont encore en poste dans les plus hautes sphères de l’Etat. Didier Daeninckx, sans l’inaugurer tout à fait, fait de cette veine noire un courant important du genre. Sans être particulièrement nombreux, les romans noirs qui empruntent leur sujet à l’Histoire sont nettement représentés dans le corpus. Les périodes privilégiées, on l’a vu précédemment, sont la Seconde guerre mondiale (la Collaboration, la spoliation des biens juifs et la déportation, les exécutions sommaires de la Libération, les conversions à la Résistance tardives et opportunistes), la guerre d’Algérie (répression en France, exactions en Algérie). Plus qu’à une recension des événements historiques rappelés, ce sont les moyens de les traiter qui retiendront notre attention ici. Sachant que le passé est toujours évoqué à partir d’un point d’ancrage contemporain à la date de publication du roman, sachant aussi que le passé est exhumé en tant qu’il éclaire le présent, comment le roman noir intègre-t-il à la diégèse le récit des événements passés ? Dans tous les cas, les événements « actuels », sous la forme de crimes généralement, amènent à remonter la piste d’événements bien plus anciens, et à trouver des causalités dans des faits historiques qui eux-mêmes constituent des transgressions de l’ordre moral, éthique, le plus souvent même des crimes.
Les romans de notre corpus offrent deux grands modes de traitement de l’Histoire. Dans un premier cas, les événements du passé sont totalement intégrés à la diégèse. Ils apparaissent sous forme de récits pris en charge par des personnages, à l’occasion de confessions (directes, ou enregistrées), d’interrogatoires, voire de simples conversations. C’est le cas dans L’Ancien crime, où un crime permet à l’enquêteur de remonter jusqu’à la période de l’Occupation et à ses secrets enfouis :
Dans ce cas, il y a deux pistes. Soit une ancienne victime, chez qui la petite annonce aurait réveillé un désir de vengeance, soit un ancien complice, qui n’aurait pas été inquiété à la Libération et qui aurait fait ensuite une belle carrière : ces allusions à l’hypocrisie, à des masques à arracher, ont pu être perçues comme autant de menaces. La clé se trouve donc dans le passéNote732. .
Il est question dans ce roman de collaboration, de dénonciation, de revirements de dernière minute vers la résistance. C’est aussi le cas dans Les Orpailleurs, de Thierry Jonquet, dont les personnages, Nadia Lintz, Maurice Rosenfeld et Isy Szalcman sont les médiateurs de l’Histoire. Le dernier est un vieil homme qui a connu la déportation, et la première est une jeune juge d’instruction qui a découvert que son père était impliqué dans la spoliation des biens juifs pendant l’Occupation. L’intrigue criminelle elle-même permet de faire ressurgir ce passé, qui va ramener les protagonistes à Auschwitz : une bague offerte par Rosenfeld qui appartenait à l’une des déportées a ressurgi à Paris. Mais c’est toujours le récit fait par les personnages eux-mêmes qui met à jour pour le lecteur les faits passés ; ainsi, Nadia Lintz confesse à l’inspecteur Rovère le passé trouble de son père, et Isy relate l’histoire de la bague aux pieds du corps de Maurice.
Dans Treize reste raide, de René Merle, il est également question de l’Occupation, et plus largement de l’évolution de l’extrême droite dans l’entre-deux guerres. Le passé, ressurgissant à l’occasion d’une série de meurtres commis sur les vieillards, est évoqué à travers les dialogues des personnages, pour l’essentiel, et via les récits obtenus par un journaliste et un historien, comme dans ce passage :
Il sort les cassettes de Manzani. L’historien a mis des étiquettes : « Les débuts », « Front populaire », « La guerre », etc. Il met la première. Au début, les cafouillages habituels, silences, hésitations. Après, Manzani se lance. L’accent corse pointe plus fort dans l’enregistrement que dans le souvenir qu’en avait Laugier. (…) Manzani se raconte, il pèse ses mots. « Je suis arrivé du village en 25, j’avais seize ans. J’avais des parents derrière le Boulevard de Paris, à la Joliette.
Suit le récit d’un itinéraire politique dans la période mouvementée de l’entre-deux guerres, qui est l’occasion de révélations pour le personnage du journaliste :
« Mais j’ai quitté Sabiani en 30, quand il est devenu évident qu’il était financé par les armateurs. L’équipe a éclaté. Je suis passé tout naturellement au P.C. Je peux vous dire qu’on m’a retrouvé aux premières loges contre Sabiani. Oui, l’équipe, c’est parti dans tous les sens. En fait, y en a peu qui sont restés. Mais le plus terrible, c’est qu’il y a eu des collègues, comme Lanfranci, qui l’ont suivi jusqu’à la Gestapo… » Fin de la première cassette. Laugier ne s’était jamais imaginé Manzani avec Sabiani, à vrai dire il ne connaissait pas la périodeNote733. .
Didier Daeninckx procède de manière quelque peu différente, continuant de mettre à jour les responsabilités historiques dans les deux Poulpe qui figurent dans le corpus, Nazis dans le métro et Ethique en toc. Les deux romans évoquent le négationnisme et le révisionnisme ; mais s’il utilise des récits de personnages pour retracer le passé, il se sert aussi beaucoup d’extraits de presse, instruments de l’enquête du Poulpe, ou d’extraits d’ouvrages.
Le second procédé consiste à alterner les niveaux temporels en superposant au récit « actuel » le récit du passé. Dans La Nuit des bras cassés de Maurice Gouiran, il est question, à travers une série de meurtres, de la spoliation des biens juifs. Le récit est construit sur une alternance entre les époques, puisque sur les vingt-huit chapitres qui composent le roman, cinq prennent place pendant la seconde guerre mondiale ou juste après. Dans Le Pied-Rouge, François Muratet alterne deux récits : l’un, au passé simple et à l’imparfait, se déroule en 1997, l’autre, au présent de narration, se déroule dans les années 60 et 70. De même, à partir de la page 219, on lit également le récit de Max, qui relate sa désertion pendant la guerre d’Algérie, et son passage dans les rangs de l’ALN en Tunisie :
C’était le moment de lire la disquette de Max. Il ouvrit le fichier « Souvenirs ». Le texte avait pour titre « Au FLN ».
« Pourquoi j’ai déserté ? J’ai longtemps cru que c’était le hasard qui m’avait poussé à quitter l’armée, à « trahir ». Et puis, maintenant je crois que j’y pensais depuis longtemps mais que je ne savais pas comment faire. J’attendais une occasion. Il fallait qu’on me pousse au cul et l’armée m’a aidé sans le vouloir. (…) C’était en juillet 1959. J’étais démoralisé depuis la mort de Jean-Pierre et de Christian dans une embuscade un mois auparavantNote734. . »
Se mêlent dans le roman la guerre d’Algérie et le passé gauchiste du personnage de Frédéric, car Max, après son engagement dans l’ALN en Tunisie, s’engagera dans les mouvements gauchistes, où il fera la rencontre du personnage principal, qui va enquêter sur sa mort et ainsi, remonter à son propre passé de lutte et à la guerre d’Algérie.
La Nuit apache de Patrick Mosconi représente un cas hybride. Le passé revient également par bribes, dans les dialogues des personnages, à l’occasion d’informations glanées dans la presse, mais l’essentiel se trouve dans le journal de Salina, reproduit intégralement. Cette chronique narrative ne se situe pas à un autre niveau temporel, mais dans une temporalité décrochée, propose le récit des événements passés. La narration homodiégétique laisse donc place, à mi-roman, au journal intime de la jeune femme :
Lundi 28 juillet.
Plus d’une semaine que je joue au rat de bibliothèque. Je veux me faire une idée de l’époque avant de chercher les traces de mon père. La guerre d’Algérie entre par les mots dans mon histoire, je pense à Camus. Quelle absurdité tout ce sang. Et maintenant, quand je vois la révolte des enfants, je me dis que ce sont toujours les mêmes qui meurent. Mon père était un bandit, il avait rejoint le FLN en 1960. Je suis née la même année, en FranceNote735. .
Dans tous les cas de figure, il y a délégation de parole ; le récit intègre en son sein un autre récit ; il n’est pas de roman noir dans le corpus qui se livre à un récit de type historique non motivé (par une confession, un projet de livre de personnage). Ce sont les événements de la diégèse eux-mêmes qui amènent ces récits historiques.
1.2.1.4. Le portrait psychopathologique d’une société aliénée.
André Vanoncini ne s’explique pas sur ce qu’il entend par là, aussi sommes-nous obligée d’interpréter cette proposition. Les déviances et pathologies criminelles sont légion dans le roman noir, mais si certaines figures de meurtriers sont particulièrement monstrueuses, il est rare que le romancier ne livre pas une explication de leur folie qui, loin d’en faire des êtres intrinsèquement et irrémédiablement mauvais, en fait des victimes d’une société aliénante et violente. Le meurtre serait donc l’expression paroxystique d’une révolte, ou tout simplement la conséquence des aliénations du monde moderne, l’aliénation mentale étant la conséquence et le stade ultime des aliénations sociales. Ainsi, de nombreux romans évoquent des meurtriers poussés au crime par un passé de victime, ou pour défendre une victime : Un été pourri de Maud Tabachnik, Le crapaud qui fume de Serge Scotto, Moloch de Thierry Jonquet, Fils de femme d’Hélène Couturier, Debout les morts de Fred Vargas, La Tendresse du loup de Jean-Pierre Bastid, Une chauve-souris dans le grenier de Stéphanie Benson, entre autres. Dans tous ces romans, un traumatisme d’enfance ou la nécessité de protéger un enfant poussent les personnages au crime. Les faits appartenant au passé sont généralement révélés vers la fin du roman, via la confession du meurtrier, un document qu’il a laissé (un journal intime, comme dans Fils de femme), ou les hypothèses de l’enquêteur (Un été pourri). Les aliénations sont ici familiales, le roman noir démystifiant l’institution familiale, qui est loin d’être le foyer protecteur qu’il prétend être : lieu d’inceste, de violence, la famille occasionne des traumatismes violents, menant au meurtre.
Mais dans certains romans, la société et ses leurres sont plus généralement générateurs d’une violence pathologique, car la société secrète une violence symbolique que le roman noir va exprimer en butalité meurtrière. Il en va ainsi de Parcours fléché, de Jean-Pierre Bastid, dans lequel des employés et des cadres se réfugient en Sologne où ils se déguisent en Indiens et adoptent leur mode de vie. Mais le jeu régressif et jubilatoire va bientôt se transformer en une attitude radicale de refus de la société capitaliste, comme en atteste le journal d’un personnage :
Avant, la terre était à tous pour que chacun en use à sa convenance ; maintenant on l’a divisée et on continue de la diviser de plus en plus, nous enfermant dans des boîtes de plus en plus petites, nous divisant nous-mêmes, nous séparant, fragmentant nos tâches, émiettant, morcelant, partageant nos connaissances, coupant en tranches travail, repos, loisirs, tronçonnant et dissociant jeux et plaisirs, séparant, nommant et étiquetant tout, construisant des casiers partout – à commencer dans nos têtes. A présent, tout s’achète et tout se vendNote736. .
Un refus aussi radical va pousser les Indiens à agir hors la loi et à basculer dans le crime, ce qui ne peut, en retour, que les condamner. Néanmoins, le roman se refuse à sceller leur sort, et se termine sur un affrontement entre forces de l’ordre et Indiens dont le lecteur ne connaît pas l’issue.
La mise en cause est tout aussi virulente dans Chasseurs de têtes de Michel Crespy. Le personnage principal est un cadre supérieur au chômage qui va, à l’initiative d’un cabinet de reclassement, partir pour un stage et participer à un jeu de rôles : il s’agit de montrer ses capacités à travailler en équipe sur des projets professionnels virtuels. Mais très vite, les équipes sont mises en compétition, et la lutte révèle les pulsions criminelles de certains membres, prêts à tout pour réussir. Michel Crespy prend en quelque sorte le vocabulaire de la compétition professionnelle au pied de la lettre : on chasse des têtes littéralement, on élimine physiquement des concurrents, on se révèle être un « killer »… La situation de compétition sert donc de révélateur aux pulsions meurtrières générées par la société libérale et capitaliste et par l’individualisme, ainsi que le dit le narrateur dans les dernières pages du récit :
Je n’ai pas réfléchi à ce qui allait se passer maintenant. Je pourrais poser mon arme et redescendre gentiment. Vers le lac, vers la civilisation, les major companies, les affrontements feutrés mais tout aussi meurtriers. Cet endroit où l’on ne tue que symboliquement, où l’on a droit à tout sauf aux dommages physiques apparents. Oui, je pourrais… Ou peut-être que je ne pourrais pas. Je n’envie pas la place du juge d’instruction qu’ils vont désigner. Il va devoir faire le tri entre les victimes et les assassins. C’est, de nos jours, une chose horriblement délicate. À moins que nous ne plaidions tous la folie. Mais comment plaider la folie dans un monde qui est devenu fou ? Nous sommes simplement, les uns et les autres, allés jusqu’au bout de nous-mêmesNote737. .
Le roman noir n’a pas seulement pour toile de fond la société moderne et capitaliste, il en est une analyse, en même temps qu’une prise de position très critique sur ce que cette organisation sociale engendre, c’est-à-dire l’inhumanité et le crime.
Toutefois, si le roman noir analyse ces aspects en utilisant des procédés divers de l’écriture réaliste, la visée n’est pas systématiquement la même, et là où certains auteurs entendent dénoncer, d’autres se contentent de témoigner ou tout simplement, de proposer un regard sombre sur le réel. Ainsi, les postures d’écrivain vont s’exprimer de manière différente, tout en étant dans tous les cas le substrat de l’écriture réaliste.
1.2.2. Du réalisme critique à l’engagement : postures d’écrivain.
« Témoigner » : ce verbe revient fréquemment, à la fois sous la plume des auteurs de romans noirs qui évoquent l’ambition de leurs textes et sous celle des critiques analystes du genre. Les auteurs revendiquent cette fonction de témoignage critique, comme Lakhdar Belaïd qui voit dans le genre le moyen de proposer « une analyse à la fois politique et sociologiqueNote738. », ou Pascal Dessaint qui lui donne « un rôle de vigile, d’alerte », porté par « une forme d’engagement, un témoignage, une volonté d’indignationNote739. ». Christian Lehmann exprime le même engagement dans le réel :
C’est ma tentative pour comprendre notre condition. J’ajouterai que le roman noir est l’un des rares endroits où la critique peut s’exprimer, où l’on peut réfléchir sur les enjeux de pouvoir qui écrasent l’humainNote740. .
Paul Borrelli affirme ainsi que « le roman noir dénonce, masqué ou non, sur la place publique les prévarications, les magouilles, les affaires véreuses, le racisme et autres tares d’une société qui se veut démocratique mais se montre surtout démagogiqueNote741. . » Jean-Hugues Oppel entend « témoigner, pousser des coups de gueuleNote742. », Michel Steiner parle de « dénoncer par [la] fiction quelque chose qui ne va pasNote743. ».
De fait, certains auteurs vont faire du roman noir le support d’un témoignage social, un décryptage de la réalité qui, pour être teinté de subjectivité, n’en est pas moins indépendant de toute visée militante. Le roman noir témoigne de l’état de dégradation de la société, apporte un supplément d’informations et de connaissances sur elle, sur ses dysfonctionnements et leurs causes.
D’autres vont aller plus loin et proposer une analyse critique de cette société sous l’angle des rapports de domination et de violence. Le roman noir est alors une parole de révolte, qui dénonce en désignant les responsables. Il peut se faire alors acte militant, et prendre la forme du roman à thèse. La dénonciation se teinte d’engagement politique, social, comme chez Didier Daeninckx qui apprécie que le genre soit une « écriture de la révolteNote744. », ou chez Jean Vautrin, pour qui cet aspect du genre est essentiel :
La littérature noire ne convaincra qu’avec ses poings. (…) Se plonger dans le blême, c’est pour moi un moyen d’aborder une littérature engagée qui prend parti sans jamais être didactique, de renouer avec une mythologie tenace qui a enchanté ma jeunesse et c’est aussi une attitude rebelle qui consiste à combattre les faux nez de la respectabilité par le biais d’un espace d’irrévérence, de contestation et d’humour sans condescendanceNote745. .
Une troisième conception du réalisme se marque par le refus de l’engagement au sens de parti-pris marqué idéologiquement, et par la simple revendication d’un regard subjectif porté sur le réel, un regard « noir ». Trois auteurs parlent de ce regard sombre porté sur la réalité. La subjectivité est paradoxale, car pour autant, chacun d’eux prétend dire la vérité sur le monde : sa vérité est d’être sombre, voilà tout. Philippe Carrese convoque ainsi à plusieurs reprises l’adjectif « noir » pour désigner ses romans, les histoires qu’il raconte, tandis que Chantal Pelletier revendique la coloration noire de sa « réinterprétation un peu délirante de la réalitéNote746. ». Surtout, Stéphanie Benson, sans dénier au genre l’engagement social qu’il représente, met en avant l’expression d’un regard noir :
C’est plus une manière de voir le monde. Le roman noir, c’est vraiment ça. On regarde le monde du « côté obscur de la force »Note747. .
Par le roman noir, les auteurs peuvent faire un acte de désengagement de la sphère du militantisme, vue comme source de déceptions et de désillusions. Dans ce cas, le genre est un espace d’expression du désenchantement né de la désillusion de l’après mai 68 et des années Mitterrand. Si quelques auteurs échappent à cette catégorisation, n’ayant pour but que de divertir, la plupart entrent dans l’une ou l’autre de ces trois catégories.
Le constat, commun aux trois postures, que la société capitaliste engendre la destruction des valeurs humanistes et par conséquent, de l’humain, amène à une autre observation, en forme de paradoxe. Le roman noir n’a d’autre fonction que de rendre visibles les vérités enfouies, les « racines du mal », sans pour autant faire disparaître le mal lui-même. Autrement dit, toute rédemption et toute réconciliation avec la société semblent impossibles ; le seul espoir exprimé n’est pas celui de faire changer les choses, mais simplement d’établir la vérité. Ainsi, faire changer les choses est bien le souhait premier, mais au final, seul subsiste l’espoir de faire surgir la vérité. L’absence d’illusion est résumée laconiquement par Hugues Pagan dans l’entretien accordé à la revue Mouvements : « Il faut savoir qu’on est dans la merde et qu’on n’en sortira pas. » Cela ne l’empêche d’ailleurs pas de clore l’entretien par ces mots : « Continuons le combat ! Eh bien ! on continueNote748. . »
Les auteurs de roman noir sont mal à l’aise avec la notion d’engagement, qui semble pourtant s’imposer à la lecture de leurs romans. Plus largement, la question du réalisme n’est pas sans paradoxes, tant le regard sur le réel semble marqué par une vision sociale qui semble peu compatible avec l’exigence d’objectivité du projet réaliste. Ainsi, le discours réaliste, en cette fin de 20ème siècle, semble chargé d’ambiguïtés.
1.3. Paradoxes et impasses du réalisme : roman noir et doxa.
Selon Jacques Dubois, le texte réaliste se construit comme un contre-savoir, dont l’enjeu est de révéler ce que la doxa cache. Il poursuit son analyse en montrant que dans le roman réaliste du 19ème siècle, ce contre-savoir peut avoir trait à la sexualité. Dans le roman noir français, cette volonté de dévoiler ne fait aucun doute, mais le savoir construit touche la plupart du temps au social et à l’idéologique, dans divers domaines, comme on l’a vu. À première vue, le roman noir établirait donc une saisie du monde et de la société originale, loin de la doxa. Cependant, dans la mesure où les auteurs présentent un certain nombre de traits communs dans leur parcours, dans leurs positions idéologiques, dans leur conception du genre comme engagé, n’y a-t-il pas dans ce contre-savoir une nouvelle doxa ?
1.3.1. Le roman noir, phénomène de reconversion militante ?
Annie Collovald a analysé dans divers travauxNote749. le polar des années 80 et 90 comme phénomène de reconversion militante. À la suite de Sylvie Tissot dans l’article introductif à l’ouvrage collectif Reconversions militantes, paru en 2005Note750. , on peut définir la reconversion militante comme un passage ou une rupture d’une posture politique militante à une autre posture, qui peut être elle aussi politique, mais aussi économique, morale, professionnelle, artistique. Cela peut correspondre au franchissement de la distance entre deux pôles opposés du champ politique, au déplacement dans l’espace social vers d’autres champs professionnels, ou bien encore à un retrait pur et simple du militantisme. Sylvie Tissot le note toutefois :
Certaines activités professionnelles ou professionnalisées restent empreintes d’un registre militant tantôt revendiqué, tantôt euphémisé, en tout cas redéfiniNote751. .
C’est justement ce que montre Annie Collovald, à propos du roman noir, dans sa contribution « Reconversion et gestion des fidélités : le cas des polars françaisNote752. ». Selon elle, le polar (elle emploie en effet ce terme, plus large que la locution « roman noir ») des années 80 et 90 exprime un rejet de la politique, dans une vision désenchantée et une posture critique paradoxale :
Elle conserve malgré tout une part d’enchantement que certains auteurs trouvent dans la dignité préservée des plus démunis et de leurs défenseurs et que d’autres, parfois les mêmes, retirent des déroutes politiques de leurs anciens adversairesNote753. .
La reconversion s’est faite sans heurt, dans la mesure où le polar s’était orienté, avec le néopolar, vers une réflexion axée sur le monde social contemporain. Autrement dit, même lorsque le passage vers le roman noir correspond à un abandon des anciennes activités militantes, la reconversion se fait sans difficulté. Les auteurs vont même pouvoir, qu’ils considèrent le roman noir comme un nouvel espace de militantisme ou comme la suite de leur activité militante, réinvestir des « savoirs et savoir-faire issus du gauchisme », comme le « goût de l’enquête et du démontage de l’histoire officielle », la « dénonciation des compromissionsNote754. », entre autres. Ainsi, le roman noir représente un déplacement et un décentrement de l’activité militante :
L’esprit gauchiste est en quelque sorte redéfini : leur récit et leur activité d’écrivain constituent (ils le disent et y insistent) une forme d’action sociale et politique « en soi » qui vise non pas à agir sur le public de leurs lecteurs mais à témoigner publiquement de la dégradation de la sociétéNote755. .
Cependant, Annie Collovald fonde ses analyses plus particulièrement sur cinq romanciers. Qu’en est-il des soixante-dix auteurs du corpus ? De même qu’avait été observé un « éclatement » de leur profil sociologique sur de nombreux points, on ne peut qu’observer la disparité en termes d’engagement militant de ces écrivains, comparativement à la génération immédiatement précédente. D’après les déclarations que nous avons pu recueillir, douze auteurs, soit 17,14%, indiquent qu’ils ont connu un engagement politique. Certains restent volontairement flous, comme Yves Buin, qui déclare avoir eu « une période engagée (…) du côté des révolutionnaires », dont il reste « une fidélité à la rébellion », Maurice G.Dantec, qui affirme avoir milité dans « des groupuscules gauchistes », Frédérik Houdaer, qui dit avoir été engagé dans des mouvements associatifs. Les autres sont plus précis, et reconnaissent des appartenances à des mouvements gauchistes ou à des syndicats ancrés à gauche : c’est le cas de Didier Daeninckx, de Jean-Claude Izzo, de Thierry Jonquet, de Dominique Manotti, de François Muratet, de Serge Quadruppani, de Patrick Raynal et de Romain Slocombe. Il faut ajouter le cas de Jean-Bernard Pouy, qui s’exprime en faveur des thèses libertaires.
On peut toutefois ajouter à ces militants les auteurs qui par leur activité professionnelle sont amenés à s’engager ou tout au moins sont enclins à proposer une vision sociale dans leurs romans. Ce sont les journalistes (sachant que tous disent avoir eu une période de journaliste d’investigation, ou de chroniqueur judiciaire) et les travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés). Enfin, certains déclarent une sensibilité politique identifiée à gauche ou dans les mouvances libertaires, sans que l’on puisse déterminer si cela s’accompagne d’un engagement auprès d’un mouvement politique ou associatif. Si l’on prend en compte ces deux catégories, ce sont au total 35,70% des auteurs qui sont marqués idéologiquement ou l’ont été, sachant que dans tous les cas, ce marquage idéologique est de gauche, ou du moins trahit une préoccupation sociale. Cela reste peu, et sans avoir de chiffres de comparaison, on peut émettre l’hypothèse que c’est moins qu’à la période du néopolar. Quoi qu’il en soit, pour 17,14% des auteurs, le roman noir apparaît comme un phénomène de reconversion militante. En outre, de très nombreux romans montrent une préoccupation sociale et politique, car au-delà même de la notion d’engagement, les auteurs de romans noirs se retrouvent pour leur grande majorité autour de valeurs et de refus communs. Si certains continuent à revendiquer une posture politique, d’autres ont évolué, dans leur conception même du genre ou au moment de leur passage au roman noir, vers une posture éthique. Aux engagements et à la politisation clairement affichée aurait succédé une préoccupation sociale et morale les instaurant en gardiens de valeurs que défend le genre. Reste à savoir quels sont ces valeurs et refus communs.
1.3.2. Des valeurs et des refus communs.
De fait, on peut repérer dans un grand nombre de romans du corpus des prises de position idéologiques, politiques, qui sont à lire à la fois comme des héritages du néopolar et comme des actes d’opposition à certains mouvements d’idées des années 1990-2000.
Environ 60% des romans du corpus font apparaître, de manière plus ou moins ponctuelle et explicite, un refus vis-à-vis de valeurs ou la dénonciation de faits de criminalité, de corruption des institutions. Mais dans 37 % des romans du corpus seulement, on repère de manière forte, comme une dominante dans le texte, l’adhésion aux valeurs suivantesNote756. :
le rejet du racisme et des valeurs de l’extrême-droite – voire de la droite.
la valorisation de la figure de l’immigré.
le rejet des institutions et du pouvoir, en particulier du pouvoir politique, et des contre-valeurs qui lui sont associées (ambition aveugle, corruption, cupidité, mépris du peuple, etc.).
l’exaltation des valeurs de l’amitié, de la fraternité, associées aux milieux populaires.
une valorisation nostalgique d’un passé antérieur à la crise économique, en tant que période facilitant les valeurs positives précédemment mentionnées.
Cela va déboucher sur un certain nombre de stéréotypes : victimisation des dominés (immigrés, femmes, entre autres), schématisation des oppresseurs et représentants des idéologies rejetées.
Le roman noir des années 90 survient dans le contexte du désenchantement qui succède à l’accès au pouvoir du parti socialiste et de la montée de l’extrême-droite. Les valeurs de l’extrême-droite sont fréquemment mises en cause dans le roman noir, et les tenants des thèses racistes sont fréquemment évoqués, à travers la figure du « beauf » et celle du bourgeois, comme dans ces extraits :
J’ai pas insisté parce que GilbertNote757. , de toute façon, il finira toujours par avoir raison, et avec des arguments imparables du type : les Arabes dans un bateau et les chômeurs à la mine. Et comme s’énerver n’est pas très bon pour la tension et pour la paix des ménages… OK, Gilbert… On va tous les virer !… Et aussi les Arabes… Et les juifs, si tu veux, Gilbert… Et les francs-maçons aussi Gilbert, si tu veux, comme tu veux… Il va plus rester grand monde pour discuter avec, mais tant mieux, il y aura toujours la famille, et ça, ça rassureNote758. …
Il était là à cause de la fille, et il allait rencontrer la mère. De près, elle avait une tête un peu anguleuse, avec un grand front, un peu Giscard d’Estaing avec une perruque. Le teint pâle, pas de maquillage. Des grands yeux clairs même pas cernés. La dignité à l’épreuve de la rouille. Derrière elle, passant la porte vitrée, un jeune homme, en ciré noir, qui aurait pu figurer dans un film sur la Gestapo, cheveu très court, teint rose, joues de poupon, œil allumé, un carnet noir sous le bras, apparut comme par enchantementNote759. .
-Le chef du rayon charcuterie, il m’avait dénoncé.
-L’enculé !
-Des enculés, c’en est plein. C’est les mêmes qui supportent pas les Nègres, les ArabesNote760. .
Tous leurs traits étaient mous. Dans leurs yeux, fuyants, aucune lueur de révolte. Des aigris de naissance. Ils n’auront de haine que pour plus pauvre qu’eux. Et tous ceux qui boufferont leur pain. Arabes, Noirs, Jaunes. Jamais contre les riches. On savait déjà ce qu’ils seraient. Peu de chose. Dans le meilleur des cas, les garçons chauffeurs de taxi, comme papa. Et la fille, shampouineuse. Ou vendeuse à Prisunic. Des Français moyens. Des citoyens de la peurNote761. .
Les cas de figure cités sont certes différents. Dans le premier extrait, le narrateur rapporte ses propres propos, qui reprennent ironiquement ceux de Gilbert, cacou marseillais raciste ; dans le deuxième extrait, le portrait de la grande bourgeoise est d’emblée connoté négativement (comparaison avec Giscard d’Estaing, donc des traits masculins appliqués à une femme), et celui de son compagnon, à cause du ciré noir et des cheveux très courts, apporte une évocation du nazisme. Dans le troisième extrait, à travers un personnage sympathique – un vigile malgache offrant l’hospitalité à Rico sur son lieu de travail – on voit la généralisation du discours, la définition par le personnage du racisme et du fascisme à partir d’un trait négatif, la délation, et la généralisation à partir d’un personnage à tout un groupe. Enfin, dans le dernier extrait, le narrateur de Jean-Claude Izzo tend à généraliser en octroyant aux catégories populaires des opinions racistes, comme si la dévalorisation économique entraînait automatiquement le rejet de l’immigré. Précisons que l’évocation s’appuie sur un personnage, interrogé par Fabio Montale, un chauffeur de taxi, qui donne lieu à ce discours généralisant (utilisation du pluriel).
Ce rejet du racisme et des valeurs d’extrême-droite n’est pas seulement affecté à des catégories sociales, mais va aussi s’incarner dans des personnages de policier, dans une revisitation du duo « flic positif / flic pourri ». Le policier négatif est raciste, corrompu (à la solde des puissants, le plus souvent), méprisant envers les gens qui souffrent, alors que le bon flic (généralement le personnage principal) va opposer des valeurs humanistes et une empathie qui le condamnent souvent auprès de sa hiérarchie :
Moi aussi, tout comme eux, à ma petite mesure, je m’étais battu dans mon coin sans relâche pour le perfectionnement intellectuel et moral et pour le progrès de l’humanité. Je m’étais battu, sans doute pas très bien, pour que des gosses – les leurs, les miens, ceux de tout le monde – cessent de se piquer et de crever de surdose, pour que les promoteurs immobiliers cessent de faire griller des vieilles dans les immeubles qu’ils convoitent, pour qu’on arrête de traiter les blacks, les biques, les basanés et ceux qui n’ont pas eu de chance comme des chiens. Moi aussi je m’étais battu pour un monde plus juste et plus fraternel, jour après jour, nuit après nuit. Bien sûr que ça n’était pas raisonnable, mais je n’avais jamais été raisonnable, seulement fidèle autant que je l’avais pu à la devise de mon ordre. J’avais rêvé d’un monde où les flics cesseraient de faire des pipes aux gros et aux riches, et de latter les pauvres et les laissés-pour-compte, où les commissaires ne se sucreraient plus sur les expulsions et les vacations funéraires… J’avais rêvéNote762. …
Dès les premiers jours, ce fut la guerre entre Pertin et moi. « Dans ces quartiers d’Arabes, répétait-il, il y a qu’une chose qui marche, la force. » C’était son credo. Il l’avait appliqué à la lettre pendant des années. « Les Beurs, t’en chopes un de temps à autre, et tu le passes à tabac dans une carrière déserte. Y a toujours une connerie qu’ils ont faite, et que t’ignores. Tu tapes, et t’es sûr qu’elle saura pourquoi, cette vermine. Ça vaut tous les contrôles d’identité. Ça t’évite la paperasserie au commissariat. Et ça te calme les nerfs que ces crouilles t’ont foutu. » (…) Toute mon action, chaque jour, lui démontra qu’il se trompait. Même si, moi aussi, je me trompais plus souvent qu’à mon tour, à trop vouloir temporiser, concilier. À trop vouloir comprendre l’incompréhensible. La misère et le désespoir. Sans doute, je n’étais pas assez flic. C’est ce que m’expliquèrent mes chefsNote763. .
[Pertin] n’était que le symbole d’une police que je vomissais. Celle où l’on fait passer ses idées politiques ou ses ambitions personnelles avant les valeurs républicaines. La justice. L’égalité. Des Pertin, il y en avait des tonnes. Prêts à tout. Si un jour les banlieues explosaient, c’est à eux qu’on le devrait. À leur mépris. À leur xénophobie. À leur haineNote764. .
Le politicien, représentant quasi systématiquement la corruption, la compromission, voire l’incarnation des valeurs d’extrême droite dans de nombreux cas, est également dévalorisé. Pierre Jérôme situe ainsi son roman dans les milieux politiques à Marseille :
Alfieri avait pu quitter la navigation grâce à ses entrées dans la bande de la Tartane, composée pour l’essentiel de compatriotes insulaires. Ils avaient bâti leur fortune sur l’achat de terrains stratégiques des rives de l’étang de Berre peu avant que le gouvernement ne décide de lancer l’immense projet portuaire, pétrochimique et métallurgique de Fos-sur-Mer. La Tartane étendait ses antennes jusque dans les ministères parisiens. Et chacun, avec un peu de patience et beaucoup d’arrosage, s’en était mis plein les pochesNote765. .
Dominique Manotti peint quant à elle dans Kop un politicien véreux, Reynaud, président d’un club de foot, arrivé à la tête de la mairie par une manipulation sordide, et qui pourvoit en drogues diverses les joueurs de son club :
Une gamine de treize ans, prostituée par son frère, pour le plus grand profit de Reynaud, et avec votre bénédiction…
Il y en a, comme partout. Les joueurs en prennent toujours, quoi qu’on fasse. Par peur, par angoisse, pour tenir, ou tout simplement pour être meilleur. L’idéal olympique. Toujours plus haut, toujours plus fort. Comme Reynaud est réaliste, plutôt que de s’épuiser à interdire, il a voulu ne pas les laisser livrés à eux-mêmes, aux intermédiaires véreux, et consommer n’importe quoi. Pour limiter les risques, il a confié l’approvisionnement à SpeckNote766. .
Gérard Delteil construit l’intrigue de Dernier tango à Buenos Aires autour d’un élu socialiste, ancien trotskiste, politicien corrompu :
Une série de lettres anonymes contenant des photocopies de notes de frais, de salaires fictifs, de relevés de compte en banque et aussi de courriers avait déclenché l’ouverture d’une instruction. Gilbert avait été assez imprudent pour traiter par écrit de sujets compromettants, comme de commissions occultes. Probablement se croyait-il intouchable et l’était-il sans doute plus ou moins du vivant de Tonton, comme beaucoup d’autres. La justice avait beaucoup traîné, mais un juge, une femme – Nicole Verbisky – l’avait mis en examen pour un salaire de complaisance que lui avait versé pendant six mois un fabricant d’armes. (…) Quant à la nature des documents dont il était censé disposer, les pistes étaient nombreuses. Des ventes d’armes en Amérique du Sud, en Afrique et ailleurs, en passant par la signature d’accords pétroliers avec des financiers russes, on n’avait que l’embarras du choix. Les contours des postes de conseiller qu’avait occupés Gilbert, outre le siège de député qu’il avait perdu en 1991, étaient assez flous pour lui avoir permis de tremper dans les combines les plus diversesNote767. .
Enfin, chez Jean-Paul Delfino et Jean-Claude Izzo, les politiciens et représentants du pouvoir sont corrompus, acquis aux idées d’extrême-droite, voire mafieux :
Le premier se nommait Eric Simoni. Grand, la quarantaine bien tassée, plutôt beau gosse, il faisait partie de la nouvelle vague des politiciens rapidement montés en graine après la disparition des derniers caciques. Pour ceux de sa génération, il n’y avait qu’un mot d’ordre : parvenir au sommet le plus vite possible, sans trop regarder sur les moyens. Ils étaient à la politique ce que les petites frappes et les marlous étaient au Milieu. Des électrons libres, irresponsables, ingérables.
Le préfet de police sourit d’un air chafouin. Recalé au concours d’entrée de l’ENA, viré de l’IEP pour propos révisionnistes, il s’était contenté de faire ses classes dans la police. Aigre de l’intérieur, il avait progressé dans la hiérarchie à la même vitesse que les idées du Front National au sein de la population françaiseNote768. .
À propos du politicien décrit par l’auteur, on remarque la généralisation qui s’opère par le passage au pluriel : ce personnage est représentatif d’une catégorie. Jean-Claude Izzo ne s’embarrasse pas non plus de nuances, foncièrement pessimiste face à l’évolution de la classe politique :
Ceux qui représentaient la loi avaient perdu tout sens des valeurs morales, et les vrais voleurs n’avaient jamais pratiqué le vol à l’arraché pour croûter le soir. On mettait des ministres en prison, bien sûr, mais ce n’était qu’une péripétie de la vie politique. Pas la justice. Ils rebondiraient tous, un jour. Dans la société des affaires, la politique lave plus blanc. La Mafia en est le plus bel exempleNote769. .
Par opposition, l’immigré est presque toujours une figure positive. Représentant les dominés, il est à la fois méprisé pour son appartenance ethnique et exploité économiquement, ce qui entraîne automatiquement sa valorisation par le narrateur :
Il était fier de participer à cette aventure, Mouloud. Il aimait ça, bâtir, construire. Sa vie, sa famille, il les avait forgées à cette image. Il n’obligea jamais ses enfants à se couper des autres, à ne pas fréquenter les Français. Seulement à éviter les mauvaises relations. Garder le respect d’eux-mêmes. Acquérir des manières convenables. Et réussir le plus haut possible. S’intégrer dans la société sans se renier. Ni sa race, ni son passéNote770. .
Les femmes sont souvent valorisées, comme appartenant à une catégorie de dominées subissant le pouvoir des hommes, au sein du milieu masculin comme du milieu social en général. Le personnage de Fabio Montale est fréquemment entouré de femmes issues de l’immigration ou immigrées elles-mêmes, et ces femmes sous le sceau d’une double domination (celle qui est liée à leur statut d’étrangère, celle qui est liée à leur statut de femme) sont le plus souvent promises à la mortNote771. .
Enfin, le passé est idéalisé, parce qu’il correspond aux Trente glorieuses autant qu’à l’enfance ou à la jeunesse. Les valeurs de la fraternité sont exaltées, celles du partage et de la convivialité :
Une époque où les gens savaient encore se parler, où ils avaient encore des choses à se dire. Bien sûr, ça donnait soif. Et ça prenait du temps. Mais le temps ne comptait pas. Rien ne pressait. Tout pouvait attendre cinq minutes de plusNote772. .
Par extension de l’idéalisation, c’est un monde sans racisme qui est peint, où tous les possibles s’offrent, y compris pour des enfants d’immigrés. Là encore, cette évocation est très marquée chez Jean-Claude Izzo :
Il y avait des grands plats de pâtes, en sauce, avec des alouettes sans tête et des boulettes de viandes cuites dans cette sauce. Les odeurs de tomates, de basilic, de thym, de laurier emplissaient les pièces. Les bouteilles de vin rosé circulaient entre les rires. Les repas se terminaient par des chansons, d’abord celles de Marino Marini, de Renato Carressone, puis les chansons du pays. Et en dernier, toujours Santa Lucia, que chantait mon pèreNote773. .
Et nous nous promenions sur le port, heureux. Au milieu d’autres hommes qui parlaient de Yokohama, de Shangaï ou de Diégo-Suarez. Ma mère lui donnait le bras et lui me tenait la main. Je portais encore des culottes courtes et, sur la tête, une casquette de pêcheur. C’était au début des années soixante. Les années heureuses. Tout le monde, le soir, se retrouvait là, à flâner le long des quaisNote774. .
Ce rêve de partage et de convivialité ne peut s’exprimer que dans des microcosmes sociaux, le plus souvent une relation de voisinage ou un bar, ce qui donne lieu à un stéréotype du roman noir, celui de la mère symbolique et nourricière :
Avec soulagement, j’en pousse la lourde porte de bois. Clo est là, les mains dans la lavasse, la mèche grise en bataille et les yeux mouillés de mémoire. Clo, je l’ai mise gérante, c’est comme si c’était moi, avec la confiance en plus. (…) Elle me dépose un sandwich à la tome, double blanc, café très chaud pour qu’il refroidisse et s’assoit en face de moi écrasant d’un revers efficace une mèche rebelle sur son chignon poivre et sel. (…) Elle me fait un clin d’œil que je savoure. Je lui prends la main, douce, blanche et ridée. Je la caresse. Elle tousse aussi sec et retourne derrière son bar. Cette vieille bonne femme à l’accent savoyard sévèrement imbibé me fait un bien fouNote775. .
-J’ai fait frire quelques panisses, dit Honorine à Gélou. Vé, elles sont toutes chaudes. Elle me tendit l’assiette et la fougasse qu’elle tenait sous son bras. Depuis l’été, j’avais aménagé un petit passage entre sa terrasse et la mienne. Avec une petite porte en bois. Cela lui évitait de sortir de chez elle pour venir chez moi. Honorine, je n’avais plus rien à lui cacher. Ni mon linge sale ni mes histoires de cœur. J’étais comme le fils que son Toinou n’avait pu lui donnerNote776. .
[Angèle] a fini par se mettre en mouvement en direction du comptoir et a posé devant moi un demi mousseux, même que la mousse dégoulinait partout. Angèle, en plus qu’elle a du mal à se tenir debout, elle n’y voit presque plus. Mais avec elle, je n’ai plus besoin de passer commande. Au ton de ma voix, elle pige tout de suite ce dont j’ai besoin. Elle serait foutue de se réveiller la nuit pour me donner le biberon si je pleuraisNote777. .
C’est un rituel entre nous. Esther prépare des plats en grosse quantité, qu’elle partage. Surtout avec son voisin… Pour mon plus grand plaisir… Pieds-paquets, soupe au pistou, encornets farcis, aïoli, escargots ou limaçons « a l’aigo soun leï limaçons », polenta, etcNote778. .
Dans l’extrait du roman d’Annie Barrière, le caractère régressif d’une telle relation aux femmes est souligné avec humour. Néanmoins, la plupart des extraits n’opèrent pas une telle mise à distance. De même que les figures féminines sont volontiers stéréotypées, les personnages qui incarnent les valeurs refusées, les contre-valeurs, sont parfois simplifiés à l’extrême, dessinés à partir d’un trait monosémique. Lison Fleury a analysé l’œuvre de Jean-Claude Izzo, et plus spécifiquement Total Khéops sous l’angle des représentations sociales et politiques dans son article « Désenchantement politique et redéfinition de la question sociale dans les romans de Jean-Claude Izzo ». Selon elle, la question sociale est abordée par cet auteur autour de trois axes, qui sont la mythologisation des trente glorieuses et la figure de l’ouvrier militant, le Front National et la figure du beauf, la banlieue et la valorisation de l’immigré. Elle conclut son analyse ainsi :
Dans la tonalité désenchantée de l’écriture, dans le choix des questions traitées, dans la façon de les décrire, des biais et des stéréotypes apparaissent, associés à des jugements de valeur socialement situésNote779. .
Elle estime qu’il y a chez cet auteur « un ethnocentrisme de classe (c’est-à-dire des jugements élitistes sur les comportements populaires à partir des évidences culturelles des milieux intellectuels) », une tendance « à homogénéiser ce qui définit une personne et, ensuite, un groupe social autour de ces éléments négatifsNote780. ». Nous venons de le voir, Jean-Claude Izzo n’est pas le seul à succomber à la tentation de la simplification idéaliste, accompagnée de présupposés partiaux. L’intention réaliste cède ici le pas à l’intention didactique, pour ne pas dire édifiante. Au-delà d’un roman réaliste, le roman noir serait-il donc un roman engagé, voire un roman à thèse ? Quelles sont les valeurs et contre-valeurs exprimées par ce genre ?
1.3.3. Le roman noir, un roman à thèse ?
Pour définir le roman à thèse, nous nous référons aux travaux de Susan Rubin Suleiman, qui inclut le genre dans la catégorie plus vaste des romans réalistes. Elle propose dans un premier temps une définition « intuitive » :
Je définis comme roman à thèse un roman « réaliste » (fondé sur une esthétique du vraisemblable et de la représentation) qui se signale au lecteur principalement comme porteur d’un enseignement, tendant à démontrer la vérité d’une doctrine politique, philosophique, scientifique ou religieuseNote781. .
En quoi le roman à thèse est-il lié selon elle au roman réaliste ? Tout simplement, rappelons-le, parce que « un des éléments de l’impulsion réaliste, c’est le désir de faire voir, de faire comprendre quelque chose au lecteur à propos de lui-même, ou de la société, ou du monde où il vitNote782. ». Cependant, elle ne tarde pas à ajouter que le roman réaliste s’efforce de rendre compte de la complexité de la vie et du monde, tandis que le roman à thèse va au contraire simplifier et schématiser, au nom de ses besoins démonstratifs. En outre, le roman à thèse propose un système de valeurs sans ambiguïtés, et adresse, comme le récit exemplaire, une règle d’action au lecteur :
C’est une tendance propre à l’exemplum, où il s’agit toujours de faire aboutir la fiction à une prise de conscience, et éventuellement à un acte du lecteur ou de l’auditeur. Dans le roman à thèse cette tendance est accentuée par le fait que la matière diégétique n’est pas allégorique ou fantastique, mais « réalisteNote783. ».
Cette dimension réaliste est d’ailleurs essentielle, la moindre distance entre la fiction et le vécu devant favoriser ce passage à l’action du lecteur :
Le roman à thèse tend à brouiller la différence entre les référents fictifs (objets ou événements représentés dans le roman) et les référents réels, dont les référents fictifs ne sont que des analogues. Le roman à thèse encourage donc l’illusion référentielle du lecteur, en tentant d’éliminer la distance entre la fiction et la vieNote784. .
La structure peut être celle du roman d’apprentissage, l’apprentissage étant celui d’un parcours vers la « vérité » ; elle peut être celle du récit antagonique, dans lequel le héros lutte au nom de ses valeurs positives, transcendantes et absolues, contre un ennemi qui représente l’envers de ces valeurs, dans une sorte de combat du bien contre le mal, de la vérité contre l’erreur. Dans son besoin de schématiser, le roman à thèse va en partie renoncer à la nuance dans la construction et la caractérisation des personnages, ce qui va à l’encontre d’un projet réaliste. En effet, les multiples nuances qui composent un personnage réaliste et le rendent vraisemblable sont ici abandonnées, pour que la démonstration soit claire : pour gagner en efficacité, le personnage perd en vraisemblance. Il se voit affecté des traits qui autorisent une caractérisation idéologique, il incarne, par son physique, son langage, sa culture, son comportement, des idées, ou du moins des tendances idéologiques.
Susan Rubin Suleiman attire d’ailleurs l’attention sur le fait que les auteurs de romans à thèse rejettent cette étiquette. De fait, aucun des auteurs du corpus ne songerait à se définir comme un romancier à thèse, selon toute probabilité. Susan Rubin Suleiman a expliqué combien cette étiquette était négative :
Le fait est qu’on se méfie énormément, aujourd’hui, de toute littérature qui « veut dire » quelque chose et de toute critique qui lit la littérature comme un « vouloir-dire »Note785. .
La crainte est de voir ramener l’œuvre à de la propagande sans valeur littéraire.
Sans avoir été interrogés précisément sur cette notion, les auteurs l’ont souvent été sur la notion d’engagement, et leurs positions sur cette question montrent leur embarras, alors même qu’ils revendiquent volontiers certaines valeurs, et le rejet de certaines idéologies. Cette conception du genre comme lieu d’engagement pose des problèmes à certains auteurs, qui refusent d’en faire une littérature-tract. Jean-Claude Izzo rappelle que l’écriture de romans noirs « n’est pas une façon de militerNote786. », et Thierry Jonquet, dans Le Matricule des Anges, réfute l’idée d’une littérature militante :
Je n’aime pas trop le mot d’engagement, le côté banderoles. Je n’aime pas non plus l’idée qu’on puisse donner des messages au lecteurNote787. .
Dominique Manotti tempère l’idée d’engagement qu’on attribue parfois hâtivement au roman noir :
L’écriture est l’expression d’un désenchantement. Je n’aurais jamais écrit si j’avais continué à militer. La littérature influence mais n’est pas une arme militante. Je ne suis pas un écrivain désengagé, mais je hais le roman-tract. Témoigner est un mot un peu connoté « tribunalNote788. ».
Elle précise dans la revue Mouvements que cette dimension de tract nuit à la dimension littéraire du genre :
Le polar est une œuvre littéraire, et donc, en aucun cas réductible à sa dimension sociologique ou politique. Un livre, ce n’est pas un tract. Et je ne crois pas qu’un livre change la société. Je ne crois absolument pas qu’un livre soit uniquement destiné à faire passer un message, une vision du monde. C’est écraser la dimension littéraireNote789. .
Hugues Pagan manifeste les mêmes réserves :
Il y a d’un côté le discours politique qui n’a pas varié pour moi, en tout cas depuis les années soixante-dix, et de l’autre une part de création qui dépasse cet aspect et entraîne la narration. C’est complexe à gérer cette forme de « cul entre deux chaises ». Il s’agit de concilier un discours cohérent sur un constat social accablant et un comportement d’auteur plus névrotiqueNote790. .
Autrement dit, si les auteurs de romans noirs voient dans leurs textes des œuvres réalistes à visée critique, ils refusent d’en faire des romans-tracts, en partie par crainte qu’une telle étiquette ne dévalorise leurs romans, ne les exclue de la sphère de la littérature.
François Muratet est lui aussi mal à l’aise avec cette notion d’engagement, en même temps qu’il la revendique. Il ne procède pas à une opposition entre engagement et littérature, mais à une opposition entre tract et roman-divertissement :
D’abord, c’est sûr, j’écris toujours en me demandant à quoi sert ce que j’écris. Car je veux que ça serve à quelque chose, je ne veux pas faire des romans de plage, des romans pour oublier les soucis, je ne veux pas distraire. Et en même temps si. Je veux distraire, je veux emporter les lecteurs loin de leur réalité quotidienne, je veux les emmener sur d’autres terrains, d’autres fronts, leur faire découvrir des choses que j’ai moi-même découvertes, je veux partager, faire rire et faire pleurer. Et je ne veux pas m’adresser qu’à des militants, ni même qu’à des gens de gauche. J’aimerais bien que mes romans, malgré leurs arrière-pensées idéologiques, soient avant tout des romans, et qu’ils aient cette force qui permettrait de séduire même des réacs. (…) L’inconvénient de l’expression littérature-tract, c’est son côté réducteur, déjà par le format, et puis il y a une connotation péjorative à l’idée de tract. C’est souvent pénible à lire, les arguments sont bétonnés, peu nuancés. (…) Le tract est offensif, violent, il dit l’essentiel en peu de mots, il ne fait pas dans le détail, il gueule que ça ne va pas. Est-ce que cela ressemble à ce que je fais ? Je ne m’y reconnais pas complètement. Je préfère le terme de littérature d’intervention, inventé par je ne sais plus qui (Manchette ?), qui véhicule des connotations qui me conviennent davantageNote791. .
Somme toute, peu d’auteurs revendiquent purement et simplement d’écrire de la littérature engagée, encore moins des romans à thèse. Pourtant, ils sont nombreux à affirmer voir dans le genre un relais à des engagements présents ou passés, à en faire le moyen d’expression d’une révolte, un constat des dysfonctionnements des institutions politiques, sociales, économiques. Derrière la volonté de dévoiler des vérités cachées au lecteur, y a-t-il une volonté de démonstration idéologique ? Les différents traits du roman à thèse précédemment évoqués (et résumés fort schématiquement) sont-ils pertinents pour appréhender le roman noir ?
Il faut rappeler que seule une partie des romans du corpus propose une charge idéologique forte : 37% seulement, comme il a été dit précédemment.
Toutefois, un certain nombre de ces romans semblent actualiser des traits du roman à thèse tel qu’il a été défini par Susan Rubin Suleiman. En effet, sans adresser directement une règle d’action au lecteur, il s’agit bien « de faire aboutir la fiction à une prise de conscience ». Les prises de position sont claires, sans ambiguïtés, et le lecteur de Jean-Claude Izzo ou de Jean-Bernard Pouy n’a aucun doute sur les thèses rejetées par l’auteur ou sur celles qu’il défend, le narrateur ou le personnage principal, via ses pensées et ses actes, étant en quelque sorte le porte-parole de l’auteur. La matière de la diégèse, très proche et tout à fait contemporaine, dans la plupart des cas, de la réalité vécue par le lecteur, peut être vue comme un encouragement à l’illusion référentielle en vue de favoriser le passage à l’acte. Pourtant, dans la plupart des romans, les choses ne sont pas si simples, et la démonstration est parfois mise en doute par le roman lui-même. Tout d’abord, si le personnage incarne essentiellement des valeurs positives et de salvateurs refus, il n’en est pas moins complexe et parfois trouble. Les personnages de Pagan, pour clairs qu’ils soient dans leurs refus, n’en ont pas pour autant une conduite exemplaire et exempte de compromissions. Marqués par la mort et le doute, ils ne font pas toujours les bons choix, et se heurtent à une réalité complexe, comme le narrateur de L’Etage des morts, qui découvre la corruption de son collègue et ami Franck, et qui reste impuissant à l’aider sans pour autant le dénoncer. Surtout, le choix de valeurs positives et la lutte contre les idéologies et comportements négatifs ne suffisent pas à procurer à ces personnages une vie enviable ou une trajectoire positive. Les personnages de Pagan meurent ou sont contraints d’opérer un retrait de la vie sociale qui équivaut à la mort ; l’itinéraire de découverte des héros ne les mène qu’au désespoir total, tout comme leur entourage. Le narrateur de Dernière station avant l’autoroute fait cet amer constat dans les dernières lignes du roman, alors que la femme qu’il aime a fini par le retrouver, loin du monde, elle-même méconnaissable à cause des souffrances endurées. Le « happy end » n’est qu’apparent :
Tous les deux ensemble, qui sait ? Ça n’a plus vraiment d’importance, maintenant, mais quand même. Demain. Ou après-demain. Ou le jour d’après. Peut-être. Bienvenue dans le royaume des mortsNote792. .
Fabio Montale tente dans Solea, dernier volume de la trilogie marseillaise, de décourager Babette dans ses investigations sur la Mafia et son influence en France, car il comprend très vite que le combat est perdu d’avance, et ne peut amener que la mort. De fait, la femme qu’il aime, Sonia, meurt très rapidement dans le roman, ainsi que ses amis, tout comme Babette et les policiers qui acceptent de le suivre dans sa lutte ; surtout, il meurt lui-même, clôturant la trilogie sur une note tout à fait désespérée.
Peut-on espérer convaincre le lecteur d’agir avec de tels constats et des dénouements aussi sombres ? La plupart des romans noirs ont une fin négative, qui condamne les héros et montre que leur combat a été vain, en grande partie. Le but du roman noir ne saurait donc être de pousser le lecteur à agir, de lui montrer la voie de la vérité idéologique salvatrice, mais de l’alerter, de témoigner de l’état de dépérissement de la société et des institutions, gangrenées par le Mal, la criminalité engendrés par la structure de la société. C’est bien une prise de position idéologique, une entreprise de démontage du réel, mais ce n’est pas réellement un appel à l’action, y compris pour les auteurs qui ont un passé militant ; pour ceux-là, le passage à l’écriture correspond souvent à un moment de rupture avec le militantisme politique, et à un désenchantement vis-à-vis de l’action politique.
Il faut sans doute mettre à part la collection du Poulpe, créée explicitement avec un projet militant. L’enjeu était d’offrir un contrepoids idéologique à des collections de polar et d’espionnage marquées idéologiquement à droite, voire à l’extrême droite, même si, Jean Bernard Pouy le précise, le projet du Poulpe n’était pas seulement militant :
C’était monstrueux qu’il n’y ait dans les halls de gare que SAS ou L’Exécuteur, une littérature fasciste, ou au moins impérialiste. On voulait que soit présent quelque chose de différent, tout en respectant les caractéristiques de la littérature populaire (…) Mais ce n’est pas qu’un acte militant : je voulais réussir à mettre tout ensemble, que ce soit un jeu, que ce soit la bande des copainsNote793. .
1995, ne l’oublions pas, était une année Juppé et Le Pen, les grèves/manifs d’importance, Ras le Front et tout le toutim. Décision est donc prise de s’attaquer directement aux dysfonctionnements de notre spectacle social, direction droite et extrême-droite. Pour cela le Poulpe se devait d’être de gauche ou d’extrême gauche (…) En un peu plus de cinq ans, Le Poulpe est devenu un immense atelier d’écriture, ouvert à tous et notamment à des auteurs qui n’écriront peut-être que ça. Il a œuvré comme militant associatif et il a signé, en son nom propre, Gabriel Lecouvreur, plusieurs pétitions publiques et officiellesNote794. .
Six volumes du Poulpe sont présents dans le corpus. La petite écuyère a cafté de Pouy met en scène la droite catholique intégriste qui envoie des commandos anti-IVG dans les cliniques où se pratique l’avortement ; les dirigeants de ces groupuscules sont prêts à tout, y compris à tuer leurs propres enfants pour préserver leurs activités. Le sujet d’Arrêtez le carrelage de Raynal est la corruption d’un ministre de la Défense pédophile, qui projette avec des complices de transformer une côte bretonne en paradis pour touristes. Dans Allons au fond de l’apathie de Philippe Carrese, c’est la question des attentats terroristes imputés aux islamistes qui donne lieu à une analyse des manipulations de l’Etat soucieux de détourner ainsi l’attention de ses méfaits. Dans Les Pis rennais de Pascal Dessaint, Le Poulpe enquête sur un meurtre et un suicide qui cachent une histoire de passeurs pendant l’Occupation, de biens juifs détournés. Enfin, on a vu que les deux volumes du Poulpe signés Didier Daeninckx abordent le sujet du révisionnisme et du négationnisme. Dans le cas d’Ethiqueen toc, l’appel à l’action ou tout au moins à l’information est explicite. En effet, Didier Daeninckx, qui a fondé le journal indépendant d’information Amnistia, a fait figurer à la fin du volume cet insert :
Tout un dossier consacré au négationnisme dans les universités lyonnaises sur : www.amnistia.net
Ainsi, sans être un appel direct au militantisme, le roman invite le lecteur à prolonger et enrichir ses connaissances par un autre moyen, le journalisme d’investigation.
Le Poulpe n’offre pas les issues négatives de la plupart des autres volumes du corpus. Si la victoire du Poulpe n’est que partielle, elle est bien réelle, et systématique. Dans ces romans à structure antagonique, pour reprendre la terminologie de Susan Rubin Suleiman, les tenants des thèses à combattre sont clairement et rapidement identifiés, et l’opposition est sans ambiguïté. Il s’agit bien du combat de la vérité contre l’erreur dont parle la critique, et Le Poulpe, défini comme un redresseur de torts, est bien ce héros antagonique qui « lutte, au nom de certaines valeurs, contre un ennemi qui se définit comme tel par le fait que ses valeurs sont directement opposées à celles du hérosNote795. . » En outre, elle précise que son triomphe, qu’il soit immédiat ou différé, est toujours provisoire, car il faut laisser la possibilité de combats futurs, et le destinataire des combats du personnage est la communauté tout entière, il n’agit pas en son nom – même si le Poulpe n’hésite jamais à garder une part des butins qu’il peut amasser au cours de ses aventures.
Le Poulpe est donc à mi-chemin du héros du hard-boiled, qui prend des coups au cours de son enquête, et du héros antagonique du roman à thèse, qui agit au nom de valeurs transcendantales et absolues, dont il est doté dès le départ.
Ainsi, la collection Le Poulpe peut entrer dans la catégorie du roman à thèse tel que défini par Suleiman. Néanmoins, il reste l’exception dans un corpus où les héros, même lorsqu’ils sont dotés de valeurs, hésitent à combattre en leur nom ou estiment leur combat désespéré. C’est que le roman noir n’attend pas de son lecteur une action à la suite de sa lecture, mais une prise de conscience qui pourra, à terme, changer les mentalités.
Le roman noir s’affirme comme un genre à visée réaliste et sociale. Il est à ce titre, du moins pour la majorité des œuvres du corpus, tributaire d’une esthétique réaliste qui est une rhétorique « dont le propre, en dernière instance, serait de dénier toute rhétoriqueNote796. », comme l’explique Jacques Dubois. Ses principaux procédés, dans le roman noir, sont, au niveau du récit, l’inscription du récit dans une antériorité et une continuité, l’utilisation du discours rapporté, et au niveau de la diégèse, l’effet de réel, l’indexation sur l’événement authentique et l’Histoire. Mais on a vu aussi que pour faire croire à une continuité entre le réel et le monde de la diégèse, le roman noir se fonde sur un déjà-dit, le familier, le déjà-pensé, et sur une « doxa polareuse ». Ce n’est pas la moindre des ambiguïtés du genre en tant que genre réaliste, d’ailleurs les naturalistes eux-mêmes avaient montré les limites de leur projet. En effet, certains critiques, comme David Baguley, voient dans le naturalisme « le genre de la dissolution des formes, de la dégénérescence, d’une sorte de pathologie du réel. » Par conséquent, « la description naturaliste raconte sa propre incapacité d’arrêter cette réalité fuyante, de composer ce qui se décomposeNote797. ». C’est aussi l’incapacité de composer d’après un réel caractérisé par la profusion, l’éclatement, le refus d’ordonner et de donner sens à ce qui se livre dans le désordre. Ainsi, l’écriture naturaliste atomise la réalité, ce qui conduit selon Yves Chevrel « à un éclatement du langage », et fait du naturalisme une « interrogation sur le réel, et peut-être plus encore, sur le rapport de l’homme au réelNote798. . » Mallarmé et les Symbolistes, Paul Valéry, puis Les Nouveaux Romanciers instruiront le procès du réalisme, et poursuivront cette interrogation, enrichie par les apports de la psychanalyse et de la linguistique, ouvrant l’ère du soupçon.
La critique formaliste dénoncera à son tour le leurre de l’illusion référentielle. Alors que la tradition aristotélicienne considère que le langage littéraire est un moyen de reproduction de la réalité, les formalistes vont en effet rejeter cette idée, comme Roman Jakobson :
La question de la vraisemblance « naturelle » (suivant la terminologie de Platon) d’une expression verbale, d’une description littéraire, est évidemment dépourvue de sensNote799. .
Jacques Dubois résume ainsi l’argumentation de Jakobson :
Jakobson y démontrait que la notion de réalisme, qui a largement dominé l’histoire des littératures modernes, était éminemment relative. Non seulement, nous disait-il, elle connaît différents usages mais encore elle peut désigner la tendance à révolutionner les canons artistiques en cours que la tendance à les conserver face aux formes de transformation. Mieux encore : chaque nouvelle école ou nouvelle génération s’affirme en prônant un réalisme supérieur à celui de l’école en place. Ce qu’impliquait la démonstration du poéticien était avant tout que le réalisme, fondé sur un vraisemblable illusoire, relevait comme toute autre esthétique d’une convention. C’est pourquoi ‘ceux qui, en art, parlent de réalisme, contreviennent sans cesse à son commandement’Note800. ».
La critique formaliste va étayer ce refus par des considérations linguistiques. Michael Riffaterre souligne dans « L’illusion référentielle » qu’il ne peut y avoir de « relation directe entre mots et référents », pour des raisons linguistiques :
Les mots, en tant que formes physiques, n’ont aucune relation naturelle avec les référents (…)Note801. .
Philippe Hamon poursuit en disant que le discours réaliste ne peut copier le réel, mais simplement nous faire croire qu’il le fait, à l’aide de divers procédés, qui sont des procédés rhétoriques. C’est pourquoi il parle de « discours contraint », doté d’une rhétorique.
Les auteurs de roman noir n’ignorent pas quel procès a été fait au réalisme, et ils savent également que le réalisme est un facteur de dévalorisation de leurs textes, en cette fin de 20ème siècle. La question se pose alors : comment peut-on avoir un projet réaliste dans les années 1990-2000 ? le genre du roman noir parvient-il à surmonter les impasses du réalisme ? Nous avons vu en quoi l’exigence réaliste pouvait mettre à mal le projet de s’ériger en contre-savoir, la contre doxa n’étant rien d’autre, au final, qu’une doxa faite de refus, de valeurs et de représentations communs aux auteurs de romans noirs. C’est donc que la visée heuristique s’exprime autrement, hors de la visée réaliste, par des « histoires » qui ne sont jamais rien d’autre que de la fiction.
CHAPITRE DEUX. ROMAN NOIR ET FICTIONALITE, UNE FICTION PARADOXALE.
Nul n’aurait songé, il y a quelques décennies, à remettre en cause la fictionalité du roman noir, du fait de son appartenance à la littérature de genre, supposée être le règne de la convention générique et du stéréotype. De fait, le « caractère imaginaire de ses objets », qui définit pour Gérard Genette comme pour beaucoup de théoriciens de la fiction la littérature de fiction, n’est généralement pas remis en cause. Pourtant, la question est d’emblée plus complexe pour le roman noir des années 1990-2000 qui, plus que jamais, s’affirme comme littérature réaliste, et s’enracine fortement dans la réalité sociale et politique de son époque. Les auteurs multiplient certes les avertissements en préambule de leurs romans : ils nous rappellent que leur œuvre est pure fiction et doit être lue comme telle. Mais l’insistance de ces précisions semble tenir de la dénégation ou de la précaution, car l’effet de fiction est parfois suspendu au moment de la réception, tant celle-ci est troublée par l’ancrage référentiel et la visée réaliste très marqués de certains textes. Le phénomène n’est certes pas nouveau, mais on peut se demander s’il ne tend pas à s’accentuer dans la période immédiatement contemporaine. Ainsi, en 1998, Thierry Jonquet est attaqué en justice au moment de la publication de Moloch, pour s’être inspiré d’un fait divers et avoir mêlé à sa fiction des éléments directement puisés dans la réalité. La fictionalité n’est jamais totalement remise en cause, mais le roman noir entretient des rapports complexes avec le factuel.
Le chapitre précédent a montré que le roman noir peut être rattaché à la catégorie du discours réaliste, tant il se distingue par une composante mimétique forte. C’est probablement la principale raison de la suspension de l’effet de fiction, ou du moins de sa remise en cause. Mais il est un autre facteur, lié directement à la notion de genre : le roman noir tend dans les années 1990-2000, pour des raisons que nous avons évoquées par ailleurs – tension vers la légitimité, principalement – à se défaire de ses traits génériques, à les estomper. Or, notre hypothèse est que le code générique, voire le stéréotype générique, vaut, dans le cas du roman noir, pour indice de fictionalité, parce qu’il renvoie le texte à un fonctionnement autoréférentiel, hors de la référentialité au réel. Cela pose en tout cas la question des indices de fictionalité dans le roman noir : à quoi tiennent-ils ? qu’est-ce qui vient les troubler, jusqu’à suspendre l’effet de fiction au moment de la réception ? Ces interrogations amèneront tout naturellement à s’interroger sur les enjeux de la fiction qu’est le roman noir : pourquoi renonce-t-il, partiellement au moins, aux indices de fictionalité d’un certain type ? comment redéfinir le type de fiction qu’est alors le roman noir ? quels sont les enjeux assignés à ce type de fiction ?
Pour comprendre à quoi tient l’effet de fiction dans le roman noir, il faut d’abord s’interroger sur ce qui contribue, aujourd’hui, à le suspendre ou à le troubler au moment de la réception. Les deux aspects sont indissociables : voir à quoi tient l’effet de fiction dans le roman noir, c’est se demander aussi ce qui, dans le texte ou dans ce qui l’entoure (le contexte de l’œuvre), peut le troubler. Ces points sont directement liés à l’atténuation des codes génériques dans les années 1990-2000, et aux visées réalistes et sociales du roman noir.
2.1. Les indices de fictionalité et leur mise en cause
2.1.1. Repérage.
La question qui agite le plus les théoriciens de la littérature qui s’intéressent à la fictionalité est probablement la suivante : qu’est-ce qui distingue le récit factuel et le récit fictionnel ? y a-t-il des procédés formels qui permettent de définir la spécificité de chacun ?
Certains ont dénié au récit fictionnel la capacité de référer au réel, par des faits, des lieux, des événements vérifiables. Mais nous l’avons vu dans le chapitre précédent, le roman noir s’affirme comme texte réaliste, référant au réel de manière vérifiable, même si cela s’accompagne aussi de faits, de lieux et d’événements inventés, imaginaires.
Les spécialistes de narratologie se sont essayés à dégager des spécificités de l’énoncé fictionnel. Parmi eux, Dorrit Cohn, dans son ouvrage précisément nommé Le Propre de la fiction, se propose d’ « établir les frontières entre les domaines narratifs fictionnel et non fictionnelNote802. », grâce aux outils de la narratologie. Pour dégager les marqueurs de fictionalité, elle va opposer récit fictionnel et récit historique – comme mode de récit factuel. Les deux sont proches, puisque le récit historique peut mettre les événements relatés en intrigue en empruntant des techniques au roman ; le récit fictionnel peut, tout autant que le récit historique, emprunter des éléments du monde fictionnel au monde réel. La spécificité du récit historique est de se former à partir d’un matériau préexistant, alors que le récit fictionnel est une suite de séquences qui « ne se réfèrent pas à des données ontologiquement indépendantes et temporellement antérieuresNote803. ». En outre, le récit historique va, dans le texte même, citer ses sources, indiquer sa base référentielle. Selon Dorrit Cohn, « il n’existe rien dans le récit fictionnel qui corresponde à cette strate testimonialeNote804. », même si, très rarement, certains auteurs introduisent un appareil référentiel dans le péritexte – postfaces, préfaces. Cette affirmation est à nuancer pour le roman noir, car si le cas n’est pas répandu, il arrive que les romans intègrent au récit des documents valant pour base référentielle, sous forme d’articles de journaux, d’extraits de rapports, d’essais. Dominique Manotti procède par citations d’articles authentiques dans Sombre sentier, roman qui s’appuie largement sur le mouvement des travailleurs clandestins turcs dans le Sentier, à Paris, en 1980, et sur le trafic de stupéfiants. Le roman s’ouvre d’ailleurs sur un article de Libération, dans le prologue :
Libération, 15 janvier 1980 :
« L’héroïne arrive maintenant d’Iran, du Pakistan, et d’Afghanistan. L’année dernière, la récolte iranienne a produit 1 500 tonnes d’opium brut. Opium raffiné dans ces pays, et surtout en Turquie, puis transporté par route vers l’Europe occidentale. Mais attention, cette héroïne, à la différence de la production mexicaine, est pure à 20 % (au lieu de 3,5 %). En Allemagne, il y a eu 600 overdoses en 1979, à cause de cette nouvelle héroïne. Note805. »
D’emblée, le roman s’ouvre sur la référence à des faits réels, l’intrigue se construit donc pour le lecteur en relation avec cette réalité référentielle, sous les auspices de la réalité, et non sous ceux de l’imaginaire.
Jean-Claude Izzo se montre plus retors dans son utilisation, dans le texte même, de documents renvoyant à la réalité. Dans Solea, il intègre en effet des documents authentiques, dotés de leur véritable titre, il en cite de larges passages directement, mais sans leur attribuer leur véritable auteur – ce qu’il fait en revanche dans une postface. L’intrigue est construite autour de la traque d’une journaliste d’investigation, Babette, qui est sur le point de publier une enquête vaste et précise sur les agissements de la Mafia, mais surtout sur ses influences dans le milieu économique et politique français – corruption, compromissions, voire infiltrations. Cette journaliste, amie de Fabio Montale, va requérir son aide, ce qui va entraîner la mort de celui-ci, mais auparavant, la mort de plusieurs personnages de son entourage. Or, Jean-Claude Izzo ne se contente pas d’évoquer sans autre précision les faits, il intègre à son récit des analyses issues de son travail de documentation, signalé en postface, conformément à ce qu’observe Dorrit Cohn dans les ouvrages de fiction. Mais il fait plus, et en cela il franchit la limite entre récit factuel et récit fictionnel relevée par la théoricienne. Il intègre ces sources au récit lui-même, citant plusieurs passages d’articles d’investigation qu’il a par ailleurs consultés. Ainsi, il reproduit textuellement de longs extraits de l’article de Michel Chossudovsky, « Comment les mafias gangrènent l’économie mondiale », paru en décembre 1996 dans Le Monde diplomatique. Néanmoins, cet article n’est pas attribué à son véritable auteur, mais au personnage de Babette qui fait parvenir cinq disquettes contenant ses travaux au narrateur, Fabio Montale, parce qu’elle se sait menacée. Tout au long du roman, il en prend connaissance. L’extrait suivant cite d’ailleurs le titre de l’article de Michel Chossudovsky :
Par curiosité, j’ouvris le premier document. Comment les mafias gangrènent l’économie mondiale . Visiblement, Babette avait commencé à rédiger son enquête. « À l’ère de la mondialisation des marchés, le rôle du crime organisé dans le marché de l’économie reste méconnu. Nourrie des stéréotypes hollywoodiens et du journalisme à sensation, l’activité criminelle est étroitement associée, dans l’opinion, à l’effondrement de l’ordre public. Tandis que les méfaits de la petite délinquance sont mis en vedette, les rôles politiques et économiques ainsi que l’influence des organisations criminelles internationales ne sont guère révélés à l’opinion publique. » Je cliquai. « Le crime organisé est solidement imbriqué dans le système économique. (…) »Note806. .
Suivent deux pages largement consacrées à de telles citations, valant pour information documentaire pour le lecteur. Autrement dit, un document existant réellement, établissant des faits vérifiables dans le monde réel, et qui vaut pour référence à la réalité, est « récupéré » par la fiction et en quelque sorte fictionalisé parce qu’il est attribué à un personnage fictif. Reste que les faits évoqués, eux, réfèrent directement à la réalité, et parce que la responsabilité de l’article est « rendue » en postface à son auteur réel, il existe dans le roman, de manière marginale certes, cette « strate testimoniale » que Dorrit Cohn estimait interdite au récit fictionnel.
Lors d’une analyse des dispositifs narratologiques du roman noir, nous avions également envisagé les procédés qui font de la narration homodiégétique et rétrospective un artifice totalement invraisemblable, renvoyant le texte à sa fictionalité. Pour mémoire, nous rappellerons le cas de Jean-Claude Izzo, qui dans Solea fait mourir son narrateur homodiégétique, alors que nous sommes dans une narration ultérieure. En effet, ce roman est composé d’un court prologue – sous forme de récit extradiégétique – et de vingt-et-un chapitres en narration ultérieure, homodiégétique, dans un récit qui a recours fréquemment au monologue intérieur et au discours indirect libre. On se souvient que le récit fait par le narrateur de sa propre mort, en narration ultérieure, renvoie le texte à sa fictionalité, car, faut-il le rappeler, l’usage de l’imparfait et du passé simple suppose un moment de l’énonciation postérieur aux faits relatésNote807. .
Le phénomène est pourtant marginal, et ce que l’on retient à l’examen du corpus, c’est une tendance à brouiller les limites entre récit fictionnel et récit factuel, plus qu’une différence formelle entre les deux. Gérard Genette était parvenu à cette conclusion dans Fiction et diction, repérer des indices de fictionalité dans le récit lui-même, l’ordre, le rythme, le mode narratif est au final peu convaincant, car ces procédés sont utilisés dans le récit factuel. Récit factuel et récit fictionnel sont donc très proches d’un point de vue sémantique et formel.
C’est pourquoi d’autres théoriciens ont tenté de définir la fiction dans une perspective pragmatique. On constate en effet que faute de propriétés textuelles et génériques suffisantes, certains lecteurs lisent des récits fictionnels comme des récits factuels – et vice et versa – que l’effet de fiction est suspendu. Le récit fictionnel peut d’ailleurs être considéré comme un texte référentiel prenant le masque maladroit ou mensonger de la fiction. Searle est l’un des premiers à avoir abordé la question de la fiction selon une perspective pragmatique, en affirmant qu’ « il n’y a pas de propriété textuelle, syntaxique ou sémantique, qui permette d’identifier un texte comme œuvre de fictionNote808. ». En revanche, il observe que l’auteur de fiction feint d’accomplir des actes illocutoires de type assertif, mais suspend le fonctionnement référentiel du langage. C’est pourquoi la fiction peut parler de choses qui n’existent pas sans présenter un langage formellement différent du langage qui permet de parler des objets du monde réel. Non seulement l’auteur feint d’affirmer quelque chose, mais de plus, il feint d’être quelqu’un d’autre affirmant quelque chose, autrement dit il fictivise son rôle d’énonciateur, il se pose en énonciateur du monde fictionnel qu’il raconte. Cela explique pourquoi la fiction ne présente pas de différences formelles avec le récit factuel. Gérard Genette complète en disant que « le récit de fiction est une pure et simple feintise ou simulation du récit factuel ».Toutefois, notons-le, dans une telle conception, on admet que le récit fictionnel n’a pas pour vocation de parler des objets du monde réel, autrement dit on postule une frontière étanche entre monde réel et monde de la fiction. La frontière est-elle si nette ? Nous avons vu que non, en ce qui concerne le roman noir. C’est que la fictionalité ne passe pas par là dans le roman noir, mais par le genre.
Notre hypothèse est que le genre, la convention générique, voire le stéréotype générique, sont des marqueurs de fictionalité bien plus puissants – et constants – que tous les marqueurs précédemment évoqués, qui s’avèrent marginaux (la clôture impossible façon Solea), ou qui peuvent être remis en cause (l’incapacité à référer au monde réel sur une base référentielle fiable et extérieure à la fiction). Au risque de nous répéter, rappelons-le : la généricité du roman noir est à mettre en relation avec ce vaste ensemble qu’est la paralittérature. Daniel Couégnas et Paul Bleton se sont tous deux intéressés à la paralittérature dans leurs travaux, et tous deux ont attiré l’attention sur un trait essentiel du texte paralittéraire et de la lecture paralittéraire : la répétition. Daniel Couégnas dit en effet que « la notion de genre contribue pour une part importante à créer des effets de répétitionNote809. ». Paul Bleton, de son côté, parlant de la lecture paralittéraire, affirme que « sont mises en place des stratégies poïétiques de facilitation à base de répétitionNote810. ». La répétition est ici liée au stéréotype. En effet, tous les codes génériques, dans le roman noir, sont des structures, des séquences, des figures qui présentent le caractère répétitif, inoriginé, schématique, figé et usé du stéréotype selon Jean-Louis DufaysNote811. . Le stéréotype est donc un indicateur générique essentiel. Le texte paralittéraire sollicite et enrichit constamment l’encyclopédie générique du lecteur, nourrie par le stéréotype. Qu’il s’agisse de la figure stéréotypée du flic désabusé, de l’enquêteur désenchanté, de la femme fatale, de la victime innocente, du tueur, du stéréotype que constituent des « scènes » obligées, constitutives du genre, ou de la structure narrative fondatrice du roman noir hard-boiled américain de l’entre-deux guerres, tous ces stéréotypes valent pour marqueurs génériques fondamentaux. Par conséquent, en repérant ces stéréotypes, le lecteur n’active pas une référence au réel, mais une référence à d’autres textes de fiction, une autoréférentialité générique. Jean-Patrick Manchette, père fondateur du néopolar dans les années 70, déplore ce qu’il estime être une dérive du roman noir : ne pouvant plus être en phase avec la réalité sociopolitique de son époque, à l’égal des grands aînés du hard-boiled, le roman noir est condamné à travailler sur ses propres stéréotypes, signe selon Manchette de la mort du genre, devenu « référent autonomiséNote812. ».
En ce sens, le code et le stéréotype génériques sont des marqueurs de fictionalité. Jean-Marie Schaeffer signale cette référentialité générique dans son article « Récits de fiction et représentations partagées », à partir de l’exemple des films noirs et policiers :
À propos de couvre-chef, on notera qu’au cinéma, inspecteurs de police et détectives privés ont continué de porter des feutres jusqu’à une date récente, alors que leurs homologues réels, sachant bien que la mode en était passée, y ont renoncé depuis longtemps. Pour le spectateur, le feutre restait vraisemblable et même souhaitable : cela continuait de faire partie de la panoplie virile qu’ils aimaient retrouver dans les films policiers. Le vraisemblable, dans la fiction, n’est donc pas seulement relatif aux représentations que les spectateurs se font de la réalité, il est également relatif aux représentations que les spectateurs se font du genre de récit dont il s’agit (…)Note813. .
Or, précisément, c’est bien ce qui pose problème quant à l’effet de fiction dans le roman noir. Le genre, dans les années 1990-2000, estompe les codes, se refuse au stéréotype générique, pour des raisons que nous avons évoquées précédemment. Cela contribue, avec le retour au réalisme, à brouiller l’effet de fiction. Les évolutions génériques remettraient-elles en cause le statut fictionnel du genre ?
2.1.2. Evolution générique et trouble de l’effet de fiction.
L’ancrage référentiel est très fort dans le roman noir, comme l’a montré le premier chapitre. On pourrait tenir cet ancrage référentiel pour un indice de fictionalité, au sens où il pourrait n’avoir pour but que de favoriser l’entrée du lecteur dans la fiction par l’impression de familiarité induite, donnant ainsi l’illusion que les événements et personnages fictifs sont réels, parce qu’ils prennent place dans un environnement conforme à celui du lecteur. De fait, les personnages fictifs se meuvent souvent dans un univers référant au monde réel, leurs actions semblent les faire prendre part aux événements historiques et sociaux que le lecteur connaît, le roman noir faisant référence fréquemment, dans cette période, à des faits divers ou à des éléments historiques authentiques. Mais le roman noir ne se situe pas dans l’utilisation de la réalité évoquée par Jean-Marie Schaeffer :
Reçu comme une fiction, un récit mobilise des représentations qui, au moins pour une partie d’entre elles, renvoient à des réalités ; cependant, dans l’esprit du lecteur, ces représentations se placent au service du récit, elles sont des moyens de lui donner consistance (…)Note814. .
À l’inverse, selon lui, le récit factuel « mobilise les mêmes représentations se référant à des faits extérieurs, mais le récit est alors considéré par le lecteur comme un moyen, et l’information sur ces réalités comme une finNote815. . » Cette opposition est très discutable dans le cas du roman noir, dont on a vu qu’il entendait délivrer une information, révéler des vérités cachées, ou émettre des hypothèses interprétatives sur le réel – on pense ici à Didier Daeninckx dans Ethique en toc. Le roman noir ne saurait considérer l’ancrage référentiel comme un moyen de donner consistance au récit, en tout cas dans une grande partie des romans du corpus. Parce qu’ils revendiquent pour le genre la force d’information, de réflexion, voire d’incitation à l’action, les auteurs de romans noirs construisent leurs fictions à partir d’une réalité de référence partagée avec le lecteur, ce qui peut occasionner un trouble de l’effet de fiction, voire sa suspension.
Cela ne saurait se produire si, dans le même temps, le genre ne s’éloignait pas des conventions génériques. L’analyse a montré qu’à une labilité générique inscrite dans l’histoire du genre, le roman noir des années 1990-2000 ajoutait une nette tendance à estomper ces traits génériques déjà fragiles, à renoncer aux stéréotypes génériques, tendant même dans certains cas vers les procédés de la littérature d’avant-garde. Dans la première partie de ce travail, nous avons vu que le corpus ne révélait aucune structure récurrente et présentait des contenus thématiques divers. Les traits génériques s’effacent. Du même coup, c’est l’effet de fiction qui s’en trouve troublé, et qui peut même être suspendu, faute d’indices de fictionalité suffisants. Le lecteur, détourné de l’autoréférentialité pure et simple, induite par le stéréotype générique, reporte son attention vers l’autre type de référence construit par le roman noir, le système de référence à la réalité. Le roman noir n’est donc plus seulement ce référent autonomisé dont parlait Manchette, il revient vers une représentation complexe du réel.
Se développent de manière conjointe deux facteurs de trouble de l’effet de fiction : l’ancrage référentiel très fort, constitutif du genre et de ses enjeux, et l’effet de dilution des stéréotypes génériques – employés comme signes de reconnaissance générique pour le lecteur, et non comme mise à distance ironique. Sans doute serait-il tentant de considérer que le roman noir, comme tout récit fictionnel, ne se distingue pas clairement du récit factuel, qu’il ne propose pas de critères clairs de la fictionalité, et que tout est suspendu à la décision du lecteur. Pour autant, le roman noir continue à affirmer avec force son statut de récit fictionnel. On peut émettre l’hypothèse que le roman noir est une fiction qui joue de la proximité avec le récit factuel, se donnant comme un espace de transaction entre fictionnel et factuel.
2.2. Les pouvoirs paradoxaux de la fiction.
Ce constat et cette hypothèse amènent à une autre question : quel est l’enjeu de cet espace de transaction entre réel et factuel ? Il faut lier cette question aux enjeux épistémiques du roman noir, à sa dimension spéculative. Nous pouvons alors formuler une nouvelle hypothèse de travail : plus qu’il ne réfère directement au monde réel, le roman noir, en tant que fiction, se veut une expérimentation des possibles, une « version du monde », pour reprendre une expression de Nelson Goodman, valant pour interprétation du réel.
2.2.1. Un espace de transaction entre factuel et fictionnel.
Une chose est certaine : tout en référant souvent avec précision ou en tout cas exactitude à la réalité et en s’éloignant des stéréotypes génériques, le roman noir ne renonce pas à la fiction, ce que l’on pourrait concevoir pour un genre s’assignant comme fonction la démystification et la dénonciation des travers et des infamies de la société. Au contraire, les auteurs affirment haut et fort que leurs romans sont pure fiction. Il est probable que c’est précisément la zone de trouble entre factuel et fictionnel qui les intéresse, la pure factualité n’étant pas jugée suffisante pour dire le réel tel qu’il est vraiment. Dominique Manotti loue les mérites de la fiction face au travail de l’historien, et Lakhdar Belaïd ou Michel Embareck, journalistes, ne disent pas autre chose, jugeant leurs possibilités en tant que journalistes limitées, là où la fiction leur permet d’aller plus loin, et de prendre des distances avec les faits pour mieux dire ce qu’ils estiment être la vérité. Le roman noir s’affranchirait donc de la factualité, limitative, de l’événementiel pur, pour chercher dans la fiction et l’invention qu’elle suppose une vérité supérieure. Ces ambiguïtés – fiction comme feintise au service de la vérité – sont illustrées par le paratexte.
En effet, le paratexte est, en tant que zone contractuelle entre l’auteur et le lecteur, un espace qui permet aux auteurs de situer leur texte sous les auspices de la fiction, en particulier via les avertissements adressés au lecteur. C’est ce que Gérard Genette appelle les « contrats de fiction », qu’il considère comme une « protestation de fictivitéNote816. ». Selon le théoricien, ils sont ambigus, car s’ils sont des « annexes de l’indication générique, qu’[ils] redoublent bien souvent », ils attirent aussi l’attention du lecteur sur la part possible de véridicité du texte :
Dès l’origine la dénégation de « toute ressemblance » a pour double fonction de protéger l’auteur contre les éventuelles conséquences des « applications » et de lancer les lecteurs, immanquablement, à leur rechercheNote817. .
Vingt-huit romans comportent une précision paratextuelle de ce type. Dans vingt-sept cas, le caractère fictionnel est affirmé à l’ouverture du roman, dans un cas seulement, il suit le texte. La plupart du temps, il s’agit de formules qui valent pour protection juridique, avec quelques variantes d’un roman à l’autre :
Les personnages et l’action de ce roman sont issus de la seule imagination de l’auteur. Tout rapprochement avec un événement réel ne serait qu’une pure coïncidence. (L.Belaïd, Sérail killers)
Ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance entre des personnages du roman et des personnes réelles se serait que le fruit du hasard. (Paul Borrelli, Trajectoires terminales)
Toute ressemblance avec des personnes ou des lieux existant réellement, avec des événements ayant eu lieu, serait pure coïncidence. (Philippe Carrese, Filet garni, Trois jours d’engatse)
Ce livre est une œuvre de fiction. Ceux qui s’y reconnaîtront auront tort. J’ai inventé les personnages qui ne sont pas inscrits dans le grand livre de l’Histoire. (Gilles Del Pappas, Bleu sur la peau)
Cette fable moderne sort entièrement de ma mémoire, de mon imagination, les personnages des chimères de ma créativité. Les jobards qui prétendraient se reconnaître dedans devraient aller faire un petit tour à Sainte-Anne ! (Gilles Del Pappas, Massilia Dreams)
Il faut, dit-on, appeler un chat un chat. Il n’est cependant pas question ici d’une enquête au sens journalistique du terme. Il ne s’agit pas non plus d’un roman reposant sur des événements, anciens ou récents, précis – je me suis d’ailleurs attaché à détourner ou ignorer l’histoire « réelle ». Dans le sujet, l’idée prime, non par peur d’être pris en défaut, mais par, je dirais, souci d’universalité. Il faut pourtant, dit-on, appeler un chat un chat… Ce roman, donc, est une œuvre de pure fiction. Toute ressemblance avec des faits ou des personnages existants ou ayant existé ne serait que fortuite. (Pascal Dessaint, Du bruit sous le silence)
Ce livre est une œuvre de fiction. Tout ressemblance avec la réalité ou des personnages ayant existé ne serait que fortuite. (Maurice Gouiran, La Nuit des bras cassés)
Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait fortuite. (Hervé Jaouen, Hôpital souterrain)
Ce roman est une fiction. Toute ressemblance avec des événements ou personnages réels serait une pure coïncidence. (Thierry Jonquet, Moloch)
La Tribu est un roman. Personnages et situations relèvent de la fiction. (Christian Lehamnn, La Tribu)
Cet ouvrage est de pure fiction. En conséquence, toute ressemblance avec des personnes vivantes ou ayant vécu serait fortuite. Cette règle s’applique aux noms de famille ou de firme. (Pierre Siniac, Les Mal lunés)
Nous tenons à préciser que ce roman est une pure création de l’esprit. En dehors de faits, de firmes, de personnages qui peuvent appartenir à l’actualité ou à l’histoire, toute ressemblance avec des faits, des firmes, des organismes réels ou des personnes vivantes ou ayant vécu serait fortuite. Cette règle s’applique aux noms de famille, d’organismes, de firmes et établissements commerciaux de toute nature. (Pierre Siniac, Ferdinaud Céline)
Toute ressemblance avec des personnes ou des lieux existant réellement, ou avec des événements ayant eu lieu, serait pure coïncidence. (François Thomazeau, La Faute à dégun, Qui a tué l’homme-grenouille ?, Qui a tué Monsieur Cul ?)
Ces quatorze précisions sont somme toute banales, sauf dans le cas de Trajectoires terminales. En effet, ce roman noir se mêle à la science-fiction et se déroule en 2034, ce qui a priori exonère l’auteur de toute « copie » du réel. Pourtant, Paul Borrelli fait figurer cet avertissement au seuil de son œuvre. C’est donc qu’en dépit d’une intrigue futuriste, le roman est susceptible de parler du monde du lecteur, ou que certains événements ou personnages pourraient malgré ce décalage temporel être considérés comme empruntés à la réalité.
Dans tous les cas, la précaution juridique est prise parce que les romans pourraient être considérés comme leurres peignant bel et bien la réalité. Les auteurs en jouent parfois, jusqu’à inverser ces « contrats de fiction ». Ainsi, l’avertissement que fait figurer Michel Steiner en tête de Petites morts dans un hôpital psychiatrique de campagne prend à rebours ces dénégations de factualité :
Seule la réalité m’a inspiré. Et si les lieux et personnages de ce roman sont les fruits de mon imagination, les soins fous et les tourments infligés aux « malades », eux, ne le sont pas.
Michel Steiner, dont on se rappellera les propos sur le roman noir, genre ayant selon lui pour vocation première de dénoncer des pratiques, des situations, inverse ici le constat fait par Jean-Marie Schaeffer, et l’on s’attend à que le récit soit un instrument de la dénonciation de la réalité de la médecine psychiatrique, et non l’inverse – un divertissement qui utiliserait certains éléments de l’histoire de la médecine psychiatrique pour donner au roman consistance et caution réaliste.
D’autres avertissements sont plus ambigus, sans que toutefois le pacte de fictionalité soit remis en cause. Dans l’avertissement aux deux tomes de Synchronicité, Stéphanie Benson dédie son roman :
Aux cinq cents dockers de Liverpool et leur famille qui ont combattu pendant vingt-huit mois l’indifférence publique, la compagnie portuaire, la pauvreté, l’injustice, les lois des gouvernements Thatcher (ainsi que ceux qui les ont appliquées) et leur propre syndicat.
Or, dans la mesure où le roman prend pour cadre une longue grève de dockers, il est difficile de ne pas mêler fiction et réalité. Pourtant, la romancière, consciente du risque d’amalgame, précise quelques lignes plus loin :
Je voudrais préciser, malgré tout ce qui précède, que ce livre est une fiction. Les situations sont inventées, les personnages imaginaires, seule la ville de Liverpool existe pour de vrai…
Plus généralement, les romanciers réaffirment le caractère fictionnel de récits dont ils reconnaissent par ailleurs l’enracinement dans la réalité factuelle et événementielle et la visée réaliste. Ainsi, Michèle Rozenfarb précise d’emblée que son roman, tout fictif et imaginaire qu’il soit, emprunte directement des éléments à la réalité professionnelle qui est la sienne :
Si ce récit est imaginaire, les personnages qu’il met en scène sont pour la plupart inspirés de la réalité. Les enfants, parce qu’il est difficile d’avoir plus d’imagination que la nature qui leur a donné vie et forme. Les adultes, parce qu’il était impensable de les imaginer autrement que ce qu’ils sont : humains, très humains…
D’autres romanciers signalent, sans être plus précis, leurs emprunts à la réalité événementielle via diverses sources, comme Jean-Noël Blanc pour ses romans sur le sport :
Ce roman est une fiction. Mais comme toute fiction, il s’appuie sur des détails réalistes. Certains d’entre eux viennent des quelques étapes du Tour de France que j’ai suivies avec des directeurs sportifs ou des journalistes. D’autres sont issus de la presse sportive. D’autres enfin viennent de discussions à bâtons rompus avec des amoureux du vélo comme Paul Fournel, Denis Cheissoux, Claude Bussy, Myriam Nordemann.
Il va de soi que, dans cette fiction, ni les événements ni les personnages ne correspondent à des cas réels. En revanche, que certains détails factuels soient réalistes, personne ne le niera : il suffit de lire les journaux pour les connaître. Je les ai lus, et je m’en suis servi. L’Equipe, Le Monde, Le Journal du Dimanche, d’autres encore, m’ont aidé d’une aide certaine. Mes remerciements vont aussi à ceux qui m’ont renseigné sur les démarches et les procédures d’une enquête policière, et, en particulier, au commandant E.Hubé et au commissaire principal Hertert.
Dominique Manotti, dont on a vu qu’elle intégrait au texte même des extraits de presse, signale ces emprunts à la réalité dans l’avertissement à Sombre sentier :
Dans cette histoire, tout est inventé, ou presque. Les personnages, l’intrigue et les rebondissements sont purement fictifs ; toute ressemblance avec des faits ou des personnages ayant vraiment existé serait donc, comme on dit, éminemment fortuite. Sont exacts les citations de presse, le contexte dont elles rendent compte, en particulier celui du Sentier au printemps 80 et l’action des travailleurs clandestins pour leur régularisation.
Jean-Claude Izzo joue quant à lui de l’ambiguïté entre fiction et réalité, déclarant emprunter les « chemins du réel » pour construire ce qui par ailleurs est pure fiction :
L’histoire que l’on va lire est totalement imaginaire. La formule est connue. Mais il n’est jamais inutile de la rappeler. À l’exception des événements publics, rapportés par la presse, ni les faits racontés, ni les personnages n’ont existé. Pas même le narrateur, c’est dire. Seule la ville est bien réelle. Marseille. (Total Khéops)
Il convient de le redire une nouvelle fois. Ceci est un roman. Rien de ce qu’on va lire n’a existé. Mais comme il m’est impossible de rester indifférent à la lecture quotidienne des journaux, mon histoire emprunte forcément les chemins du réel. Car c’est bien là que tout se joue, dans la réalité. Et l’horreur, dans la réalité, dépasse – et de loin – toutes les fictions possibles. (Solea)
Il serait faux d’affirmer que ce roman est purement imaginaire. Je n’ai fait que pousser à bout les logiques du réel, et donner des noms et inventer des histoires à des êtres que l’on peut croiser chaque jour dans la rue. Des êtres dont le regard même nous est insupportable. C’est dire qu’à lire ces pages n’importe qui peut se reconnaître. Les vivants et les mourants. (Le Soleil des mourants)
Dans tous ces avertissements, Jean-Claude Izzo fait la distinction entre l’ancrage référentiel du roman et sa part de fiction. Pourtant, par le biais d’une citation mise en exergue dans Total Khéops, il fait apparaître la notion de vérité :
Il n’y a pas de vérité, il n’y a que des histoires. Jim Harrison.
S’agit-il du déni de la possibilité d’établir une vérité ? affirme-t-il au contraire l’exigence de vérité au-delà de la fiction ? En tout cas, dans le deuxième roman de la trilogie, l’auteur va substituer au couple réalité/fiction celui de vérité et réalité :
Rien de ce que l’on va lire n’a existé. Sauf, bien évidemment, ce qui est vrai. Et ce que l’on a pu lire dans les journaux, ou voir à la télévision. Peu de choses, en fin de compte. Et, sincèrement, j’espère que l’histoire racontée ici restera là où elle a sa vraie place : dans les pages de ce livre. Cela dit, Marseille, elle, est bien réelle. Si réelle que, oui, vraiment, j’aimerais que l’on ne cherche pas des ressemblances avec des personnages ayant réellement existé. Même pas avec le héros.
Autrement dit, les événements relatés sont fictifs, mais au cadre ou aux événements réels, s’ajoute le vrai, sans que les deux se confondent. Le roman noir se libèrerait partiellement de la factualité et de l’événementiel pour chercher, via la fiction, la vérité.
On peut évoquer un dernier cas d’avertissement qui joue du trouble entre fiction et vérité. C’est celui de Poste Mortem, de Jean-Jacques Reboux. L’auteur rédige un long et curieux avertissement au lecteur pour ce roman qui met en scène la dérive meurtrière de Simone Dubois, employée à la Poste, souffrant de graves troubles psychiques. Le texte lui-même contient de nombreux indices de fictionalité, à commencer par l’alternance entre la narration à la 3ème personne – par laquelle nous suivons l’évolution de l’enquête et les faits et gestes des gendarmes – et la narration à la 1ère personne, par laquelle nous suivons le dialogue en forme de soliloque de Simone Dubois avec son otage. Pourtant, par son avertissement, Jean-Jacques Reboux, qui a lui-même été employé à la Poste, sème le doute, affirmant que non seulement Simone existe et que tous les événements relatés sont authentiques, mais également qu’il n’est pas tout à fait l’auteur du texte :
Je vous dois la vérité : ce Poste mortem, ce n’est pas moi qui l’ai écrit. Enfin, pas seulement moi. Car ce livre est avant tout une histoire vraie. Romancée, certes, mais une histoire vraie tout de même. Celle de Simone Dubois, postière de son état. Une drôle de femme que j’ai rencontrée le 6 août 1985. (…) Il y a quelques jours, lâchement, j’ai appelé le directeur de l’hôpital psychiatrique de Cadillac, je lui ai tout raconté, le suppliant de ne pas laisser entrer Poste mortem dans la bibliothèque de son établissement. Il m’a répondu qu’il était navré mais ne pouvait hélas rien pour moi. Simone venait de s’évader après avoir défenestré une infirmière et pris un gardien en otage. Les journaux n’en ont pas parlé, mais les journaux ne disent pas tout, vous savez bien.
Maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, je sais que Simone lira ces lignes. Et que nos chemins vont de nouveau se croiser. C’est inéluctable. Parce qu’elle ne va pas être contente du tout, Simone, mettez-vous à sa place ! À l’heure qu’il est, elle me cherche. Et s’il devait m’arriver malheur, amis lecteurs, je ne vous demande qu’une chose : soyez magnanimes, pardonnez à Simone.
Par ailleurs, l’auteur dédicace le roman à plusieurs personnes, dont rien ne permet de mettre l’existence en doute – notamment la romancière Sylvie Picard – mais parmi ces destinataires privilégiés se trouve le personnage du roman :
À Simone Dubois sans qui ce livre n’aurait pu exister.
Dans ce cas, ce n’est pas la fictionalité qui peut être perçue comme un leurre, mais le déni de fictionalité. L’auteur semble se situer dans un espace entre factualité et fictionalité, puisque en dépit de ce déni de fictionalité, le roman adopte des modes de narration fréquemment utilisés dans les récits fictionnels. L’avertissement semble être un canular, mais rien ne permet malgré tout d’en être sûr. L’effet de fiction est tout cas bel et bien troublé, à défaut d’être réellement suspendu. C’est un nouveau déni, en forme de leurre, de l’affirmation de Jean-Marie Schaeffer selon lequel le discours fictionnel « s’écarte du discours référentiel en ce que ses phrases ne renvoient pas à des référents réelsNote818. ».
Quoi qu’il en soit, l’exemple de Jean-Jacques Reboux nous le montre bien, ces affirmations du caractère fictionnel ne suffisent pas à déterminer la réception du lecteur, pas plus qu’à protéger l’auteur de poursuites. Thierry Jonquet peut bien affirmer en préambule de Moloch que « ce roman est une fiction [et que] toute ressemblance avec des événements ou personnages réels serait une pure coïncidence », autrement dit que le roman ne se caractérise pas par des énoncés à dénotation littérale mais par une dénotation symbolique, l’effet de fiction s’est trouvé suspendu au moment de la réception, en tout cas pour certains lecteurs.
Thierry Jonquet s’est en effet vu intenter, au moment de la publication de Moloch, un procès qui illustre parfaitement la problématique de la fictionalité du genre. Pour ce roman paru en 1998, l’auteur s’inspire de faits divers, notamment de l’histoire d’une mère souffrant du syndrome de Münchhausen par procuration. L’affaire, dite affaire Kazkaz, remonte à 1995, comme le dit Thierry Jonquet :
En 1995, je lis dans la presse l’histoire d’une aide-soignante apparemment atteinte de ce fameux « syndrome de Münchhausen par procuration ». Il s’agit d’une forme de maltraitance où une mère simule une pathologie organique chez son enfant, ce qui a pour conséquence de soumettre celui-ci à des traitements inutiles et dangereux. En l’occurrence, cette jeune mère fut soupçonnée d’avoir administré à sa fille des sulfamides hypoglycémiants, puis de l’insuline. Après avoir ôté la moitié du pancréas de la fillette, pour rien, les médecins ont conclu à un empoisonnement. La jeune mère devait passer en jugement, mais elle est décédée quelques semaines avant sa comparution devant la cour d’assises. J’ai puisé dans cette histoire, qui n’est pas uniqueNote819. .
Lorsque Moloch est publié, malgré le contrat de fiction qui précède le texte, les parents de la jeune femme attaquent en justice Thierry Jonquet (et son éditeur, Gallimard), devant la chambre de la presse du tribunal de Paris, au motif que l’histoire relatée dans le roman reprend exactement les faits vécus par leur fille, alors même que l’affaire n’était pas encore jugée, ce qui constituait selon eux une violation du secret de l’instruction et une atteinte à la présomption d’innocence. De fait, le personnage de Marianne, dans le roman, est coupable des faits reprochés à la jeune femme. On accuse donc Thierry Jonquet d’être sorti du champ de la fiction pour référer à des faits authentiques, faisant intrusion dans l’intimité de personnes réelles. Mais l’avocat des plaignants constate lors du procès que l’histoire relatée par Jonquet diffère sur trois points. Dans le roman en effet, la jeune femme est prise en flagrant délit (en train d’injecter l’insuline), elle se suicide peu après sa mise en examen, et elle a été victime d’un inceste. Ce recours à la fiction, à l’invention fictionnelle, loin de constituer une circonstance atténuante, est au contraire considéré comme un point en faveur des plaignants, car ces éléments fictifs donneraient une image négative de la prévenue et de sa famille, portant atteinte à la mémoire de Liliane Kazkaz. Autrement dit, le recours clair, sans ambiguïté à la fiction est ici perçu comme une circonstance aggravante. Parce que l’emprunt à la réalité se double d’inventions de romancier, Thierry Jonquet est doublement coupable. Les points fictionnels du roman nuisaient somme toute davantage que la duplication de faits réels. La fiction est du même coup perçue sur le mode du leurre. Thierry Jonquet a cependant été relaxé par le tribunal, qui a considéré qu’il exerçait sa liberté de romancier, laquelle comprend la possibilité de s’inspirer de faits divers. Néanmoins, l’affaire Kazkaz/Moloch montre que le roman noir entretient des rapports complexes avec le réel, se situant à la frontière entre fictionnel et factuel, sans que soit remise en cause la fictionalité du genre. La référence est bizarrement perçue par les plaignants comme littérale – l’auteur reprend point par point l’histoire de Liliane Kazkaz, et comme symbolique – l’auteur a également inventé pour donner du poids à son histoire – ce qui a pour conséquence de nuire à l’image d’une personne ayant existé.
Fiction et non-fiction s’imbriquent soigneusement, par le jeu de la dénotation. Si Thierry Jonquet invoque le caractère fictionnel de son roman, c’est parce que réellement son récit suspend la référence dès lors qu’est portée la mention « roman ». Là encore, il faut se rappeler que la fiction « roman noir » fait référence au réel non pour le copier mais pour construire un monde fictionnel qui devient un instrument de connaissance du monde réel. Maurice G.Dantec définit ainsi le roman noir comme « le récit d’une guerre privée entre la vérité et le mensonge, entre la fiction et le réel : le réel ment. La fiction reste le meilleur moyen de le subvertir et de le faire avouerNote820. . » Autrement dit, le fictionnel est essentiel pour le roman noir : il permet de se libérer des apparences trompeuses ou insuffisantes et de déployer un discours de vérité sur le monde, beaucoup plus puissant. C’est pourquoi Patrick Raynal, romancier et éditeur, insiste sur le caractère nécessairement fictionnel du roman noir : « Le romancier s’amuse avec les faits. Son monde n’est tenu qu’à une cohérence interne à l’histoire qu’il raconte et, même si ce monde peut s’appuyer fortement sur une réalité historique, il reste un monde de fiction, un monde régi par les lois et la subjectivité du romanNote821. . » Certes, la connivence avec le réel peut être troublante, le roman noir s’apparente à un travail d’enquête. Jean Pons affirme quant à lui que « le roman noir tente ainsi, entre réel et fiction, à ses risques et périls, une élucidation de notre fin de siècle en prenant pour indices, pour hypothèses de travail, des faits divers qu’il organise en inventant des cohérencesNote822. . » Tel est l’espace de transaction entre factuel et fictionnel, ni mensonge ni leurre. Le monde fictionnel construit par le roman noir ne réfère pas au monde pour le représenter, il propose un regard et entend changer notre vision du monde.
2.2.2. De la référence au monde réel à la construction d’une version du monde.
Le roman noir met au centre de ses préoccupations une problématique qui traverse l’ensemble de la fiction occidentale, celle du rapport entre fiction et connaissance, qui pose les problèmes de la représentation du monde et de la construction d’un savoir sur le monde. Il faut donc en passer par un élargissement théorique afin de redéfinir le rapport du roman noir au réel, selon une perspective qui emprunte au constructivisme. Pour cela, nous nous appuierons largement sur un article publié en 2000 dans la revue Poétique par Lorenzo Bonoli, « Fiction et connaissance. De la représentation à la constructionNote823. ».
Différentes théories ont abouti à l’impossibilité pour la fiction de représenter le monde réel dans une relation de référence directe, mais d’autres ont montré qu’elle avait le pouvoir de construire un savoir sur celui-ci par la production de formes, de modèles nous permettant de concevoir autrement le réel. Lorenzo Bonoli fait la synthèse de ces théories qui ont conduit à dénier à la fiction toute possibilité d’avoir un statut référentiel et cognitif. Selon les théories logiques classiques, mais aussi selon les théories des actes de langage, parce que la fiction ne propose pas de correspondance directe entre le langage et le réel, parce qu’elle ne peut établir de référence directe à des objets du monde, elle ne peut permettre de le connaître, et pire, encore, elle peut « entraver la connaissance en créant de faux objets et des pseudo-problèmesNote824. ».
Néanmoins, des approches plus récentes de la question ont permis de surmonter cette impossibilité. Ainsi, David Lewis, philosophe et logicien, introduit la notion de monde possible. En effet, il élargit le cadre référentiel, jusque-là centré sur un seul monde, le monde réel de la science, à plusieurs mondes, le monde réel mais aussi les mondes possibles ou mondes fictionnels. Le monde possible est en quelque sorte une construction complète, non contradictoire, à partir de façons dont le monde aurait pu être. Ces mondes possibles, et les éléments qui le composent, sont réels, tout autant que le monde dit réel, mais ils ne sont pas actualisés. Dès lors, les lieux, personnages, objets que présente la fiction ont un référent, non dans le monde réel, mais dans le monde possible. À cette notion de monde possible, Nelson Goodman préfère celle de « version du monde ». En effet, il considère que rien n’interdit, dans une fiction, d’attribuer un événement fictif à un état de chose ou de fait réel. De ce fait, il n’y a pas besoin d’un recours à un monde possible, il s’agit plus simplement d’une description particulière du monde réel, une description également vraie, mais simplement énoncée en d’autres termes :
Un énoncé est vrai, et une description ou une représentation sont correctes, pour un monde auquel ils s’ajustent. Et une version fictionnelle, verbale ou iconique, peut, si on la conçoit métaphoriquement, s’ajuster à un monde et être correcte pour luiNote825. .
Ainsi, le langage de la fiction ne réfère pas à la réalité telle qu’elle est, elle participe, en tant que version du monde, à la construire. Lorenzo Bonoli dit quant à lui :
Les termes fictionnels ne sont plus sans référence, mais portent sur des entités fictionnelles organisées dans un monde fictionnel qui constitue un monde alternatif au monde réel, avec ses propres lois et ses propres caractéristiquesNote826. .
Nelson Goodman ne parle d’ailleurs pas spécifiquement de la fiction. Selon lui, tout accès au monde réel se fait par la médiation d’une activité symbolique qui construit une version du monde. Il n’existe aucune perception pure, directe, du monde réel, que nous ne connaissons jamais tel qu’il estNote827. . Dès lors, le monde fictionnel est pour ainsi dire une version du monde comme une autreNote828. , qui résulte d’une interprétation. Par conséquent, des informations peuvent circuler entre monde réel et monde fictionnel. Surtout, Lorenzo Bonoli reconsidère à la lueur de cette perspective constructiviste le problème de la référence, affirmant que la référentialité du monde fictionnel peut impliquer une relation entre texte et monde réel, alors que l’on estime généralement que la fiction possède une référence nulle. Mais il faut renoncer à « concevoir le rapport texte-monde dans l’optique d’une adéquation du premier à un objet qui en quelque sorte préexisterait à la lectureNote829. . » Le critique sait parfaitement qu’une telle proposition peut être délicate, « dans la mesure où l’on définit généralement la fiction justement en opposition à la réalité. » Il ajoute :
Cependant cette opposition est essentiellement liée à une conception du langage qui voit dans une référence directe et représentationnelle la seule référence possible. À travers la réflexion de Paul Ricœur (…) il sera possible de démontrer dans quel sens on peut repenser la référence au monde réel de la fictionNote830. .
De fait, Paul Ricoeur a abordé cette question de la référence dans plusieurs de ses travaux, notamment Temps et récit et Du texte à l’actionNote831. . La référence n’est pas une propriété linguistique du texte, au sens où c’est le lecteur, au moment de la réception, qui recontextualise le texte en rétablissant le lien entre les mots et le monde. La référence se négocie donc au moment de la réception, comme le dit Lorenzo Bonoli :
C’est le lecteur qui actualise les potentialités du texte en les projetant sur l’arrière-fond constitué par sa version du monde et qui, par là, active la capacité référentielle du texte. Mais cette activation de la référence est toujours déterminée et limitée par le monde du lecteur, ce qui souligne la nature indéterminée et variable de la référence d’un texteNote832. .
Cela redéfinit le rapport au monde de la fiction, comme l’indique Paul Ricœur (cité par Lorenzo Bonoli) :
Nous n’écartons qu’un mode de référence à la réalité, le mode représentatif ou reproductif de la réalité. Mais en même temps et du même coup, la voie est ouverte pour un autre mode de référence. Parce que les fictions ne se réfèrent pas de manière reproductive à la réalité en tant que déjà donnée, elles se réfèrent à la réalité de manière productive en tant que prescrite par ellesNote833. .
Le philosophe propose la conception d’une référence productive ; la fiction ne décrit pas la réalité, elle produit des réalités :
Ce nouvel effet de référence n’est pas autre chose que le pouvoir de la fiction de redécrire la réalité. (…) Ce lien entre fiction et redescription a été fortement souligné par certains théoriciens de la théorie des modèles, dans un autre champ que le langage poétique(…) Le trait commun au modèle et à la fiction est leur force heuristique, c’est-à-dire leur capacité d’ouvrir et de déployer de nouvelles dimensions de réalité, à la faveur de la suspension de notre créance dans une description antérieureNote834. .
Dès lors, il est possible d’envisager les pouvoirs cognitifs de la fiction. On sort, comme le demandent de nombreux théoriciens, parmi lesquels Jean-Marie Schaeffer, de la question fiction fausse/fiction vraie, de l’opposition même de la fiction à la réalité. La fiction devient un moyen de voir différemment et de comprendre la réalité, par ce que Paul Ricoeur nomme la fonction révélante et transformante de la fiction :
La fonction de la fiction, qu’on peut dire indivisément révélante et transformante à l’égard de la pratique quotidienne ; révélante, en ce qu’elle porte au jour des traits dissimulés, mais déjà dessinés au cœur de notre expérience pratique ; transformante, en ce sens qu’une vie ainsi examinée est une vie changée, une vie autre. Nous atteignons ici le point où découvrir et inventer sont indiscernables. Le point, donc, où la notion de référence ne fonctionne plus, ni non plus sans doute celle de redescriptionNote835. .
Ainsi, la fiction permet d’entrevoir le réel sous un autre jour, selon des aspects insoupçonnés, ce qui entraîne, selon Lorenzo Bonoli, une « réorganisation de notre vision de la réalité ». C’est pourquoi la fiction a un rôle novateur : elle a le pouvoir de s’éloigner du familier, « et d’explorer les régions du non-encore-dit ». Il ajoute :
Le pacte fictionnel (…), dans cette optique, peut être lu comme une suspension de l’assujettissement aux modèles dominants de lecture du monde et une ouverture à la configuration de nouveaux modèlesNote836. .
Paul Ricoeur dit par ailleurs :
Fiction et poésie visent l’être, non plus sous la modalité de l’être-donné, mais sous la modalité du pouvoir-être. Par là même, la réalité quotidienne est métamorphosée à la faveur de ce qu’on pourrait appeler les variations imaginatives que la littérature opère sur le réelNote837. .
Il voit même dans la fiction en tant que construction la seule possibilité pour l’homme pour penser l’inédit :
La première manière dont l’homme tente de comprendre et de maîtriser le divers du champ pratique est de s’en donner une représentation fictiveNote838. .
Cela aboutit à un pouvoir tout à fait paradoxal de la fiction, celui de proposer une vision du monde d’autant plus aiguë que la fiction s’éloigne de notre perception – ce qui contrevient à l’idée traditionnelle que la fiction n’est qu’une perception affaiblie de la réalité :
Le paradoxe de la fiction est que l’annulation de la perception conditionne une augmentation de notre vision des chosesNote839. .
Après ce long détour théorique, revenons au roman noir. L’approche constructiviste permet de sortir des impasses de l’écriture réaliste. Le roman noir, au moins dans les années 1990-2000, affirme haut et fort sa volonté de tenir un discours sur le réel, mais il ne le fait pas seulement dans une perspective représentative au sens traditionnel du terme. Le genre met en œuvre cette référentialité redéfinie, et en tant que tel, se donne comme un genre à visée heuristique, ayant pour fonction non de copier le réel tel qu’il est, mais d’en proposer une version, une vision, un « pouvoir-être ». La plupart des auteurs de romans noirs conçoivent le genre ainsi, et cela explique les « manquements » à la réalité factuelle de certains des romans du corpus. On songe par exemple à Ethique en toc, où Didier Daeninckx livre une interprétation – tout à fait plausible d’ailleurs – de l’incendie de la bibliothèque universitaire de Lyon, dans un mélange entre fidélité événementielle et fiction. Il ne se contente pas d’intégrer des faits réels à une intrigue fictive, il reconfigure les faits dans une fiction. Le romancier manipule l’événement, comme Thierry Jonquet dans Moloch, qui s’empare de faits réels pour livrer une vision de l’humain, mais aucun des deux ne s’éloigne du projet fondateur du roman noir, qui est de rendre compte du réel, de ses aspects insoupçonnés, cachés.
C’est aussi ce qui permet de concevoir que le corpus accueille des œuvres telles que Babylon babies de Maurice G.Dantec, Trajectoires terminales de Paul Borrelli ou Cœur-Caillou de Virginie Brac. Ces œuvres à dominante noireNote840. intègrent des éléments de science-fiction, projetant notamment la diégèse dans le futur. Là encore, il n’y a pas de manquement au projet « réaliste » du genre, qui reste de représenter le monde réel, selon la perspective constructiviste que nous venons d’envisager. Dans Babylon Babies, à travers l’évocation de l’état géopolitique du monde dans les décennies à venir, c’est de son inquiétude sur l’état du monde actuel (id est du monde en 1999) que Maurice G. Dantec nous fait partNote841. . Cela explique aussi le curieux contrat de fiction figurant en tête de Trajectoires terminales, roman qui s’éloigne apparemment de tout projet réaliste. Pourtant, parce qu’il se situe avant tout dans un projet relevant du roman noir, ce texte se donne à lire non seulement comme une spéculation sur l’avenir de la société (des villes dévastées par des pluies acides et la surpopulation) mais aussi comme une vision de la société de la fin du 20ème siècle. Dès lors, l’auteur se prémunit par l’avertissement contre une lecture activant la référence au monde réel, autant qu’il la provoque par ce même « contrat de fiction »…
Au terme de ces deux premiers chapitres, on voit comment le roman noir, dans les années 1990-2000, se pose certes comme un genre réaliste, mais non comme un genre réaliste « naïf », qui passerait outre toutes les démonstrations théoriques protestant de l’impossibilité de référer au réel directement et d’en proposer une représentation en forme de copie. La perspective constructiviste permet de reconsidérer le réalisme mis en œuvre par le roman noir : le genre ne copie pas le réel, il en est une représentation en forme de construction, il est une version du monde, une possibilité et une interprétation. Ce n’est bien sûr pas une interprétation neutre, objective. C’est un regard sombre, pessimiste, « noir ». Cela nous amène à considérer un autre trait du roman noir, sa tonalité, ou registre, qui s’apparente à la tonalité tragique.
CHAPITRE TROIS. UN ROMAN TRAGIQUE ?
3.1. Eléments de définition.
3.1.1. La notion de registre.
On a vu qu’il était impossible d’appréhender le genre dans une unité thématique, structurelle, ou de manière générale, formelle. Le critère thématique est fréquemment convoqué par les critiques, à partir de la dénomination même du genre : roman « noir », dont le thème serait la noirceur, sans que l’on sache bien au fond ce que cela désigne, comme le roman sentimental aurait pour thème le sentiment amoureux, ou le roman d’aventures des aventures extraordinaires. Nous proposons d’aborder le problème différemment, et d’envisager la locution « roman noir » non comme ayant une valeur de désignation thématique, mais comme indicateur d’une attitude émotionnelle exprimée et suscitée par le texte. Que l’on songe au thriller : le terme générique désigne moins un contenu thématique précis (il existe de nombreux « types » thématiques de thrillers, médicaux, juridiques, financiers, criminels, etc.) que l’effet émotionnel, l’affect suscité chez le lecteur, en l’occurrence le frisson dû à la peur, la tension, l’angoisse devant la menace qui pèse sur les personnages. Le sujet du roman, l’organisation narrative même sont déterminées par cet effet recherché. Les spécialistes du thriller pardonneront ce raccourci quelque peut caricatural sur leur objet d’études, qui ne vaut que pour analogie à des fins didactiques. Concrètement, nous émettons l’hypothèse que le roman noir se définit non par un contenu thématique noir, ce qui n’aurait d’ailleurs pas grand sens, mais par une tonalité noire, – comme il y a en musique une tonalité mineure – exprimant et créant chez le lecteur une humeur, une émotion « noire », faite de désespoir, d’angoisse (mais elle n’est pas liée ici à la tension comme dans le thriller, plutôt à une inquiétude existentielle), de pessimisme et de désenchantement total. À ce titre, le genre du roman noir paraît lié fortement à la notion de registre, terme bien plus pertinent que celui de tonalité que nous venons d’employerNote842. .
Encore faut-il définir la notion de registre, employée fréquemment mais peu théorisée, comme si elle allait de soi. Alain Viala a proposé une définition du terme, en effectuant un retour historique sur la notion, dans un article publié dans la revue Pratiques en 2001 et dans la notice « Registres » du Dictionnaire du Littéraire en 2002. Il souligne que la notion de registre apparaît en réalité dès la Grèce antique, Aristote en faisant mention dans sa Poétique. Le philosophe établit un lien entre un sujet, une manière et une attitude ou bien encore une disposition du poète :
Puis la poésie se divisa selon le caractère propre de chacun : les auteurs graves représentaient des actions de qualité accomplies par des hommes de qualité, les auteurs plus légers celles d’hommes bas, en composant d’abord des blâmes, comme les autres composaient des hymnes et des élogesNote843. .
Un lien est donc établi entre la disposition grave ou légère de l’auteur et sa manière de s’exprimer, éloge ou blâme, deux catégories qui expriment une attitude et visent à provoquer chez le lecteur de l’admiration ou de la désapprobation. Cela va d’ailleurs déterminer des genres, mais comme on le voit, et comme le dit Alain Viala, « les genres ne sont donc pas premiers (…) mais dérivent d’une fonction dévolue au texte, d’une finalitéNote844. . » Les genres naissent de cette volonté d’exprimer et de susciter cette attitude et cette disposition qu’il appelle registre. Ainsi, les registres se définissent comme :
Les catégories de représentation et de perception du monde que la littérature exprime, et qui correspondent à des attitudes en face de l’existence, à des émotions fondamentalesNote845. .
Si la notion de registre est différente de celle de genre, en ce sens que le genre peut renvoyer à des catégories formelles alors que le registre renvoie à une émotion, il faut préciser aussi que la notion de registre excède celle de genre. Si un registre peut être fortement associé à un genre, il peut s’exprimer hors de celui-ci :
La littérature (…) est un des lieux où se manifestent des affects fondamentaux, des attitudes en face du monde, et des textes tendent à exprimer ces attitudes et à les faire partager à leurs lecteurs ou spectateurs ou auditeurs. Ces attitudes « mises en œuvre » regroupent des textes qui peuvent relever d’un genre principalement – au nom du principe classique de concordance entre sujet, manière et émotion proposée – mais aussi de plusieursNote846. .
Ce point est important pour aborder le roman noir et le phénomène que nous avons précédemment appelé « dissémination générique », nous y reviendrons. Le registre dépasse également les catégories historiques (en tant que liées à l’histoire littéraire) :
Les registres sont des catégories renvoyant à des attitudes devant le monde ; ils sont donc éminemment des catégories du sens. Comme tels, ils dépassent les classements formels, celui des genres notamment. Comme tels, ils dépassent aussi les cadres usuels du découpage de l’histoire littéraire. Ainsi le tragique advient-il en divers genres et diverses époques. Les registres ont donc un enjeu qui touche à ce que la littérature apporte de connaissances, de savoir sur le monde en son domaine propre, les affects, croyances et idées (…)Note847. .
Notre hypothèse est donc que le roman noir est un genre dérivant directement d’un registre, en tant que « mode d’expression associé à une attitude [que l’auteur] vise à exprimer et à éveiller chez les [lecteurs]Note848. ». Une question se pose maintenant : le genre noir dérive-t-il d’un registre noir, qui existerait indépendamment de lui au sens où il pourrait s’exprimer hors de lui (par exemple dans la science-fiction ou dans le roman), ou bien le genre noir correspond-il à un ou plusieurs registres qui existent par ailleurs dans la littérature, tel que le registre tragique ?
C’est qu’en effet, à lire les définitions et commentaires des critiques à propos du roman noir, la notion de tragique revient fréquemment. On se souvient que la tragédie antique est convoquée dans les sources lointaines du roman noir, ainsi que du roman policier dans son ensemble. Mais ce n’est pas là ce qui nous intéresse, car nous avions analysé ces références à la tragédie antique comme source possible du roman noir en tant qu’élément de la stratégie de légitimation du genre. En revanche, la composante tragique du roman noir lui-même a autorisé une telle revendication de filiation. Elle a été soulignée par quelques critiques, directement ou en tant que forme exprimant le désespoir, comme Franck Evrard :
Centré autour de personnages ayant une fonction de boucs-émissaire et de victimes de la société et de sa mécanique policière, le polar met souvent en scène le meurtre rituel de l’individu par la collectivité. En cela, il est une sorte de roman tragique de la victimeNote849. .
De même, Stefano Benvenuti, Gianni Rizzoni et Michel Lebrun, dans Le Roman criminel, Histoire, auteurs, personnages, emploient le terme lors de leur évocation des fondateurs du genre, tels James Cain :
Ses criminels, au moment où ils tuent, mettent en mouvement des forces, des événements, qui d’une manière fatale se retournent contre eux pour les anéantirNote850. .
Jean-Pierre Schweighaeuser évoque quant à lui le « roman désabusé » qu’est le roman noir, dans lequel « il n’y a plus de possibilité d’optimismeNote851. » ; Anne-Lise Bâcle revient sur la « vision désespérée d’un monde au sein duquel l’homme est à la fois victime et bourreauNote852. . »
Le roman noir est-il un roman tragique ? Quel sens attribuer ici au terme de « tragique » ? On ne saurait en effet voir dans le roman noir une actualisation de la tragédie en tant que genre. Il faut donc se référer au registre tragique, qui excède à la fois le genre codifié formellement (et théâtral…) et la période littéraire qui a vu s’épanouir la tragédie, que l’on prenne pour point de référence la tragédie française (ce qui n’est pas le cas dans les références à la tragédie que nous avons relevées) ou la tragédie grecque.
3.1.2. Définir le registre tragique.
Alain Viala établit une définition du registre tragique en utilisant les travaux d’Yvon Brès dans son essai La Souffrance et le tragiqueNote853. . Ce dernier distingue la tragédie – qui relève du passé et plus précisément de l’antique – et le tragique, qui est une interrogation permanente, « dont ce genre [la tragédie] traite, donc qui en est un sujet essentiel mais que le genre n’épuise pasNote854. . » Cette interrogation est liée au « sentiment angoissé de la souffrance inéluctable inscrite dans la vieNote855. ». Le tragique naît du constat suivant :
Tout homme est à la fois engagé dans des conflits, professionnels, politiques et familiaux et, à un niveau plus profond, placé devant la souffrance de naître, de vivre et de mourirNote856. .
Il s’inscrit donc dans le courant qui considère que le tragique n’est pas seulement lié à la tragédie mais qu’il est un phénomène existentiel qui trouve une expression dans la tragédie ainsi que dans d’autres genres. Le tragique est donc lié à la fois à la notion de conflit et à celle de souffrance existentielle. Il semble qu’à travers ces deux aspects du tragique on retrouve deux grandes conceptions historiques du tragique.
Dans une conception traditionnelle, née de l’Antiquité grecque et en lien direct avec le mythe et le genre de la tragédie, le tragique est lié au conflit entre une liberté et une transcendance, ainsi qu’à la conscience d’un malheur inévitable. Le héros tragique subit en toute impuissance le déchaînement de forces supérieures (divines) qui contredisent sa volonté et le condamnent à un sort funeste. Si cette fatalité impose sa loi à l’homme, celui-ci n’est pas exempt de responsabilité, car comme le souligne Jacqueline de Romilly, « rien de ce qui arrive n’arrive sans le vouloir d’un dieu ; mais rien de ce qui arrive n’arrive sans que l’homme y participe et y soit engagéNote857. . » C’est même parce que l’homme a sa part de responsabilité dans le cours des événements que cette fatalité devient tragique.
Henri Gouhier refuse quant à lui d’associer systématiquement fatalité et tragique, et explique dans Le théâtre et l’existence que la fatalité devient tragique lorsqu’elle se heurte à une liberté qui lutte contre elle, quand elle « écrase une volonté qui voulait une autre destinée ». Ainsi, « un événement n’est pas tragique par lui-même mais par ce qu’il signifie et cette signification est tragique lorsqu’elle introduit une transcendance ». Ce phénomène met en jeu une conception tragique du destin et de la liberté humaine, posant inlassablement la même question : dans quelle mesure l’homme est-il la source et par conséquent le responsable de ses actes ? Pour nombre de chercheurs, le tragique et la notion de transcendance qui lui est liée sont nécessairement associées à une pensée religieuse, et ne sauraient être modernisés et laïcisés ; cependant, le sentiment tragique peut résulter d’une transcendance d’ordre politique : c’est alors l’angoisse d’un monde soumis à la tyrannie qui s’exprime dans la tragédie. Plus largement, le tragique exprime la confrontation entre des systèmes de valeurs, comme le souligne Max Scheler :
Tout ce qui mérite l’épithète de tragique relève de la sphère des valeurs et des rapports entre valeurs. (…) [Le tragique] est donc toujours soutenu ou fondé par des valeurs et des rapports entre valeurs. Mais en outre il n’apparaît dans cette sphère que là où les supports de valeur ne restent pas inactifs, et là où ils exercent de quelque façon une influence les uns sur les autres. (…) Il est nécessaire qu’une valeur soit détruite, si le tragique doit se manifester. Aussi n’est-il pas indispensable – dans le domaine des choses humaines – que l’homme soit annihilé quant à son existence et à sa vie. Mais il faut du moins que quelque chose en lui soit anéanti, un projet, une volonté, une force, un bien, une croyanceNote858. .
C’est une conception éthique qui ne saurait être autre chose que l’une des modalités du registre tragique, mais elle se révèlera intéressante pour aborder le roman noir.
Une conception plus moderne lie le tragique à la conscience que l’homme a de sa propre finitude, et de son impuissance à changer le cours des événements. Ainsi, le héros oscille entre désespoir et révolte, et le tragique résulte de la condition mortelle de l’homme et sa faiblesse. Le tragique est d’autant plus désespéré que nulle transcendance ne vient s’opposer à la volonté et à la liberté. Dans un monde sans dieu, rien ne vient donner sens à la destinée humaine, et la condition de l’homme se réduit à sa finitude.
Pour résumer, on peut considérer que le registre tragique est l’expression d’un sentiment de désespoir, de pessimisme et d’angoisse devant la fatalité qui s’exerce contre un individu condamné à souffrir et à mourir, devant l’impuissance de l’homme à imposer sa volonté et ses principes face à des forces et des valeurs transcendantes ou supérieures qui le conduisent à des actes entraînant sa propre perte. C’est donc le sentiment de souffrance et de désespoir qui naît du constat de l’aliénation de la volonté et de l’action humaine à des valeurs et forces antagonistes, et de sa soumission à sa condition de mortel.
Nous complèterons cette présentation du registre en apportant quelques éclairages supplémentaires sur le héros tragique et sur la tragédie, qui nous semblent utiles pour aborder le roman noir. La tragédie, comme expression privilégiée du tragique, n’apparaît pas dans n’importe quelles circonstances. Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, dans Mythe et tragédie en Grèce ancienne, montrent que la tragédie se met en place en Grèce à un moment où l’on hésite entre les traditions mythiques – comme instruments de pensée et de catégorisation du monde – et de nouvelles formes de pensée, juridiques et politiques, alors en pleine construction. Ainsi, dit Jean-Pierre Vernant, « la tragédie prend naissance quand on commence à regarder le mythe avec l’œil du citoyenNote859. ». En effet, « le genre tragique fait son apparition à la fin du 6ème siècle lorsque le langage du mythe cesse d’être en prise sur le réel politique de la cité ».
En outre, la tragédie antique, qui incarne la première conception du tragique évoquée ci-dessus, puise ses sujets de manière privilégiée dans la légende et le mythe, mettant en scène un héros mythique condamné à mourir et à déclencher les événements funestes le menant à la mort. Il se heurte à un principe de transcendance qui le dépasse et l’écrase car, comme le souligne Jean-Pierre Vernant, « le domaine propre de la tragédie se situe à cette zone frontière où les actes humains viennent s’articuler avec les puissances divines, où ils prennent leur sens véritable, ignoré de l’agent, en s’intégrant dans un ordre qui dépasse l’homme et lui échappeNote860. . » Le héros tragique peut cependant s’épanouir dans cette fatalité tragique au sens où elle lui permet d’accomplir son destin et de donner sens à son existence. En mourant, il acquiert une dimension sacrificielle et surtout une fonction modélisatrice, son parcours illustrant un aspect de la condition humaine. Cela suppose une clôture de la tragédie, le dénouement scellant le destin du personnage en une sorte d’accomplissement tragique. Le héros peut d’ailleurs éprouver ce que Jean-Louis Barrault appelle « une espèce de volupté tragique, qui chipe aux dieux sa propre destruction », c’est-à-dire un épanouissement dans l’accomplissement même du destin tragique.
Reste à savoir en quoi le roman noir est réellement lié au registre tragique, et en quoi il s’en éloigne, éventuellement. Peut-on parler à propos du genre « roman noir » d’une réactualisation ou de redéfinition du tragique ? Quelles sont les forces transcendantes qui y écrasent l’homme ? Quels sont les thématiques, les figures, les traits d’écriture qui s’apparentent au tragique ?
3.2. Le roman noir, réactualisation du tragique.
Cette réactualisation s’opère à plusieurs niveaux. Pour plus de clarté, nous organiserons cette étude en deux temps, en analysant tout d’abord les facteurs de surgissement du tragique, c’est-à-dire en analysant en quoi le roman noir est un roman tragique. Ensuite, nous repèrerons quelques procédés d’écriture (motifs, personnages, syntaxe) déterminés par le tragique à l’œuvre dans le roman noir. Précisons d’emblée que nous ne livrerons pas un relevé exhaustif ou statistique des occurrences du tragique dans le roman noir, mais que nous nous étaierons nos analyses par des exemples représentatifs et jugés significatifs.
3.2.1. Facteurs de surgissement du tragique.
On retrouve ici les deux sens attribués précédemment au tragique, en relation tantôt avec la crise du sujet conscient de sa finitude et de l’absence de sens de son existence (liée à l’absence de transcendance), tantôt avec l’écrasement de la volonté de l’homme par des forces transcendantes. En effet, le tragique du roman noir est très souvent associé à des déterminismes, qu’ils soient sociaux, sexués, ou ethniques ; ils peuvent également être liés à un « passé qui ne passe pas », un passé source d’aliénations familiales, mais aussi politiques, en quelque sorte, lorsque le personnage prend dans sa jeunesse des engagements (généralement clandestins) qui ont des répercussions funestes des années plus tard. Ce tragique peut aussi être qualifié d’existentiel, quand le personnage est renvoyé au non-sens de son existence, ou à la souffrance éprouvée devant le « dur métier de vivre » de qui se sait mortel et aliéné par des forces supérieures. C’est dire que les deux dimensions évoquées sont en réalité indissociables.
3.2.1.1. Des déterminismes tragiques.
Il peut sembler curieux de faire des déterminismes, quels qu’ils soient, des facteurs tragiques, comme s’ils étaient synonymes de fatalité. Emile Zola avait pour sa part, dans Le Roman expérimental, pris soin de faire la distinction entre déterminisme et fatalisme, reprenant en cela le raisonnement de Claude Bernard. Pourtant, dans nombre de romans noirs, les deux sont associés, les divers facteurs déterministes étant susceptibles de se transformer très rapidement en fatalité pour les personnages parce qu’ils sont facteurs de transcendance. L’état de la société est sans doute très différent aux yeux de Zola et aux yeux des auteurs de romans noirs des années 1990-2000 ; Zola – l’ensemble des naturalistes, en fait –, en dépit de constats alarmants, vivait dans une société en plein bouleversement et croyait à la notion de progrès et au rôle des écrivains dans une possible amélioration de la société. Les auteurs de roman noir de la fin du 20ème siècle ont quant à eux définitivement perdu leurs illusions, si l’on en croit leur analyse des déterminismes sociaux. C’est un monde dévasté par le capitalisme et les ravages de l’idéologie libérale qu’ils dépeignent ; dans cette société, pour la plupart d’entre eux, ne subsiste aucun espoir de révolution, de progrès ou de changement. C’est pourquoi le roman noir peint souvent la condition des damnés de la terre, des dominés, qui déclenchent le mécanisme tragique au moment même où ils tentent d’échapper à leur condition ou tout simplement d’accéder à un peu de bien-être.
On peut repérer trois grands types de déterminismes, qui peuvent d’ailleurs s’additionner. Les déterminismes sociaux pèsent lourd dans le roman noir, et appartenir à une classe sociale peu élevée peut condamner un individu. Le roman noir expose la domination du nouveau tiers-état : personnes non qualifiées, condamnées à des emplois durs et sans intérêt, ou exclus du monde du travail, voués à la misère et parfois rejetés à la rue. Ce sont les damnés de la terre, les oubliés de la société de consommation, écrasés sans pitié dès qu’ils veulent protester ou même accéder à une condition meilleure. Dans Le Roi des ordures de Jean Vautrin, des hordes d’habitants des favelas de Mexico fouillent les ordures d’une gigantesque décharge pour survivre :
En même temps que lui, tout un peuple asservi se déplace. Attentivement courbé, avec des bâtons, des gaffes, des outils de fortune, il creuse, fouille, trie, soupèse, rejette, entasse. Pieds nus à Albuplast, mains crevassées, visages tendus par la quête, une sorte de boulimie du désespoir emprisonne des centaines d’êtres, les pousse vers le sommet de la décharge, les oblige à passer à côté de leurs semblables sans les voir, sans les regarder, sans que se glisse dans leur lente recherche la plus infime trace de fraternitéNote861. .
Dans La Vie de ma mère ! de Thierry Jonquet, le lecteur n’envisage à aucun moment une issue positive pour le narrateur, un adolescent de milieu défavorisé vivant à Belleville. Son origine sociale semble le marquer et le condamner ; dans un foyer sans père, il vit aux côtés de sa mère qui occupe des emplois précaires pour faire vivre sa famille, et au début du roman, de sa sœur et de son frère, garagiste qui vont tous deux quitter très vite le foyer familial. Selon un effet d’ironie tragique, c’est au moment où sa mère trouve un emploi stable mais l’obligeant à laisser son fils sans surveillance que le jeune homme va basculer dans la délinquance :
L’assistante sociale, à la mairie, elle lui avait trouvé un boulot. Pas un emploi solidarité, un truc de bouffon, non, un vrai ! À l’hôpital Lariboisière, à côté de Barbès, justement. Ma reum, elle devait répondre au standard, c’était génial, le seul problème c’est que c’était la nuit. Elle devait commencer à sept heures le soir, jusqu’à cinq heures du matin. On a discuté si elle allait accepter, si j’allais savoir me débrouiller tout seul pour la bouffe, le soir, et tout. Je l’ai rassurée, c’était pas le moment de l’emmerder, pour une fois que je pouvais l’aiderNote862. .
À l’exclusion sociale s’ajoutent l’exclusion scolaire – il est en section d’éducation spécialisée – et le hasard de deux rencontres, celle d’une jeune fille de milieu favorisé au collège, pour qui le garçon va vouloir progresser mais aussi acquérir un certain pouvoir économique, et celle d’un délinquant sur le quai d’un RER. En un second effet d’ironie tragique, les effets positifs de la première rencontre sont en quelque sorte « corrigés » par la seconde, qui va faire plonger le personnage dans la délinquance puis dans la criminalité.
Aux déterminismes sociaux s’ajoutent les déterminismes ethniques ; être immigré ou enfant d’immigré suffit à bloquer toute possibilité d’ascension sociale. Dans Foulée noire de Franck Pavloff, Johnson, un Kenyan clandestin qui travaille sur des chantiers de construction grenoblois, relate son trajet, d’abord ascendant :
Quand t’es gamin tu cours sur le chemin de l’école, vingt kilomètres par jour tout simplement parce que c’est amusant. Puis tu cours pour aller au lycée, tu cours pour faire comme les champions du 10000, les Peter Rono ou les Peter Cœch qui sont tes idoles. Puis si t’as la chance d’avoir des parents qui possèdent un peu de terre à café ou une plantation de canne à sucre, tu t’inscris au Saint Patrick’s High School et là, tu cours de plus belle ! Tu t’entraînes avec les autres seize heures par jour, pour être le meilleur, pour décrocher un contrat, pour aller à Londres ou dans une université américaine. Puis tu cours pour gagner du fric, pour monter sur les podiums du monde entier ! (…) Les hyènes attendent leur heure ! Tapies sur la route qui mène de la Rift Valley aux quais de l’Isère elles guettent les gazelles des hauts plateaux comme disent tes confrères sportifs, pour leur bouffer les entrailles et les mettre sur le trottoir des stades Note863. !
La couleur de sa peau le rattrape bientôt et le condamne, malgré ses compétences et son niveau d’études, à ce travail sur un chantier, et à son statut de clandestin :
J’ai rencontré Raillane dans une clinique de Marseille où mon soigneur m’avait largué avec une double fracture de la cheville. Finie l’épopée du grand Johnson ! Il m’a proposé de rester en France, il connaissait le patron d’un immense chantier… (…) Moi qui descendais sous la barre des 25 minutes aux 10000, moi qui ai un master d’économie politique dans la poche, qui jacte français avec l’accent de la Sorbonne ! Foreman ! Tu vois, poursuit-il, ce que les blancs achètent aux noirs, c’est les muscles, jamais la têteNote864. .
Le même statut de clandestin, dans Le Soleil des mourants, condamne Abdou, jeune Algérien pour qui s’ajoute au traumatisme de l’exil celui des exactions dont il a été témoin dans son pays d’origine, ainsi que la certitude d’être expulsé dès ses dix-huit ans :
On se fait rien qu’entuber par des mots, je crois. C’est comme avec le juge, tu vois. Son rôle, il dit, c’est de nous aider dans notre situation. Il dit ça comme ça, l’enfoiré ! Au début, tu penses qu’il est gentil, tout ça. Puis, dès que t’y réfléchis un peu, que tu grattes derrière ses phrases, tu comprends qu’à dix-huit ans t’es bon pour le retour au pays. Que tu le veuilles ou nonNote865. .
Enfin, le dernier grand type de déterminisme mis en valeur est celui lié au genre : être une femme est une difficulté supplémentaire dans le roman noir, voire une fatalité insurmontable. Les auteurs démontent une société dominée par les hommes, et peuplée de prédateurs, ce qui condamne nombre de femmes à être des victimes. Elles sont asservies sexuellement (abus sexuels, proxénétisme) ou par la dépendance à la drogue : c’est le cas chez Jean-Claude Izzo, chez Pascal Dessaint, Marc Villard, Michel Steiner, Pierre Siniac, entre autres. Dans Cœur sombre, Alex, guitariste, revient sur la fatalité qui s’est abattue sur elle en la personne de Montana ; pour elle, la seule alternative à cette aliénation était la mort :
Quand il t’a poussée dans son gourbi, tu aurais pu te jeter par la fenêtre ou revenir à Barbès. Tu imagines la jouissance : tu aurais évité cette ordure de Montana. Mais il t’avait dans la peau, Alex. Tu voudrais oublier ce jour pourri où, allongée sur le plumard avec ta dope, il t’a proposé un gros deal derrière la boîte d’Abdullah. C’était pas ton truc, Alex, dealer 20 grammes à deux Blackos défoncés au crack. Mais tu as dit oui car tu seras toujours une vraie cloche qui se coltine le sale boulot. Tu voudrais oublier sa voix de marécage qui disait : « Prends un calibre, Alex, on sait jamais. » Ils disent tous ça, Alex, avec des variantes du genre : « Après, on pourra partir nous deux » ou bien « On vivra comme des princes, tu m’auras tout à toi, ma biche »Note866. .
Le personnage a donc sa part de responsabilité dans les événements tragiques : elle dit oui à cette proposition de deal.
La domination sexuelle peut être renforcée par la domination sociale et raciale, par exemple chez Jean-Claude Izzo chez qui les jeunes femmes d’origine maghrébine et populaire sont particulièrement exposées. Dans Total Khéops, Leila est la fille d’un ouvrier ; elle fait des études supérieures – maîtrise de lettres – et se destine à être professeur de français. Mais elle est violée puis assassinée par un groupe d’hommes. Fabio Montale fait ce constat après sa mort :
Leila, tu vois, elle l’a eue cette chance, qu’un enfant d’immigré sur des milliers peut avoir. Ce devait être trop. La vie lui a tout reprisNote867. .
Félix, jeune femme au surnom masculin, est dans le roman de Philippe Carrese, Le Bal des cagoles, doublement victime. Originaire des quartiers nord de Marseille, sans éducation ni culture, elle se retrouve prise au piège de ses rêves d’ascension sociale. En effet, Félix rêve d’être chanteuse, ou plus précisément, star de la chanson. Condamnée par son milieu – très défavorisé –, par les hommes qui l’entourent et qui ne voient en elle qu’une manière de gagner de l’argent, elle va être asservie par l’industrie pornographique, avant d’être tuée au moment où elle tentait d’échapper à ses « patrons ». Le roman se clôt sur sa mort dans un accident de voiture volontairement provoqué par ses poursuivants.
Dans Le Roi des ordures, la jeune Isabel, seize ans, qui vit dans les favelas, améliore le quotidien de sa famille en subissant les abus sexuels du « roi des ordures » :
Isabel ne rend pas les choses faciles. Après chaque passage de son amant, la petite dit qu’elle n’aime pas trop être obligée d’avoir le patron sur son ventre. Que Don Rafael est brutal quand il s’excite. Alors, heureusement que Popeye est là. Popeye, c’est le grand-père Ramos. (…) Avec son expérience et sa force de persuasion, il lui fait comprendre qu’il vaut mieux qu’elle s’habitue tout de suite, parce que plus elle rendra le patron heureux, plus il se montrera généreux avec nous autresNote868. …
Il n’y a guère que dans les romans de Virginie Despentes que la domination masculine se retourne contre les hommes, sans que cela change quoi que ce soit d’ailleurs au sort des femmes. La domination sexuelle et économique entraîne de la part de ses personnages féminins un déchaînement de violence. Il ne s’agit pas à proprement parler de vengeance, ces femmes se contentent de se comporter comme les hommes. Cela leur est généralement fatal, si l’on excepte Les Jolies choses, certes moins violent que Baise-moi et Les Chiennes savantes, et dont le dénouement est positif pour l’héroïne.
Enfin, les femmes sont fréquemment, dans le roman noir, victimes d’inceste, et par conséquent de la domination masculine et plus précisément paternelle. Mais l’inceste est généralement traité comme un motif d’aliénation qui retentit sur les comportements et choix de l’adulte : si la femme victime d’un inceste est une figure tragique, c’est que le traumatisme subi la transforme des années plus tard en meurtrière psychotique. C’est là un deuxième motif d’aliénation tragique, celui du passé aliénant.
3.2.1.2. Un passé qui ne passe pas.
Le poids du passé s’exerce essentiellement de deux manières dans le roman noir : en lien avec des engagements anciens parfois clandestins, au niveau politique, idéologique, généralement dans des périodes de crise historique ; en lien avec des traumatismes dus à des violences subies pendant l’enfance, souvent au sein du milieu familial.
Nous évoquerons rapidement le poids des engagements politiques relatifs à la période de l’Occupation ou de l’accès à l’indépendance de l’Algérie, car ces aspects ont été traités précédemment. Souvent d’ailleurs, ce retour du passé et d’événements historiques enfouis par la mémoire collective ne prend pas à proprement parler de coloration tragique, si ce n’est bien sûr qu’il entraîne des meurtres. Toutefois, dans certains romans, le passé revient hanter les personnages et peser sur leur vie de manière tragique. Il s’agit parfois du poids de l’Histoire et de la culpabilité liée à certains actes ou à certaines défaillances. Ainsi, l’intrigue criminelle des Orpailleurs de Thierry Jonquet est en rapport avec l’Occupation : Maurice Rosenfeld tue une jeune femme qui porte la bague ayant appartenu à sa fiancée morte en camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, en partie par sa faute. Alors que la jeune fille devait fuir Paris, Maurice Rosenfeld avait insisté pour la voir une dernière fois et lui offrir une bague en témoignage de leur amour ; le retard pris par la jeune fille avait permis à la Gestapo de l’arrêter. Lorsque la bague ressurgit au doigt d’une jeune femme dans les années 90, le vieil homme veut la racheter, mais à la suite de la transaction ratée, il bascule dans le meurtre. La bague semble porter une malédiction, avec sa forme et sa couleur (rubis) :
Il avait pris plaisir à tuer. La souillure avait été lavée, une seconde fois. Et il savait. (…) La lampe de chevet était allumée et diffusait une lumière très douce. Il avait disposé un foulard sur l’abat-jour, un foulard de soie beige, aux teintes passées. Un foulard qui lui avait appartenu, à elle. Il regarda l’œil rouge, qu’il avait placé dans un écrin tapissé de soie blanche, et qui reposait sur la table de chevet, tout près de luiNote869. .
Dans Né de fils inconnu de Patrick Raynal, le narrateur, un commissaire, ancien gauchiste, voit son passé politique ressurgir alors que son fils, qu’il ne connaît pas, est suspecté de braquages. À la fois pour conjurer le passé et pour sauver son fils, il va devenir un meurtrier. Le jeune homme semble avoir rallié les engagements d’autrefois de son père, et avoir basculé dans l’illégalité pour alimenter les fonds de groupuscules d’extrême-gauche :
Les R.G. aimeraient bien lui poser des questions sur un nouveau groupuscule marxiste-léniniste qui collecterait des fonds pour venir en aide à tous les planteurs de merde du vaste monde. (…) Et ces connards sont aussi persuadés que c’est mon fils qui braque les boutiquiers de la ville. C’est ce qu’ils croient, hein ? Qu’on alimente les fonds de caisse de la Révolution mondiale avec les fonds de caisse du petit commerceNote870. .
Bref, il avait l’air vachement content de rencontrer un camarade de son père. On a bu un coup ou deux et il m’a confié qu’il était en train de reprendre les choses où nous les avions laissées. Il ne nous reprochait rien, il disait simplement qu’il fallait continuer une chose qui avait été laissée en chantier. Il avait l’air terriblement sérieux, RayNote871. .
C’est également son passé gauchiste qui ressurgit dans la vie du héros du Pied-Rouge de François Muratet. Cet ancien militant d’un groupuscule révolutionnaire revoit, après des années, son compagnon de lutte d’alors, Max Vroelant, qui avait rallié pendant la guerre d’Algérie le FLN puis fondé cette organisation clandestine en France. Le lendemain de ces retrouvailles de hasard, Max est assassiné par d’anciens membres de l’OAS, dont l’un est commissaire de police. Ce dernier voyait sa position respectable menacée par des mémoires que Max projettait de publier : il l’a fait tuer, puis s’en prend au personnage principal, à qui Max a remis son texte. Le héros est acculé au meurtre, pour sauver sa propre vie.
Le passé politique n’est pas le seul lien tragique avec le passé. Plus puissamment tragiques sont les traumatismes subis pendant l’enfance, généralement dans le milieu familial, institution sociale profondément violente dans de nombreux romans noirs, en particulier contre les personnages féminins. Ces violences sont tragiques parce qu’elles déterminent de manière irrémédiable la vie d’adulte, et parce que dans de nombreux cas elles acculent leurs victimes au meurtre, qu’il s’agisse d’une vengeance contre le responsable ou d’un déchaînement de violence meurtrière aveugle liée à leur état psychotique. Dans Un été pourri de Maud Tabachnik, Fanny est une meurtrière en série, qui tue généralement quand un homme lui fait des avances. Son état est lié à un traumatisme vécu à l’adolescence, comme en témoigne le récit fait par l’un des personnages :
Laissez-moi terminer. Il y a un peu plus de dix-huit ans, Fanny vivait avec sa mère et un beau-père dans une baraque assez minable, et un soir, d’après le canard, le beau-père est arrivé avec un copain, a violé sa femme et le copain a violé Fanny. Peut-être bien que le beau-père s’en est mêlé, j’sais pas. L’article n’était pas clair. J’ai voulu voir le journaliste, il avait déménagé des années auparavant et personne ne pouvait me parler de rien à part un vieux typo à moitié gâteux. Fanny a été, d’après ce qu’il m’a dit, placée à l’Assistance et la mère dans un asile de dingues. Elle vient d’ailleurs d’y mourir. Je suis allé à l’Assistance et une des éducatrices qu’était toute jeune à l’époque s’est souvenue de Fanny. Elle m’a dit que Fanny était tellement folle qu’elle foutait la trouille à tout le mondeNote872. .
De même, Proserpine, l’héroïne d’Une pieuvre dans la tête de Pascal Dessaint, est une tueuse en série et une victime : elle tue des hommes qu’elle vient de séduire, à l’image de la scène qui ouvre le roman. Elle les poignarde au moment de l’acte sexuel et garde leur cœur comme trophée. C’est au chapitre vingt que sont livrées les clés de sa folie meurtrière, dans une analepse :
Elle se souvient… Ça faisait dix ans que papa vivait avec eux. Eux, c’est-à-dire elle, sa mère et le petit, son petit… (…) Et puis ce père, pour qui elle vouait une admiration sans bornes dans l’absence, avait enfin exaucé ses vœux… Et elle n’avait pas été surprise lorsque la première fois il lui avait proposé de partager le même bain, ni lorsqu’il l’avait prise nue dans ses bras pour la coucher dans son lit… Le malheur a pris la forme de cinq ronds de lumière crue dans le rétroviseur, ce soir-là… (…) Papa, il a tout de suite compris, et il en a perdu tout sang-froid, mais il ne pouvait pas savoir que c’était la dernière station essence avant longtemps, non, il ne pouvait pas savoirNote873. …
Alors qu’elle est adolescente, cinq hommes à moto attaquent la famille en voiture, violent et tuent la mère, tuent le jeune fils de Proserpine, blessent gravement le père et violent Proserpine. Adulte, sa psychose la conduit à tuer cinq hommes. Ce roman souligne la nature tragique de ce personnage, dont le prénom, « original et tragique », comme elle le dit elle-même, n’est pas choisi au hasard par le romancier, nous y reviendrons.
Le passé aliénant est un ressort fréquemment utilisé dans le roman noir pour analyser les raisons qui poussent un être à devenir meurtrier. C’est aussi le cas de Fils de femme de Hélène Couturier. Un serveur tue une femme ; cet homme a été abandonné par sa mère lorsqu’il était enfant. La femme qu’il tue a un fils qu’elle chérit mais qui la délaisse, et c’est parce qu’il les voit déjeuner ensemble une fois par an dans le restaurant où il travaille qu’il s’intéresse à elle, jusqu’au meurtre. Cela conduit la narratrice à s’interroger :
En fait, je ne peux m’empêcher d’être obsédée par la personnalité du serveur. Est-ce parce que sa mère à lui l’a abandonné, a préféré les hommes à lui, qu’il s’est vengé sur Madeleine qui elle, a toujours gardé son enfant auprès d’elle ? La tuer, était-ce une manière de tuer sa propre mère ou au contraire de défendre le choix de sa mère ? Ou bien encore, est-ce justement parce qu’il a senti la détresse de cette femme délaissée de tous, même de son fils, qu’il a décidé de mettre fin à cette solitudeNote874. ?
À ces facteurs sociaux de surgissement du tragique dans le roman noir, s’ajoute un tragique lié non à des causalités extérieures mais à la douleur même de mener une existence vide de sens, sous le signe de la douleur et de la finitude.
3.2.1.3. Un tragique existentiel.
De nombreux héros, quelle que soit l’issue du roman noir, sont en proie à un mal de vivre et à un désespoir qui en fait des personnages tragiques, qui ne parviennent pas à trouver des valeurs susceptibles de donner sens à leur existence, ou qui échouent dans toutes leurs tentatives pour cela. Souvent déçus par cela même qui aurait dû ou pu organiser leur vie, ils se révèlent incapables d’être heureux, voire totalement désespérés ; cet état est déjà le leur lorsque s’ouvre le roman noir, mais dans certains cas, les événements qui composent la diégèse accentuent ce mal-être jusqu’à provoquer leur perte. Ce type de personnages, majoritairement masculin, est en partie hérité du hardboiled américain, et notamment de la figure du privé, en rupture personnelle et échouant dans toutes ses tentatives. Jean Vautrin joue ainsi avec les traits du privé dans Le Roi des ordures ; Harry Vence, détective minable, tente de venger une jeune fille abusée par le « roi des ordures », mais lorsqu’il arrive pour le tuer, il est déjà mort. Sa tentative héroïque échoue, et se retourne même contre lui puisqu’il est suspecté du meurtre, à propos duquel il est interrogé :
La bouteille de tequila est vide, mais une pleine vient la rejoindre. Harry bouge son torse ankylosé par l’immobilité. Il a parlé sans discontinuer. L’air lui semble torride, chargé d’odeurs vivantes. De temps en temps, il s’est interrompu pour écouter les voix de l’orchestre de jazz. (…) Avec l’obstination de celui qui n’a plus rien à perdre, Harry continue de s’aventurer sur le territoire de la vérité, exactement là où la menace de la mort la plus noire rôde à chaque coin de phrase. (…)
-Je n’ai pas tué don Rafael Gutierrez Moreno, monsieur. Il faut me croire. Mais laissez-moi d’abord vous dire comment les choses se sont passées…
-Pas la peine, Harry. Je sais bien que tu as tout raté, comme d’habitudeNote875. .
On voit ici affleurer un certain nombre de stéréotypes du privé hardboiled : l’alcool –de fait, les enquêteurs du roman noir, dans notre corpus, aiment beaucoup boire, quand ils ne sont pas purement et simplement alcooliques. Quelques pages plus loin, le récit de Harry – qui correspond en fait à celui que vient de lire le lecteur – se clôt sur son suicide :
Devant la gare routière, Harry Vence hurle du même cri que toutes les gorges de l’homme qui s’apprête à mourir. Il se tire une balle dans la bouche. Mexico se rendort sur le ventreNote876. .
L’univers de Hugues Pagan est tout entier construit sur ces personnages de perdants, flics abîmés par leur profession et par leur vie affective, sous le signe de l’échec, en proie au plus total désespoir, qui se dénoue généralement dans la mort ou l’oubli de soi-même. Ce sont les baltringues, évoqués dès les premières lignes de Dernière station avant l’autoroute :
Baltringue on naît, baltringue on meurt, il n’y a pas à sortir de là… C’était comme ça, joué d’avance et d’avance perdu… (…) On a beau se rappeler après le monde des vivants… Séduisant et fourbe, pour fascinant qu’il avait l’air de loin, c’était une belle vacherie parfaitement hors de prix, faite de toc et de tape-à-l’œil, de parlotes creuses et de clinquant, triste comme une assiette de choucroute froide et de surcroît excessivement salissante à force de petites ententes avec les autres, avec soi, de tripotages, de renoncements obligés. Il en aura fallu, du temps, pour comprendre, pour ainsi dire, presque toute l’existence… Baltringue, quand même au bout du compte, tout ce qu’on aura gardé au fond de son cœur, à soi tout seul, de tendre et de doux, d’intact, c’est bien nos mortsNote877. .
Ce sont les victimes que les flics de Pagan croisent, morts ou vivants, et ce sont ses héros eux-mêmes, irrémédiablement seuls, et qui se définissent comme morts, morts à la vie, au bonheur, bonheur qu’ils ont généralement fugitivement entrevu avec une femme qu’ils ont perdue. Dans les dernières pagesde L’Etage des morts, le narrateur fait face à la seule femme qu’il ait aimée, Calhoune, officier de police corrompue qui a tué Franck, ami du narrateur – lui aussi flic corrompu ; il est persuadé qu’ils vont s’entretuer, et tous deux évoquent leur désespoir :
Moi aussi, je m’étais cru trop fort. Un homme seul, dans une histoire sans contours. Pour un peu, si je l’avais pu, j’aurais pleuré sur tous nos petits espoirs bien vains, ces petites occasions manquées, cette triste trame usée de nos vies, sur Calhoune, sur Franck et sur Léon et nos infimes destins croisés, et peut-être bien sur moi, après toutNote878. .
Le narrateur de L’Etage des morts a ainsi vu toutes ses valeurs s’effondrer : la foi en son métier de policier, l’amitié – son meilleur ami Franck, policier corrompu, a été assassiné ; l’amour – Calhoune est la seule femme qu’il ait jamais aimée, et elle l’a trahi comme elle a trahi Franck. De manière certes paroxystique, les personnages de Pagan incarnent les héros désabusés du roman noir, qui ne peuvent se raccrocher à aucune valeur, pas même l’amour, qui leur a échappé. Fabio Montale, héros de la trilogie marseillaise de Jean-Claude Izzo, a un parcours comparable. Il démissionne de ses fonctions de policier dès la fin du premier volume, désespéré par son impuissance, et voit dans le troisième volume mourir tous ses proches. Dans les dernières pages de Solea, alors qu’il est sur le point d’être tué lui-même, échouant dans sa lutte contre la Mafia, il voit Babette, la femme qu’il aime, mourir :
Je plaquai ma bouche sur la sienne, comme un fou. (…) Pour cet impossible baiser que je voulais qu’elle emporte. Mes larmes coulaient. Salées, elles aussi. Sur ses yeux ouverts. J’embrassai la mort. Passionnément. Les yeux dans les yeux. L’amour. Se regarder dans les yeux. La mort. Ne pas se quitter des yeuxNote879. .
Ainsi, le héros du roman noir est généralement seul, même lorsque cela n’aboutit pas à une issue fatale. Maurice Laice, héros récurrent de Chantal Pelletier, est également un personnage en rupture, qui vit douloureusement sa solitude :
Ne fréquentant cette turne que pour dormir et se laver, il se foutait la plupart du temps du bordel qui régnait chez lui, mais certains matins, le blues l’attrapait. Quand on n’a que ses bras pour se consoler, l’espoir n’est pas facile d’entretien. (…) Un vieux bouc dont la violente odeur de suint n’électrisait plus aucune femelleNote880. .
De même, Adamsberg, héros récurrent des romans de Fred Vargas, vit douloureusement ses amours épisodiques avec Camille, comme en témoigne la fin de L’Homme aux cercles bleus :
Il ne voulut pas regarder le train quand celui-ci repartit. Il resta sur le quai, les bras croisés contre lui. Il s’aperçut qu’il avait oublié sa veste dans le compartiment. Il imagina que Camille l’avait peut-être enfilée, qu’elle était jolie comme ça, qu’elle avait ouvert la fenêtre et qu’elle regardait le paysage dans la nuit. Mais il n’était plus dans le train pour savoir quoi que ce soit de Camille à présent. Il voulait marcher, chercher un hôtel devant la gare. Il reverrait la petite chérie. Une heure. Disons au moins une heure avant de creverNote881. .
À travers certains de ces personnages de femmes, c’est un autre type tragique qui affleure dans le roman noir, celui de la femme fatale, autre héritage du hardboiled. Conformément à la tradition, elle incarne l’érotisme et mène le héros à sa perte, ce qui lui est parfois aussi fatal qu’à lui. Si la femme fatale du roman noir français des années 1990-2000 a connu la libération sexuelle et une émancipation qui en fait souvent une femme capable de s’assumer financièrement, elle n’en a pas moins tous les attributs de la vamp des romans de James Cain ou de Chandler. Tonino Benacquista joue avec les codes dans Les Morsures de l’aube, comme Gérard Delteil dans Dernier tango à Buenos Aires :
Elle avait tout l’attirail, le tailleur noir, le porte-jarretelles qu’on repère sous la fente de la jupe, les talons aiguilles, le maquillage, tout. Une caricature de femme fatale, en grosNote882. .
C’est là, en relevant le nez pour affronter le maelström, que j’ai vu la fille. (…) Oui, la panoplie, elle l’a vraiment, on voudrait se déguiser en femme fatale qu’on ne s’y prendrait pas autrement. Une tenue de combat. Un outrage. En noir des pieds à la tête, avec tout l’attirail fantasmatique de base, sans un iota d’imagination, pas la plus petite touche personnelle, rien, rien qu’une imagerie au ras du trottoir et du tailleur Chanel. Ou alors si, peut-être ses dessous, qu’elle parvient à cacher. Mais on ne pense pas tout de suite à du Damart. Vulgaire pour l’un, typée pour l’autre, et terriblement bandante pour le reste. Moi, elle me foutrait plutôt la trouilleNote883. .
C’est une femme en imperméable, genre trench-coat. Elle porte des lunettes teintées et dissimule ses cheveux sous un foulard. J’aime les femmes en imperméable – ça me rappelle Lauren Bacall – et je ne déteste pas non plus les fichus et les lunettes noires qui évoquent pour moi les accessoires de Grace Kelly dans je ne sais plus quel Hitchcock. Mais la visiteuse sort de l’ascenseur et non d’un film, il ne pleut pas, ce n’est pas la saison pour mettre un imper, et ce n’est plus la mode de se nouer un foulard sous le menton, du moins je ne m’en étais pas aperçuNote884. .
Surtout, les femmes du roman noir peuvent être considérées comme fatales parce que c’est par elles que le malheur arrive ; leur rencontre déclenche une série d’événements qui mènent le héros à sa perte, soit que la volonté de les séduire entraîne l’homme à des actes inconsidérés qui le mènent en prison ou à la mort (elles peuvent d’ailleurs avoir été utilisées par des tiers à ces fins), soit qu’elles s’avèrent être elles-mêmes de dangereuses meurtrières. Elles sont repérables par leur grande beauté, et dans certains cas, par une allure qui n’est pas sans rappeler les femmes fatales du roman noir américain, comme dans Milac de Jean-Paul Demure :
Tandis que Jusseau arrachait quelques poils à sa moustache clairsemée, Milac suivit le dé qui s’arrêta près d’une table. Il s’accroupit en souplesse, tendit la main et demeura ainsi un bref instant, le temps que son regard, d’abord attiré par une paire s’escarpins de cuir bordeaux ornés d’un motif qui suggérait un entrelacs de papillons, remonte sans vergogne le long de jambes racées jusqu’au bord d’une jupe noire serrée au-dessus de genoux ronds, séduisants. (…) Elle avait un regard lointain, immobile comme une eau noire. Malgré sa pose alanguie – les avant-bras abandonnés de part et d’autre d’une tasse de café froid, les épaules appuyées contre la banquette – il rôdait sur son corps délicieux une ombre contrainteNote885. .
Dans tous ces cas de figure, la fascination, le pouvoir de séduction de ces femmes va entraîner les hommes malgré eux, et parfois malgré elles. Certaines sont des manipulatrices, comme Sih-Né dans Massilia Dreams, qui est en fait une prostituée payée pour séduire et manipuler le narrateur, ou Lila dans Une simple chute, qui va entraîner le narrateur à sa suite, le rendre complice de deux meurtres ; elle-même va se suicider, tandis que le roman se clôt sur l’arrestation du narrateur :
Je voulais comprendre ce qui m’arrivait. Lila m’avait choisi pour l’accompagner jusqu’au bout, et je n’étais plus qu’une épave. Je me suis alors souvenu d’une phrase, prononcée à la télévision par un responsable des enquêtes concernant les noyés de la Tamise : « Quand quelqu’un saute dans le fleuve, c’est là que tout commence. » (…) Quelque chose me possédait. Un désir tenace, m’enfermer avec Lila quelque part, ne penser qu’à elle, ne parler que d’elle. C’était absurde. Je suis rentré en ville. Je me suis garé au même endroit que d’habitude. La police m’attendait dans le salon, avec MaryseNote886. .
Certaines sont des femmes fatales au sens littéral, pourrait-on dire, dans la mesure où elles sont des meurtrières ; Simone dans Poste mortem séduit les hommes pour les tuer, comme dans Une pieuvre dans la tête Proserpine, redoutable tueuse en série évoquée plus haut ; on a vu qu’elle menait Desbarrats à sa perte, lui qui conclut le roman par ces mots :
Il y a plus torride que l’enfer, ça s’appelle la fatalitéNote887. .
Mais on le voit à travers l’exemple de Proserpine, la femme fatale, dans le roman noir des années 1990-2000, est aussi la plupart du temps une victime. Victime comme Sih-Né, qui va mourir sous les coups de couteau du narrateur pour avoir non seulement bouleversé sa vie et trahi sa confiance mais aussi avoir provoqué le suicide de son épouse; victime comme Lila qui se suicide, ou comme la jeune femme apparue à Milac, manipulée par les services secrets français et qui sera assassinée. La femme fatale n’est donc pas tragique seulement parce qu’elle mène le héros à sa perte de manière inéluctable, mais aussi parce qu’elle est elle-même un personnage promis à la mort.
Ainsi, le tragique du roman noir réside dans cette vision de l’homme et de son existence vouée à la souffrance devant des forces supérieures qui l’écrasent ou devant la difficulté de vivre quand on se sait seul et condamné à mourir. Si une telle conception apparaît bien sûr au niveau sémantique, elle va être véhiculée également par des procédés narratifs et structurels, par tout ce qui relève de ce que l’on pourrait appeler une syntaxe tragique.
3.2.2. Une syntaxe tragique.
Toute l’organisation du récit semble en effet déterminée par la nécessité de mettre en valeur la causalité tragique. Il ne s’agit pas ici de revenir sur les modes d’organisation du roman noir, déjà traités précédemment, mais simplement de souligner, par quelques exemples, que le choix de tel mode d’organisation du récit peut valoir pour marqueur tragique.
3.2.2.1. Le recours au mythe.
Le mythe, qui a servi de point d’appui à de nombreuses tragédies dans l’Antiquité, est utilisé par certains romans noirs comme procédé visant à souligner le caractère tragique des événements relatés. Quelques références sont seulement ponctuelles, voire anecdotiques, comme celle contenue dans le titre du roman de Chantal Pelletier, Eros et Thalasso, qui vaut davantage pour le jeu de mots que comme référence éclairante, ou l’allusion à Moloch, plus intéressante, dans le roman de Thierry Jonquet :
-Tu diras aux enfants d’Israël : si un homme des enfants d’Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l’un de ses enfants, il sera puni de mort, murmura-t-il.
-Lévitique, XX ! rétorqua Elie, sans l’ombre d’une hésitation.
-Eh bien voilà, pour que tu comprennes, disons que je vais à la chasse au MolochNote888. !
De fait, la référence – plus biblique que tragique – donne au roman, dès le titre, une résonance tragique ; il sera question d’enfants dévorés par les adultes comme par Moloch. Mais d’autres romans proposent une intrigue criminelle tout entière éclairée par le recours au mythe, comme par exemple Une pieuvre dans la tête de Pascal Dessaint, dont il a précédemment été question. La tueuse se prénomme Proserpine, et semble agir à l’égal de la déesse des Enfers. Le mythe est d’ailleurs évoqué à plusieurs reprises dans le roman, et conditionne la trajectoire de la jeune fille, la muant en un destin tragique. Comme la déesse des enfers, elle a un fils de son propre père, fils que ses violeurs tueront et qu’elle vengera par procuration, en assassinant cinq hommes à qui elle arrache le cœur. Mais la malédiction ne s’arrête pas à ses actes, puisque le policier qui la démasque n’est autre que son demi-frère (que son père a eu d’un autre lit). Il la tue alors qu’elle vient d’arracher le cœur de sa cinquième victime, et devient lui-même un clochard, anéanti d’avoir tué sa demi-sœur. À travers cet exemple, on voit que le roman noir ne réussit pas tout à fait à se libérer du mythe et au contraire, en revendique l’héritage. Pascal Dessaint en fait également usage dans Bouche d’ombre, avec le mythe d’Arachné, métaphore à la fois de l’existence de Daniel, frère diabolique d’Elvire, qu’il viole régulièrement, et d’Elvire elle-même, qui telle Arachné, rêve de défier et de battre son frère, s’identifiant à une araignée qui tisse sa toile.
Meurtres à l’antique d’Yvonne Besson est entièrement fondé sur les mythes d’Antigone et d’Œdipe. Dans cette histoire de filiation incestueuse (le personnage d’Olivier Marek a eu un enfant, Anne, avec sa propre mère, sans savoir qu’il s’agissait de sa mère), le meurtrier entend briser une malédiction qui planerait autour d’Anne, qu’il identifie à Antigone, en tuant la mère incestueuse et son second mari. La référence à Antigone est constante, tant pour le meurtrier qui échafaude son scénario à partir du récit mythique que pour les enquêteurs qui progressent dans leur enquête et interprètent les indices en superposant aux faits la tragédie de Sophocle :
Quand j’ai découvert que les mythes ne se reproduisaient pas éternellement seulement dans l’imaginaire des hommes, mais aussi dans la réalité, il a bien fallu que j’agisse. Sinon, la malédiction aurait continué à frapper. Je suis détenteur du plus terrible des secrets : les mythes peuvent encore s’incarner. Au cours des siècles, ils n’ont rien perdu de leur force de destruction, et les hommes se trompent qui croient pouvoir vaincre le destin. Moi seul puis le corriger. Elle sera épargnée parce que les autres mourront et emporteront son secret dans la tombe. Je jure qu’on ne me la volera pas et qu’elle ne saura jamais. Par son innocence, elle triomphera de la malédiction. Les autres vont bientôt disparaître, vaincus par la haine que j’ai instillée dans leurs cœurs, ou par mon bras armé pour la vengeance. Bientôt, plus personne ne pourra parler, et la police ne comprendra jamais rien. Je ne crois pas à la justice des hommes. Moi seul ai le pouvoir d’anéantir la puissance du mytheNote889. .
Le personnage d’Olivier Marek parle lui aussi de fatalité :
Mais le destin l’avait rattrapé. Il était revenu en France pour faire soigner les troubles mentaux de la jeune femme, persuadé qu’ils étaient la punition de sa faute, qu’il était responsable de sa maladie. Et à ce Salon nautique, la fatalité avait voulu que Jeanne le vît, crût reconnaître en lui le jeune homme qui lui avait volé son enfant trente-cinq ans plus tôt, sans qu’elle eût jamais compris pourquoiNote890. .
Cependant, contrairement à Une pieuvre dans la tête où la puissance tragique du mythe semble se déclencher seule, ici, elle se déchaîne à partir d’une erreur d’Olivier Marek. Sa faute n’est pas tant d’avoir eu un enfant avec sa propre mère que d’avoir partagé ce lourd secret avec un ami, celui-là même qui, voyant dans ce secret une résurgence du mythe, va tenter de briser la malédiction par des meurtres.
Quoi qu’il en soit, le mythe a une résonance tragique en ce qu’il détermine les actes des personnages, infléchit leurs choix, quand il ne donne pas tout simplement un sens à leur folie. Mais ce type de résurgence mythique reste rare dans le corpus. Le registre tragique peut déterminer en revanche la structure même du roman.
3.2.2.2. Effets d’annonce et de structure.
Le tragique tient également à des effets narratifs et structurels. Dès le début du roman, par des commentaires du narrateur qui sans être des prolepses constituent des effets d’annonce, ou par la structure qui détermine d’emblée l’issue de la diégèse, le lecteur sait que la trajectoire des personnages sera funeste, et en fait une lecture orientée par le tragique.
Ainsi, dans Une simple chute, Michèle Lesbre, qui fait le choix d’une narration polyphonique, ouvre le récit par la narration homodiégétique de son personnage masculin, et sur sa rencontre, qui s’avèrera fatale, avec Lila :
Elle n’était ni jeune ni belle. Quelque chose dans le bleu de ses yeux donnait envie de la dévisager. (…) Je ne voulais pas qu’on me dérange. Mais elle insistait. Elle a plié son manteau, l’a jeté sur un siège et m’a précisé que, si elle me lassait, je ne devais pas hésiter à le dire.
-Promettez-moi, a-t-elle insisté.
J’ai promis, et j’ai cru bon d’ajouter que je n’étais peut-être pas le meilleur choix, en désignant les autres voyageurs. Elle a souri à son tour, mais c’était un pauvre sourire. Je ne sais pas ce que je regrette aujourd’huiNote891. .
Cette simple phrase, introduisant la notion de regret, indique au lecteur que le récit de cette voyageuse suffira à entraîner le narrateur dans des aventures qui lui coûteront beaucoup.
Ces effets d’annonce sont également l’un des ressorts tragiques de L’Etage des morts d’Hugues Pagan. Ils n’interviennent pas qu’au début du roman, mais tout au long, accentuant l’effet tragique et l’impression que jusqu’au bout, le narrateur aurait peut-être pu, par des choix différents, infléchir le destin funeste des personnages. C’est à chaque fois la question tragique de la responsabilité de l’homme qui est ainsi posée. Ainsi, dès le début du roman il est question de longue chute, et à la fin du chapitre quatre, le narrateur s’interroge sur ce qui a ou non précipité le cours des choses, sur ce qui aurait pu empêcher le pire d’arriver :
Pour un peu j’avais rêvé, Franck n’était jamais venu me raconter son histoire à la mords-moi-le-pneu, seulement en relevant les yeux j’ai vu les deux numéros de téléphone qu’il avait laissés. L’un était celui que je lui avais toujours connu en Seine-et-Marne, l’autre correspondait à un Eurosignal, mais je ne le savais pas. Si je l’avais su, ça n’aurait rien changé. Si j’avais su, j’aurais tout effacé. Mais est-ce que ça aurait changé grand-chose Note892. ?
Tout au long du récit, la question de ces choix, de ces refus revient de manière lancinante :
Léon voulait me parler. Depuis des mois elle voulait me parler. Je ne savais pas, mais maintenant je sais : c’était d’elle et de Franck qu’elle voulait me parler. D’elle, de Franck et de ce qu’elle avait commis pour lui. De ce qu’elle avait découvert sur elle à cause de lui… Peut-être que ça l’aurait aidée, au fond. Mais le quai était trop loin, le quai où restent immobiles les vivants encore un peu lorsqu’ils ont cessé d’agiter les bras, juste avant qu’ils commencent à tourner le dos pour s’en aller peu à peu vaquer à leurs occupations de tous les jours. Peut-être que déjà à ce moment-là Léon n’était plus vivante et qu’à cause de cela seulement j’aurais dû l’écouter, mais je ne l’ai pas faitNote893. .
Jusqu’au bout, le héros s’attribue pour partie la responsabilité de ce qui arrive, en l’occurrence l’assassinat de Calhoune. Le narrateur se demande une fois de plus ce qui serait arrivé s’il avait retenu Calhoune :
Si je l’avais touchée, peut-être, si je l’avais laissée continuer à se dévêtir, peut-être… Je ne sais pas… Si je ne l’avais pas virée…
Une variante consiste à ouvrir le roman sur la scène qui constitue en réalité l’issue de la diégèse, comme dans Massilia Dreams de Gilles Del Pappas, où le premier chapitre relate le meurtre d’une femme – qui s’avèrera être Sih-Né – commis par le narrateur, le malheureux chauffeur de taxi manipulé ; la scène reste cependant opaque pour le lecteur, qui ne sait pas quelle jeune femme est tuée, ni quel est son assassin. Mais à cette première scène se superpose un effet d’annonce, sous la forme d’un commentaire du narrateur à l’occasion de sa rencontre avec une jeune femme qui se révèlera être pour lui une femme fatale :
Bref, tout allait bien, ça roulait gentiment quand Sih-né vint, comme un boulet de canon, bousculer ma vie. Je l’ai rencontrée une nuit d’étéNote894. .
Le lecteur, en croisant les deux faits, ne peut certes pas reconstruire le cours des événements, mais il sait d’ores et déjà que le narrateur va souffrir, et que la jeune femme, selon toute probabilité, va mourir. On peut y voir une simple intention de captatio benevolentiae, néanmoins, il s’agit d’un effet tragique. Par ce premier chapitre et le commentaire du narrateur, il ne saurait être question de voir dans la rencontre du chauffeur de taxi à l’embonpoint marqué et de la superbe asiatique le début d’un conte de fées. La rencontre est donc un déclencheur funeste.
Le même procédé est utilisé par Jean-Paul Demure au début de Fin de chasse, comme nous l’avions noté dans la première partie de cette étude. Rappelons simplement qu’au cours du premier chapitre, le facteur Vidal tue Bleyrieux dans une partie de chasse, en simulant un accident ; ensuite s’ouvre le récit, comme une gigantesque analepse, récit qui permet de montrer ce qui a amené le jeune homme à ce geste meurtrier. Le roman se clôt d’ailleurs sur le moment où commence la saison de la chasse, et sur l’annonce implicite du projet de meurtre de Vidal. La structure est en quelque sorte circulaire, comme elle l’est dans Le Roi des ordures de Jean Vautrin. En effet, au début du roman, Harry Vence s’adresse à un mystérieux interlocuteur :
Un jour, tout s’est écroulé, monsieur. Empire State Building. First National City Bank Building. Et même Chrysler Building. Toute la maudite architecture s’y était mise. Des tonnes et des tonnes de ferrailleNote895. .
Dans les dernières pages du roman, on comprend qu’Harry Vence s’adresse au policier, et le début de son récit correspond en réalité au début du roman :
Voici le début exact de ce qu’il dit :
-Un jour, toute la ville s’est écroulée, monsieur. Empire State Building. First National City Bank Building. Et même Chrysler Building. Toute la maudite architecture s’y était miseNote896. …
Ces choix structurels donnent une impression de clôture parfaite. Pourtant, tous les romans noirs ne sont pas concernés, et nombre d’entre eux, on l’a vu précédemment, proposent une fin ouverte, ou en tout cas, non close, le parcours des personnages n’étant pas clos lui non plus, ce qui les prive de destin tragique au sens de trajectoire achevée.
3.3. Du tragique au noir.
3.3.1. Contextualisation.
Afin de comprendre la spécificité du registre tragique tel qu’il est exprimé dans le roman noir, il faut admettre que si le registre tragique est une catégorie transhistorique, il n’en est pas moins actualisé dans des genres qui sont quant à eux ancrés historiquement. Jean-Pierre Vernant, rappelons-le, a montré que la tragédie grecque incarne le tragique à un moment précis, un moment de transition, au Vème siècle, entre les traditions et valeurs mythiques et les valeurs juridiques et politiques naissantes. La tragédie exprime alors ce conflit entre deux systèmes de pensée et de représentation de l’homme. Elle puise ses sujets dans la mythologie des héros, tout en mettant en cause les valeurs héroïques traditionnelles :
Le moment tragique est donc celui où une distance s’est creusée au cœur de l’expérience sociale, assez grande pour qu’entre la pensée juridique et politique d’une part, les traditions mythiques et héroïques de l’autre, les oppositions se dessinent clairement, assez courte cependant pour que les conflits de valeur soient encore douloureusement ressentis et que la confrontation ne cesse pas de s’effectuerNote897. .
La tragédie grecque mettait ainsi en texte et en scène l’opposition entre les valeurs héroïques et mythiques (incarnées par le héros) et les valeurs de la Cité (incarnées par le Chœur), les secondes contestant les premières.
Si l’on admet que le roman noir est une incarnation du registre tragique propre au 20ème siècle, il faut examiner les conditions d’apparition de ce nouveau tragique, et il est nécessaire pour cela de se souvenir que le roman noir a une visée sociale (et réaliste, dans la majorité des cas). Le registre tragique dans le roman noir est de nature sociale et existentielle, mais il est important de comprendre qu’ici, l’existentiel est déterminé par le social. Il faut revenir au roman noir américain des années 30 à 50 et au néopolar pour saisir la spécificité du roman noir français des années 1990-2000. Rappelons-le, le roman noir dresse alors un portrait critique de l’Amérique de ces années 20 et 30, d’une société à la fois en mutation et en décomposition, en proie à une violence inouïe, livrée au crime organisé, aux gangs, à des corps d’Etat corrompus. Il s’agit de comprendre comment un individu bascule dans la criminalité, ou un groupe, à cause de circonstances sociales particulières, d’examiner des conditions d’existence qui contraignent les hommes à violer le contrat social, et les conséquences de la civilisation industrielle, qui entraîne certaines formes de déviance pathologique. Le roman noir procède donc à l’analyse d’une problématique sociale et politique, comme l’avait bien vu Jean-Patrick Manchette dans ses Chroniques. Pour lui, le roman noir de la grande époque est un « chant tragique », une « grande littérature morale », qui clame que toute action individuelle est vouée à l’échec :
Les exploités ont été battus, sont contraints de subir le règne du Mal. Ce règne est le champ du roman noir, champ dans quoi et contre quoi s’organisent les actes du hérosNote898. .
Le règne du Mal est ce que Manchette appelle la contre-révolution, autrement dit la victoire du capitalisme. Les personnages du roman noir, en réaction à ce triomphe du Mal, sont acculés à la violence criminelle :
Le polar est l’histoire de la criminalité et du gangstérisme, c’est-à-dire l’histoire de la violence obligée des pauvres après la victoire du capitalNote899. .
Les choses sont selon lui très différentes dans les années 70. Dans la foulée de mai 68, on assiste à une résurgence de la révolte, de l’intervention violente, ce qui condamne le roman noir à n’être qu’une « futilité » :
Le polar de la grande époque était le soupir de la créature opprimée et le cœur d’un monde sans cœur, comme dit l’autre. Mais, à présent, la créature opprimée ne soupire plus, elle incendie les commissariats et tire dans les jambes des étatistes. Du coup, le roman noir devient une futilité. (…) Dans un temps où le désordre est revenu partout, où l’on attaque des banques en Chine, sapristi, la représentation pâlit devant la réalité ! Le roman noir, bref, était un chant tragique ; il ne l’est plus. Quand le monde a cessé d’être frivole, les polars le deviennentNote900. .
Or, il nous semble qu’un nouvel infléchissement se dessine dans les années 90, avec un retour très marqué au tragique, peut-être plus encore que dans les années 30 et 40. À cette époque en effet, Manchette le souligne, le roman noir est une littérature morale, et le privé représente un héros positif, tentant par son action de changer quelque chose à la société pourrie qui l’entoure, ne serait-ce qu’en tuant certains éléments négatifs. Bien sûr, nombre de romans noirs du corpus reprennent cette dimension morale, en proposant, à défaut d’un retour à l’ordre, une résolution des énigmes, une identification des coupables et parfois même leur arrestation ou leur mort. Mais un certain nombre de romans, non négligeable, accentue le désespoir et le pessimisme du roman noir, à tel point que l’on peut se demander si le genre radicalise le tragique ou le rend impossible. C’est que les auteurs des années 90 sont bien amers ; revenus du militantisme ou n’ayant aucun passé militant, ils sont souvent déçus par les gouvernements socialistes successifs, et inquiets de la montée de l’extrême droite. En outre, ils écrivent leurs romans dans un contexte international particulier, composé de phénomènes directement liés : l’effondrement des idéologies communistes à l’Est, dont le point d’orgue est sans doute la chute du Mur de Berlin en novembre 1989, le retour des conflits sur le sol européen (la guerre de Bosnie dès 1990), l’essor de la mondialisation, accélérée par l’effondrement du bloc communiste. À l’instar d’un Hammett ou d’un Chandler, les auteurs du corpus vont peindre la déréliction d’une société violente et criminelle autant que criminogène, qui masque mal ses turpitudes sous un vernis de civilisation. Les institutions sociales et politiques, loin de protéger l’individu de la violence et de représenter des valeurs de justice et d’équité, exercent au contraire une violence renouvelée contre l’individu, quand elles ne l’abandonnent pas purement et simplement en lui retirant toute forme d’assistance. Les institutions se délitent, la morale se désagrège, les valeurs – vérité, justice, égalité – s’effondrent, renvoyant l’homme à son aliénation et à sa solitude ; et c’est là qu’est réintroduite la dimension existentielle : l’homme, ne pouvant trouver dans la société des valeurs susceptibles d’organiser sa vie, est renvoyé à sa solitude fondamentale, à une sorte de néant métaphysique, sans aucune possibilité de consolationNote901. . La révolte même est devenue vaine et impossible, puisque les idéologies révolutionnaires elles-mêmes ont montré leur inanité, aliénant et écrasant l’homme à l’égal des idéologies adverses, quand elles auraient dû le libérer et le mener au progrès.
3.3.2. Une radicalisation du tragique.
Forme romanesque en prise sur son époque, le roman noir va exprimer cette radicalisation tragique par des éléments thématiques et structurels, repérables dans une partie du corpus.
Le personnel du roman noir est en premier lieu ce que l’on pourrait appeler un personnel dégradé. Les personnages ne sont pas des personnages nobles et positifs, ils représentent le règne de l’ordinaire, par leurs nom, statut social et caractéristiques. Le roman noir renonce en effet au héros positif qu’est, en dépit de ses faiblesses, le privé ou son avatar, le flic solitaire et atypique, pour lui substituer un simulacre de héros, parfois dérisoire. Le personnage principal du roman de Claude Amoz, Le Caveau, est un employé laborieux qui s’endort au bureau, lourd de l’alcool bu au déjeuner. Dans Chapeau ! de Michèle Rozenfarb, c’est Chloé, une fillette lourdement handicapée qui mène l’enquête. Dans Qui a noyé l’homme-grenouille ? et Qui a tué Monsieur Cul ?, les deux héros récurrents de François Thomazeau, Schram et Guigou, sont des « justiciers rmistes » qui se déplacent en cyclomoteur. Dans Nadine Mouque, le narrateur est un homme simple au patronyme quelque peu ridicule :
C’est alors que je me vois dans la glace. Voyez vous-même. Touché par la crise, mais pas par la grâce, n’est-ce pas, intouchable, et fou de Dieu, et aussi des petits-enfants, mais mal aimé, maudit des chiens, des femmes, n’est-ce pas, et trahi jadis par la mienne, Olga Piquette, née Zakouski, et logé par ma mère, M’man, car chômeur en fin de droits, n’est-ce pas, en bout de piste, cul-de-sac, quadragénaire lettré mais néanmoins crétin congénital, paraît-il, pétri d’Amour et Compassion, mais vraiment moche, (…) pas foutu d’aligner trois mots, introverti trop averti des dangers extérieurs (…)Note902. .
Il arrive que le héros ait une dimension parodique, comme dans Speedway, parodie de roman noir de Philippe Thirault, dans lequel Harry, jeune homme débile et équarisseur de son état, parvient à démasquer le tueur de femmes, qui n’est autre que le maire de sa ville, et le capitaine des pompiers, l’incendiaire de la même ville. Or, il est identifié par un agent du FBI comme un ancien agent, « le type le plus doué que le FBI ait jamais élevé en son seinNote903. », thèse que semble accréditer son talent de tireur à la fin du roman. Quoi qu’il en soit, il représente une version dégradée de l’enquêteur, par ses facultés intellectuelles moindres et son manque absolu de visée morale dans l’accomplissement de ses actes « héroïques ». Un autre avatar dérisoire du privé est représenté par Harry Vence dans Le Roi des ordures de Jean Vautrin. Nous avons déjà souligné la dimension tragique de ce personnage qui échoue dans toutes ses tentatives pour restaurer un semblant de justice, fût-ce en tuant le roi des ordures. Mais dès le départ, Harry Vence est un simulacre de privé, un chauffeur de taxi qui se rêve en privé à la Chandler :
Il avait démarré et, mentalement, il s’était posé une colle en droit pénal. Un truc vache au sujet de la responsabilité partagée ou quelque chose dans ce goût-là. Harry potassait en vue de son examen. Il espérait bien obtenir sa licence de détective avant la fin de l’année. Farewell yellow cab ! Dans son bureau de Brooklyn au décor repeint par Buzz Bezzerides ou Robert Tasker, il mettrait les pieds sur le bureau. Il tutoierait sa secrétaire. Il attendrait ses clients en relisant ChandlerNote904. .
Même quand il ne présente pas un personnel dégradé, le roman noir présente des personnages impuissants, qui échouent dans leur quête de vérité, ou qui parviennent à la mener à terme sans que cela change quoi que ce soit. On se rappellera les propos déjà rapportés de la juge Nadia Lintz à la fin de Moloch :
Nous n’avons servi à rien, tout s’est joué sans nous (…). Et c’est difficile à encaisserNote905. .
Ou bien encore ceux de Fabio Montale dans Solea :
Je ne voyais aucun avenir aux enfants de ce siècleNote906. .
De fait, dans de nombreux romans, les actes et la quête des personnages aboutissent à une vérité que personne ne veut entendre et à un déni de justice : dans Dernier tango à Buenos Aires de Gérard Delteil, le journaliste mène à bien ses investigations mais la principale responsable s’enfuit avec argent et documents sans que les faits de corruption puissent être prouvés et sanctionnés ; dans Schizo, du même auteur, les entreprises mises en cause dans des affaires de pollution chimique, de trafic d’armes chimiques et de travail clandestin ne font l’objet d’aucune poursuite ; les collaborateurs de Bleu sur la peau de Del Pappas, responsables de la déportation des juifs du quartier du Panier à Marseille ne sont en rien inquiétés ; les romans de Didier Daeninckx montrent les négationnistes accomplissant leurs actes en toute impunité. Dans le roman de Michel Embareck, Dans la seringue, le narrateur opère lui-même un déni de justice avec cynisme : il s’enfuit avec Margaud aux Etats-Unis avec l’argent illégalement gagné par le mari de celle-ci.
En outre, le roman noir correspond dans certains cas à ce que l’on pourrait appeler une structure dysphorique : la fin est non résolutive ou ouverte. Nous avons déjà évoqué précédemment un certain nombre de romans qui proposent une telle fin, en forme d’absence de dénouementNote907. . Parfois, les faits restent opaques, sinon pour le lecteur, du moins pour les personnages, et dans de nombreux romans, le dénouement est ouvert. Le texte se clôt sur un assaut (Parcours fléché de J.P.Bastid, Piraña matador de J.H.Oppel), sur une poursuite (Foulée noire, de F.Pavloff, Les Paupières de Lou de P.Dessaint), sur une disparition non expliquée (Otto de Pascale Fonteneau, La Tendresse du loup de J.P.Bastid), sur la recherche non aboutie d’un meurtrier (Vagabondages de M.Rozenfarb).
Enfin, c’est la quête de sens et de vérité elle-même qui est remise en cause dans certains textes, et cela peut passer par l’organisation même du récit. Le lecteur des Jours défaits de Jean Paul-Demure sait que les deux coupables désignés sont innocents, mais il ignore qui est le vrai coupable, tout comme il ignore quel était le but de l’organisation menée par Elodie. Dans L’Ancien crime de Claude Amoz, le meurtre de Soubeyran reste incompréhensible et donc impuni pour les acteurs de la diégèse – mais pas pour le lecteur – et Hopenot échoue dans sa mise en cause du coupable. Un cas intéressant est celui de La Tendresse du loup, parce qu’à sa fin non résolutive s’ajoute une organisation narrative qui empêche tout établissement d’une vérité définitive et univoque. Ce roman utilise la polyphonie et la variation des points de vue pour brouiller les faits. Il se compose en effet d’un récit hétérodiégétique, qui alterne le point de vue de deux personnages, Clotaire et Luna. Ceux-ci écoutent le récit enregistré (et enchâssé dans le récit encadrant à la 3ème personne) de Philippe, disparu en mer, mais qui, si l’on en croit son récit, a, avant de disparaître, tué les autres passagers du bateau. Le récit de Philippe brouille les représentations du personnage en multipliant les niveaux temporels, puisque celui-ci parle aussi bien de moments récents que de sa prime enfance. À ces récits qui proposent plusieurs perceptions et visions des événements et de la personnalité de Philippe s’ajoutent des témoignages divers sur lui, ainsi que des pièces de son dossier psychiatrique. Ce que nous indique ce roman, c’est l’impossibilité d’établir des faits avec certitude (Philippe est-il mort en mer ? a-t-il vraiment tué les autres passagers ? dit-il vrai dans son récit ?), et d’avoir une représentation univoque d’une personne (accumulation de témoignages et de points de vue différents sur le même homme).
Absence de clôture, absence de sens et d’organisation narrative claire : certains romans noirs du corpus empêchent l’accomplissement tragique. Les personnages n’ont pas de fonction modélisatrice, ils subissent malgré eux des événements qu’ils ne comprennent qu’à peine, et même lorsque c’est le cas, échouent dans leur tentative de faire éclater la vérité, ou endossent eux-mêmes le déni de justice qui s’est généralisé dans la société, selon une attitude cynique. Tel est le constat amer et désespéré du roman noir, tel est le registre dominant du genre, que l’on peut interpréter comme une radicalisation du tragique, ou comme l’expression d’un registre propre au genre, un registre noir, dont la spécificité par rapport au tragique serait de ne permettre aucun dépassement et aucun accomplissement. Nous avions précédemment convoqué les propos de Max Scheler sur le tragique, afin de montrer comment le tragique supposait l’interaction entre des valeurs, les unes écrasant les autres. Mais pour lui, si « tout ce qui mérite l’épithète de tragique relève de la sphère des valeurs et des rapports entre valeurs », « la force qui anéantit ne peut pas être axiologiquement neutre », « il faut qu’elle représente elle-même une valeur positive » :
Le tragique n’apparaît donc que si les forces qui détruisent la valeur positive supérieure émanent elles-mêmes de supports de valeurs positives, et il se manifeste avec le maximum de netteté et de pureté quand les supports de valeurs également élevées semblent pour ainsi dire « condamnés » à se supprimer et à s’exterminer mutuellement. (…) Ainsi est tragique au premier chef l’antagonisme entre les supports de valeurs positives élevées (par exemple les natures morales supérieures dans un couple, une famille ou un Etat) : tragique est le « conflit » qui règne dans le domaine des valeurs positives et entre leurs supportsNote908. .
De fait, ce ne sont pas des valeurs positives qui écrasent l’homme dans le roman noir. Ce sont plutôt des incarnations du mal ou des anti-valeurs, sécrétées par les institutions censées représenter au contraire les valeurs positives. Le roman noir expose les souffrances infligées à l’homme par les institutions qui devraient le protéger, on l’a vu. Autrement dit, il les dépeint comme des leurres. L’hypothèse de la spécificité d’un registre noir est donc bien fragile, car les affects sont les mêmes que ceux du tragique tels qu’ils ont été évoqués par Alain Viala et Yvon Brès. Toutefois, l’hypothèse est séduisante, car elle permet d’une part de comprendre en quoi le roman noir dépasse le tragique, s’en s’écarte, et d’autre part d’expliquer pourquoi il connaîtrait ce que l’on a précédemment appelé une dissémination générique, ici comprise comme la capacité du roman noir à contaminer d’autres genres. Si certains romans de François Bon peuvent être analysés à la lueur du genre noir, si la science-fiction reprend une vision noire du monde, c’est peut-être qu’à côté du genre noir, il existe un registre noir. Il serait défini par l’expression d’une souffrance, d’un désespoir, d’une amertume et d’un pessimisme radicalisés, face à un monde que nulle valeur positive ne vient organiser, et où les institutions et pouvoirs qui précisément ont pour mission première de fonder le contrat social et de protéger l’homme d’une violence « naturelle » exercent au contraire contre lui une violence aggravée par le leurre qu’ils constituent, le condamnant à souffrir voire à mourir dès lors qu’il entend se révolter.
Peut-être est-il vain de vouloir trancher entre registre tragique et registre noir, au sens où le registre noir ainsi compris serait somme toute une radicalisation du registre tragique. Il faut enfin rappeler que certains romans du corpus ne manifestent pas une telle radicalité, et expriment un espoir d’action face à un tel état de déréliction du social, et que d’autres vont introduire par leur univers romanesque du réenchantement ou faire de ce constat pessimiste un support d’expression comique. Néanmoins, visée sociale et registre noir ou tragique sont selon nous les traits essentiels du genre, qui permettent de dégager la cohérence du corpus en dépit de la labilité formelle – structurelle et thématique – du genre, au-delà de la dissolution des traits génériques dans la période des années 1990-2000. Un retour sur le corpus à la lueur de ces constats sera l’objet du dernier chapitre.
CHAPITRE QUATRE. EXAMEN DU CORPUS.
Les deux chapitres précédents ont montré que le roman noir français des années 1990-2000 pouvait être défini par deux traits complémentaires. Il est déterminé par une visée sociale, qui en fait un genre tributaire d’une esthétique réaliste, dont les principaux procédés sont l’effet de réel, l’indexation sur l’événement authentique et l’Histoire, ainsi que des procédés narratifs visant à naturaliser la diégèse, tels que l’inscription du récit dans une antériorité et une continuité ou le recours au discours rapporté. Le genre est également dominé par le registre tragique, consistant en l’expression d’une souffrance, d’un désespoir et d’un pessimisme provoqués par un constat directement lié à la visée sociale et réaliste du genre. En effet, le roman noir est tragique parce qu’il analyse les conditions d’aliénation de l’individu dans une société corrompue et dénuée de valeurs humanistes, qui exerce et engendre la violence quand elle devrait au contraire en protéger les individus. Les nombreux déterminismes sociaux se convertissent en vecteurs de fatalité tragique : facteurs de désespoir, ils écrasent l’homme qui entend leur échapper, et rendent toute tentative de révolte vaine.
Chacun des deux chapitres précédents a toutefois examiné ces deux aspects séparément ; en outre, l’analyse s’est appuyée sur des exemples et des tendances. Nous nous proposons, dans le dernier chapitre, de proposer une synthèse et un examen global du corpus. Il s’agit d’examiner la conformité des cent trente-huit romans à ces deux traits, étant entendu que les deux doivent être activés pour qu’il y ait, à proprement parler, roman noir. L’objectif sera d’une part d’examiner la validité de ces deux critères génériques en tant que critères complémentaires, d’autre part d’apprécier la pertinence de la présence de certaines œuvres du corpus, et d’examiner les cas-limites. En effet, il est probable que le corpus comporte des œuvres qui ne présentent que l’un des deux traits, voire aucun. Le début de cette étude avait souligné la difficulté à délimiter un corpus dans le but de construire une définition générique, alors même que celle-ci devrait déterminer ce corpus. Ainsi, les romans noirs sélectionnés l’avaient été en partie de manière aléatoire et intuitive.
Il semble évident que le degré de réalisme et d’actualisation du registre tragique peut varier selon les romans. Ici, il ne s’agit pas de classer les œuvres en fonction de la présence de telle ou telle modalité d’écriture réaliste ou tragique, mais d’essayer de déterminer des degrés d’actualisation de ces deux traits génériques. C’est pourquoi nous traiterons d’abord séparément ces deux traits, avant de procéder à une synthèse qui permettra d’articuler les deux. Cela devrait permettre de relever un certain nombre de cas-limites, voire d’exclure des textes du corpus.
4.1. Retour général sur le corpus.
Avant d’articuler, de croiser les deux traits génériques – visée réaliste, registre tragique –, nous les envisagerons séparément. Pour chacun, un tableau permettra de classer les œuvres du corpus en fonction de leur degré d’actualisation de chacun de ces traits. Pour des raisons de visibilité et de mise en page, nous n’avons pas fait figurer les titres complets des œuvres ; nous en avons établi une liste numérotée, et ce sont ces numéros qui figureront dans le tableau. La liste numérotée des œuvres du corpus se trouve en annexe 8. Figure entre crochets le nombre d’œuvres classées dans chaque degré.
4.1.1. La visée réaliste.
Afin de classer les œuvres en fonction de leur degré de réalisme, il a fallu déterminer des critères aussi clairs et précis que possible, permettant de mesurer l’actualisation du critère « visée réaliste » dans le corpus. Nous avons constitué huit niveaux, que nous présentons ici dans l’ordre croissant.
- le premier niveau est celui des œuvres qui ne peuvent être considérées comme réalistes, dont l’univers diégétique s’affranchit de la mimesis au sens d’une reproduction et représentation du monde réel. La référentialité est donc peu ou pas activée dans ces romans.
- le deuxième niveau concerne les œuvres du corpus qui ne mettent pas la visée réaliste au premier plan. Le roman n’exprime pas à proprement parler une vision sociale du monde et n’est pas déterminé par une visée réaliste. Cette catégorie d’œuvres peut malgré tout être qualifiée de réaliste, parce que l’univers diégétique s’attache à donner l’impression d’une conformité avec le monde du lecteur, le monde réel, notamment par des effets de réel.
- le troisième niveau voit s’accentuer la visée réaliste des œuvres qui la composent. Même si celles-ci peuvent avoir recours à des éléments totalement fictifsNote909. au niveau géographique, culturel – invention des noms de lieux, par exemple – l’univers diégétique multiplie les références à des éléments du monde réel. Le roman propose une vision sociale.
Ces deux niveaux composent le premier degré du réalisme : soit un univers diégétique conforme au monde réel mais non soutenu par une visée sociale, soit un univers diégétique qui mêle éléments fictifs et imaginaires mais au service d’un propos social.
- le quatrième niveau est celui des œuvres dont la visée réaliste et sociale est dominante et s’exprime par de nombreuses références au monde réel, en l’occurrence des éléments géographiques et culturels existants, proposés comme cadre de la fiction.
- le cinquième niveau est très semblable au précédent, mais il représente un degré plus élevé en ce que les éléments du monde réel affectent directement la diégèse en fournissant des personnages et des situations narratives inspirées de ou faisant référence à des personnes et des événements réels.
Par leur proximité, ces deux niveaux constituent le deuxième degré de réalisme : une visée réaliste et sociale affirmée. Le troisième degré est composé des œuvres dont la visée réaliste et sociale est forte ou très forte. On peut la diviser en trois niveaux :
- le sixième niveau est celui des œuvres à la visée réaliste et sociale forte, des romans-sociogrammes, qui mettent au cœur de la diégèse la représentation d’un milieu, d’un groupe déterminés, d’une situation sociale et/ou politique.
- à un septième niveau se trouvent les romans qui appuient ce projet par une documentation composée d’analyses, de témoignages sur des situations et des faits authentiques, documentation signalée dans le péritexte auctorial ou dans des propos de l’auteur recueillis par ailleurs. Sans apparaître explicitement, cette documentation est perceptible à travers la précision des informations apportées par la matière romanesque même.
- le huitième niveau ne diffère guère du précédent mais il s’en distingue tout de même par l’explicitation et la présence directe des sources documentaires dans l’œuvre elle-même, stade ultime de réalisme, avec une imbrication maximale entre les faits authentiques et l’univers diégétique propre à la fiction. Cela peut se traduire par la reproduction et la citation des sources testimoniales et analytiques dans le texte romanesque, ou par une référence directe à celles-ci.
Voici les œuvres classées dans un tableau reprenant les critères.
| 8. Visée réaliste maximale. Roman-sociogramme qui convoque dans le texte même ses sources documentaires. | 59-70-71-72-73-74-87-124- [8] |
| 7. Visée réaliste forte. Roman-sociogramme qui s’appuie sur des documents, témoignages, analyses authentiques. | 3-10-15-17-21-22-37-39-40-41-49-50-62-64-67-76-77-79-80- 81-82-85-86-88-90-99- [26] |
| 6. Visée réaliste forte. Roman-sociogramme. | 7-8-12-13-14-16-18-20-29-30-31-32-33-34-45-46-51-52-53-65-69-78-83-89-96-97-98-105-107-109-117-118-119-123-136-138 [36] |
| 5. Visée réaliste. Nombreuses références au monde réel : personnages et/ou événements existants. | 43-44-57-58-60-61-63-66-101-110-114-115-122- [13] |
| 4. Visée réaliste. Nombreuses références au monde réel : éléments géographiques et culturels existants. | 9-38-47-54-55-56-95-100-102-103-108-111-127-128-129-137- [16] |
| 3. Visée réaliste. Mais peu de références à des éléments existants, éléments géographiques fictifs, imaginaires. | 1-2-4-27-28-92-93-94-104-113-116-121- [12] |
| 2. Pas de visée réaliste au premier plan. Univers conforme au monde réel. Effets de réel. | 5-6-11-19-25-26-35-36-68-75-84-112-120-125-130-131-132-133-134-135- [20] |
| 1. Univers diégétique affranchi de la mimesis. Référentialité pas ou peu activée (quelques effets de réel). Univers fantaisiste ou futuriste. | 23-24-42-48-91-106-126- [7] |
La plupart des œuvres composant le corpus comportent donc une visée réaliste. 71,72% (99 romans) relèvent des niveaux 4 à 8. 50,72% (70 romans) sont caractérisés par une visée réaliste et sociale forte. En revanche, minoritaires sont les œuvres qui relèvent d’une composante réaliste faible (32 soit 23,20%), et rares sont celles qui ne peuvent être qualifiées de réalistes (7 soit 5%).
Le premier niveau constitue en quelque sorte le degré zéro du réalisme. Peu d’œuvres du corpus sont concernées, sept soit 5%, parmi lesquelles il faut distinguer les œuvres où le noir se mêle au fantastique ou à la science-fiction et les œuvres parodiques, burlesques ou atypiques. Dans ces dernières, on classera : Tu touches pas à Marseille de Jean-Paul Delfino, Speedway de Philippe Thirault, deux œuvres parodiques ou humoristiques, Zoocity de Guillaume Nicloux.
Les deux premières sont des œuvres comiques. Tu touches pas à Marseille relève de la farce marseillaise. Le roman se déroule dans un futur proche et non déterminé, comme l’indiquent quelques éléments : il est en effet question de la retraite du joueur de football Zinedine Zidane, ou du Nouveau Mouvement du nouveau front national. Corrompu, le maire de Marseille met le vieux port en vente, afin qu’il soit acheté par un Russe mafieux et milliardaire. Celui-ci espère trouver des documents qui mettraient en péril les sociétés démocratiques occidentales, afin de gagner pour lui-même sa place à l’ONU. Cette intrigue est le prétexte à une charge contre la corruption des politiques et à une dénonciation de la montée du fascisme. Néanmoins, l’œuvre ne peut être considérée comme réaliste, même si elle exprime des refus idéologiques qui l’apparentent à une visée sociale. En effet, le roman ajoute à l’argument fantaisiste nombre d’éléments totalement imaginaires. En cela, Jean-Paul Delfino a écrit un cas-limite de roman noir, dont on verra après examen du critère générique « registre tragique » s’il mérite d’être exclu ou non du corpus.
La même question se pose à propos de Speedway de Philippe Thirault. Si l’œuvre reprend des stéréotypes du roman noir, elle le fait sur le mode parodique. Le patron de l’abattoir s’appelle Doolittle, le maire s’appelle Holmes. Le héros, débile léger, incarne de manière quelque peu radicale le héros pur et innocent : son absence d’intelligence le prive en effet de toute malice et de toute rouerie. Parodie au dénouement « heureux » – les coupables sont mis hors d’état de nuire, et Harvey, héros malgré lui, retrouve sa dulcinée – Speedway est un cas limite du corpus. Là encore, il faudra examiner le roman selon l’axe du tragique pour en déterminer l’exclusion ou l’intégration définitive au corpus.
L’univers de Zoocity de Guillaume Nicloux est sombre, ultra-violent, peuplé de personnages pervers et meurtriers, souvent ramenés à une animalité primaire, comme le souligne la phrase de Darwin mise en exergue :
Si considérable qu’elle soit, la différence entre l’esprit de l’homme et celui des animaux les plus élevés n’est certainement qu’une différence de degré et non d’espèce.
Pas de visée réaliste dans ce roman dont la temporalité est indéterminée et l’Amérique fictive. Zoocity joue avec les codes et les figures du roman noir américain, mais n’est pas une parodie, dans la mesure où la parodie suppose l’imitation d’un modèle à des fins satiriques ou comiques. Or, il n’y a rien de comique dans l’univers très pessimiste de Guillaume Nicloux. L’incipit s’inspire de l’écriture comportementaliste du hardboiled américain, et introduit une mystérieuse figure masculine :
Un trou noir et humide, avec du bruit. Le long tube argenté s’éjecta de l’orifice. Le ronronnement d’un train sur les rails. La pluie frappait violemment les vitres embuées d’un compartiment. Un homme, dont on ne voyait pas le visage, était assis sur une banquette en velours rouge. Il lisait un recueil de textes d’un auteur hongrois récemment disparu. Ce voyageur solitaire portait un costume sombre et une chemise blanche sans col. Une sacoche en cuir souple reposait à ses côtés. Il avait les mains épaisses et calleuses, deux robustes jambes et les cheveux blancsNote910. .
Ray est quant à lui un personnage qui a tous les traits du tough guy et du bad boy :
Il n’avait aucune famille, aucun ami, plus de passé et aucun avenir. Ray avait passé huit ans de sa courte existence en prison. On l’avait jugé et enfermé pendant huit longues années dans un établissement modèle situé près de la frontière. On avait essayé de le dresser là-bas, des hommes en uniforme avaient essayé de lui inculquer les valeurs essentielles de la vraie vie, ils avaient tenté de le soumettre et de l’humilier, on l’avait plusieurs fois battu, mais il s’était défendu. Il avait résisté. Et il s’était endurci, était devenu plus méchant qu’à l’ordinaire, avait fini par acquérir un statut d’intouchable, un statut d’homme fêlé dont il ne fallait pas tripoter le cul. Durant sa dernière année de détention, il n’avait pas dû prononcer plus de cent phrasesNote911. .
Une deuxième catégorie est composée des œuvres qui mêlent au roman noir des éléments génériques extérieurs, issus de la science-fiction : il s’agit de À sec ! (Spinoza encule Hegel, le retour) de Jean-Bernard Pouy, Babylon Babies de Maurice G. Dantec, Trajectoires terminales de Paul Borrelli et Cœur-Caillou de Virginie Brac. Cœur-Caillou mêle au roman noir des ingrédients de l’univers post-apocalyptique, puisqu’il est question d’un village détruit par une explosion nucléaire, mais aussi des éléments empruntés au fantastique, comme le château gothique, sombre et inquiétant, dans lequel résonnent de mystérieux cris :
Le château entier bruissait de murmures, de craquements inhabituels. Elle crut percevoir des cris étouffés. Il lui sembla que cela venait de chez les Kampf. Elle traversa la cage d’escalier et s’apprêtait à pénétrer dans les entrailles de l’aile nord quand un glapissement horrible l’arrêta. Un cri, un seul, brutalement interrompuNote912. .
Néanmoins, ce sont des éléments qui viennent perturber l’appartenance au genre du roman noir, sans la remettre en cause. Le village dévasté n’est qu’une exception dans un monde par ailleurs réaliste, et le fantastique se résorbe en intrigue policière.
En revanche, Trajectoires terminales de Paul Borrelli et À sec ! (Spinoza encule Hegel, le retour) de Jean-Bernard Pouy relèvent plus largement d’un sous-genre de la science-fiction, le post-apocalyptique, sur des modes bien différents il est vrai. Le post-apocalyptique représente la vie après une catastrophe ayant éradiqué la civilisation, cette catastrophe pouvant être nucléaire, naturelle ou sociale, entre autres. Cet univers se caractérise par un équilibre précaire entre des traces de la civilisation perdue et le chaos d’une société qui tente de prendre un nouveau départ.
Trajectoires terminales de Paul Borrelli révèle un univers post-apocalyptique où la dévastation est liée aux pluies acides, au climat et à la surpopulation. La diégèse est clairement datée : 2034. L’intrigue est pour le reste une intrigue de roman noir. Le roman de Jean-Bernard Pouy relève également du post-apocalyptique, mais sur le registre comique. À sec ! est la suite de Spinoza encule Hegel, paru en 1979Note913. . Le romancier reprend les personnages de Spinoza et Hegel, l’affrontement entre l’éthique et l’esthétique dans un univers à la Mad Max, mais les groupuscules gauchistes du premier volume ont cédé la place aux kops de supporters de foot, dans une société en plein chaos, qui tente de se reconstruire autour de la seule « valeur » qui cimente la société : le football. Il suffit de se souvenir que le roman est publié en 1998 pour comprendre que Jean-Bernard Pouy propose en fait une charge satirique contre une société qui idolâtre le ballon rond, et qui n’est plus portée par aucune volonté de révolte ou pensée politique :
Ce que tricotent les vingt-deux débiles sur le gazon n’intéresse que peu de monde. Et toujours les mêmes. Ceux qui délèguent, parabolisent. Qui gagnent, perdent, ou statuquotent par crétins emmaillotés interposés. Les Kops sont dehors. Partout. À tout moment. Sur la route. Autour des stades. L’extérieur devient problématique. Ce ne sont que défis, bastons et cadavres. Il n’y a plus de drapeaux, mais des écharpes. Il n’y a plus de manifs, mais des matches, il n’y a plus de votes mais des résultats sportifsNote914. .
La portée idéologique et sociale du roman est évidente, mais dans un univers diégétique dénué de tout réalisme.
On choisira néanmoins d’inclure ces deux romans dans le corpus. Trajectoires terminales parce que la dominante noire n’est pas remise en cause par les éléments post-apocalyptiques, et À sec ! (Spinoza encule Hegel, le retour) parce que Jean-Bernard Pouy s’y livre à un détournement du post-apocalyptique pour composer un véritable roman noir. Néanmoins, il s’agit de cas-limites.
Babylon Babies de Maurice G. Dantec pose un autre problème. On a vu précédemment que ce roman gardait peu d’éléments du roman noir, tout au plus quelques figures et motifs. Il semble donc raisonnable de l’exclure du corpus, et de voir en lui un roman de science-fiction, dont la filiation avec le roman noir est rendue possible par le genre science-fictionnel même dont il relève, le cyber-punk. Ce genre, qui dépeint un monde anti-utopique et envisage la fusion de l’humain et de la machine, propose en effet une approche critique des institutions et des gouvernements, mettant en relief les dysfonctionnements de notre société vue à travers un monde futuriste en réalité très proche du monde de l’auteur et du lecteur. Comme le roman noir, auquel il est parfois comparé, ce genre propose une vision pessimiste voire nihiliste, très angoissée, celle d’un avenir ultra-violent et déshumanisé. Nombre de ses auteurs manifestent des conceptions proches des mouvements d’extrême gauche ou des mouvances anarchistes.
Au terme de cet examen du critère de la visée réaliste et sociale, un roman a donc été exclu, et deux autres voient leur sort suspendu à leur degré d’actualisation du registre tragique, pour lequel il faut, de la même manière, établir des critères définissant des degrés.
4.1.2. Le registre tragique.
Pour classer les œuvres en fonction de leur actualisation du registre tragique, cinq niveaux ont été dégagés.
- Le premier niveau correspond à l’absence du registre tragique. Les difficultés, quelles qu’en soient les sources, sont neutralisées ou totalement résolues, le héros n’est pas personnellement et durablement affecté par les troubles résultant des événements – criminels ou non – et éventuellement, il en résulte même une amélioration pour lui.
Les niveaux deux et trois composent le premier degré d’actualisation du tragique, qui s’exprime par des procédés relevant du niveau sémantique :
- Au niveau 2, le registre tragique affleure à travers l’expression d’une souffrance, d’une difficulté à vivre, les héros menant une existence marquée durablement par la mort, la souffrance. Néanmoins, les difficultés qu’ils rencontrent peuvent être surmontées, ou cette souffrance n’apparaît que ponctuellement sans affecter l’ensemble de leurs actes.
- Au niveau 3, le registre tragique se traduit de la même manière, mais domine le texte. S’expriment la souffrance de vivre, le désespoir face à des situations complexes et génératrices de désespoir. Le roman fait le constat de déterminismes convertis en facteurs de fatalité tragique.
Enfin, les deux derniers niveaux composent un degré de tragique fort, qui se manifeste au niveau sémantique – vision de l’existence et de la société – et au niveau syntaxique – dans l’organisation même de la diégèse.
- Ainsi, au niveau 4, à l’expression de la souffrance et à la conception pessimiste précédemment évoquées s’ajoutent une trajectoire du personnage sanctionnée par la mort ou la déchéance, la non résolution des difficultés assorties de nouvelles souffrances, et dans de nombreux cas, un dénouement qui consiste en un déni de justice, les coupables n’étant pas sanctionnés voire pas désignés.
- Enfin, le niveau 5 radicalise le tragique par l’expression d’un effondrement des valeurs, que rendent visibles le défaut de clôture, le refus d’établir une signification claire aux événements relatés, l’absence d’accomplissement et d’aboutissement de la trajectoire des personnages. Le sens reste opaque, les coupables ne sont pas identifiés, le héros échoue dans sa tentative pour faire surgir la vérité ou sanctionner les coupables.
Là aussi, nous proposons un tableau dans lequel les œuvres du corpus sont classées en fonction de leur degré d’actualisation du tragique.
| 5. Registre tragique maximal ou registre noir. Radicalisation du tragique par : effondrement des valeurs, absence de clôture et/ou de signification et/ou d’accomplissement. Sens opaque, pas d’identification des coupables. |
3-8-9-26-27-28-37-45-46-49-50-52-61-66-73-79-85-86-87-91-92-94-96-99-115-116-118 [27] |
| 4. Registre tragique fort (niveaux sémantique et syntaxique). Expression d’une souffrance, du désespoir, vision pessimiste. Syntaxe tragique. Non résolution des difficultés ou résolution au prix de nouvelles souffrances. Déni de justice, coupables non désignés / non sanctionnés. Mort ou déchéance pour le héros. Constat : déterminismes convertis en facteurs de fatalité tragique. |
2-4-15-16-17-18-23-31-32-33-35-36-38-47-51-53-54-55-58-60-63-65-67-69-70-71-72-74-76-77-80-81-82-84-88-89-93-95-97-98-104-109-110-111-112-114-120-121-122-125-127-136-137-138 [54] |
| 3. Registre tragique dominant (niveau sémantique). Expression d’une souffrance, du désespoir, vision pessimiste. Résolution temporaire, partielle ou non résolution des difficultés. Constat : déterminismes convertis en facteurs de fatalité tragique. |
7-20-24-34-39-40-42-59-62-64-83-90-101-105-107-108-113-117-119-124-130-131-132-133-134-135- [26] |
| 2. Registre tragique affleurant (niveau sémantique). Expression d’une souffrance, d’une difficulté de vivre, existence marquée durablement par les difficultés, la mort, la souffrance. Néanmoins, résolution des difficultés, de manière plutôt positive. |
1-5-6-10-12-13-14-19-25-29-30-41-43-44-56-57-75-78-100-106-128-129- [22] |
| 1. Absence de tragique. Résolution ou neutralisation des difficultés. Le héros n’est pas affecté durablement par les événements criminels, éventuellement même ils lui apportent une amélioration. | 11-21-22-47-68-102-103-123-126- [9] |
Le registre tragique apparaît bien comme une composante essentielle du roman noir. 34,78% des romans du corpus, c’est-à-dire quarante-huit d’entre eux, actualisent le tragique au niveau sémantique, et 58,69%, soit quatre-vingt-un romans, aux niveaux sémantique et syntaxique. Ainsi, 93,47% des œuvres relèvent du registre tragique, qu’il trouve des expressions sémantiques (figures, thèmes, vision du monde) ou des expressions syntaxiques (structures et scénarios).
Neuf romans seulement échappent au registre tragique, soit 6,52%. On retrouve deux des œuvres précédemment évoquées comme non marquées par la visée réaliste : Tu touches pas à Marseille de Jean-Paul Delfino, roman satirique et comique, et Speedway de Philippe Thirault, œuvre parodique relevant du registre comique. Ne peut être qualifié de tragique le roman de Sylvie Granotier, Sueurs chaudes, qui se termine en conte de fées pour l’héroïne. Non seulement elle échappe au danger qui la menaçait et participe à l’identification du coupable, mais elle rencontre l’amour en la personne du policier. Le roman se clôt sur l’annonce de leur mariage. De même, on ne saurait considérer le registre de Régis Mille l’éventreur de René Belletto comme tragique. Le dénouement permet la résolution de toutes les difficultés, puisque Régis Mille est arrêté, jugé et emprisonné, la sœur de Michel, Nadia, enlevée par Régis Mille, est sauvée par son frère policier. Même la résolution de Régis Mille de se tuer quand l’occasion se présentera pour échapper à la captivité n’est pas réellement teintée de tragique. Mais René Belletto est un auteur atypique du roman noir et policier, qui ne revendique d’ailleurs pas cette étiquette générique pour ses œuvres. Plus qu’un auteur de romans noirs, il s’agit d’un romancier empruntant des formes et techniques au roman noir.
Les romans de Jean-Noël Blanc ne sont pas non plus tragiques, car les déterminismes sociaux qui régissent le monde du sport – football dans Tir au but et cyclisme dans Le Tour de France n’aura pas lieu – ne sont pas convertis en facteurs de fatalité. Les aventures de Gilbert Woodbrooke dans Un été japonais n’ont rien de tragique non plus, et bien au contraire, le registre dominant dans le roman est le comique, les tribulations du héros prêtant avant tout à rire. Ainsi, ces deux romans sont bien des sociogrammes, mais ils n’actualisent pas le registre tragique.
Enfin, il faut évoquer le cas de Daniel Pennac, qui avec les deux romans du corpus, Monsieur Malaussène et Les Fruits de la passion, remet en cause les codes du roman noir auxquels il avait jusqu’alors adhéré. Il semble qu’avec ces deux romans, qui poursuivent la saga Malaussène, l’auteur entende quitter les sphères du roman noir. Rappelons d’ailleurs qu’ils sont publiés en collection générale. Toutefois, la spécificité de Daniel Pennac, dès ses premiers romans d’ailleurs, est de juxtaposer à une visée sociale une vision réenchantée du monde, qui n’annihile pas le tragique mais le compense. À ce titre, nous nous réservons la possibilité de traiter de cet auteur ultérieurement, car il s’agit d’un cas-limite particulièrement intéressant.
Il nous faut maintenant croiser les deux séries de critères, l’axe de la visée réaliste et celui du registre tragique, afin de déterminer si des romans doivent être exclus ou non.
4.1.3. Le roman noir, roman tragique à visée réaliste et sociale.
Nous avons croisé les deux séries de critères en un tableau.
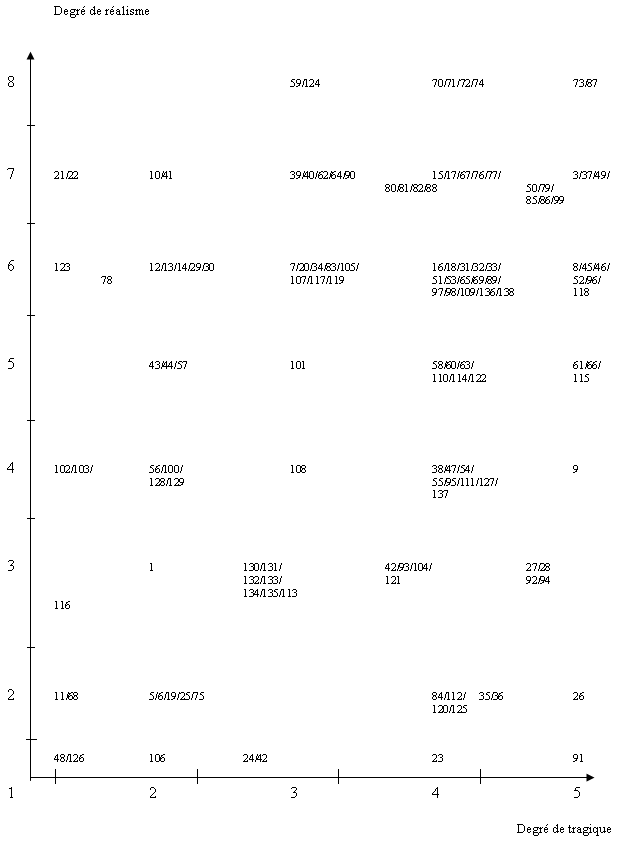
Une majorité d’œuvres est caractérisée par une forte actualisation à la fois de la visée réaliste et du registre tragique. En effet, si l’on croise les niveaux 4 et 5 du tragique et 6 à 8 (soit les degrés les plus élevés pour ces deux traits définitoires), ce sont quarante-quatre œuvres qui sont concernées. Autrement dit, 31,9% des romans du corpus relèvent à la fois d’une visée réaliste et sociale très forte et d’un registre tragique très marqué. Si l’on prend en compte plus largement les œuvres dont la visée réaliste et le registre tragique sont au moins de degré 2, on obtient un total de 57,25%, soit 79 romans. Ce constat accrédite l’hypothèse que le roman noir peut être caractérisé par sa visée réaliste et sociale et le registre tragique. La complémentarité des deux, ainsi que l’intensité dans l’actualisation du tragique – voire sa radicalisation – pourraient bien être la clé de ce que l’on appelé précédemment le registre noir. Il est en effet possible de voir dans l’actualisation du registre tragique par le roman noir un registre spécifique au genre, le registre noir, qui correspondrait à la combinaison de la visée sociale et réaliste et du registre tragique, et à la radicalisation du tragique. Relèverait du registre noir l’expression de la souffrance désespérée provoquée par l’analyse sociale, politique, idéologique d’une société qui bafoue par son fonctionnement même – et ses dysfonctionnements – les valeurs qui la fondent, et qui exerce une violence insupportable sur l’individu, aliéné, renvoyé à sa solitude, acculé à la souffrance voire à la mort.
Reste que certains romans du corpus sont caractérisés à la fois par une faible visée réaliste et l’absence du registre tragique. Nous avons précédemment envisagé un certain nombre de romans qui échappaient à l’un ou l’autre critère : il est temps à présent de voir si les deux « absences » se conjuguent, et d’envisager de nouvelles exclusions du corpus.
Deux œuvres se distinguent par une visée réaliste nulle ou quasi-nulle, et par l’absence d’expression tragique : sans surprise, il s’agit de deux romans qui relèvent bien davantage du registre comique, en ce qui concerne Tu touches pas à Marseille de Jean-Paul Delfino, ou de la parodie, pour ce qui est de Speedway de Philippe Thirault. Même si ces romans présentent des traits les rattachant au roman noir, nous faisons le choix ici de les exclure du corpus, dans la mesure où les deux traits fondamentaux sont absents.
À un faible degré d’actualisation de ces deux traits, on trouve également Jean-Bernard Pouy pour À sec !, René Belletto pour Régis Mille l’éventreur et Sylvie Granotier pour Sueurs chaudes. Le cas de À sec ! a déjà été évoqué : en dépit d’une contamination évidente par la science-fiction post-apocalyptique, ce texte nous semble relever du genre roman noir, dont il constitue un cas-limite. Nous avons également mentionné le caractère atypique de René Belletto dans le paysage policier, auquel il a été annexé parce qu’il emprunte des figures et des procédés aux genres qui le composent. Dans la mesure où ce roman n’est pas tragique et peu marqué par la visée réaliste, nous l’excluons du corpus. Sylvie Granotier ne pose pas non plus de réel problème : nous avons vu que le registre tragique était absent ou presque de ce roman, et de la même façon, la visée réaliste et sociale est peu présente. Ce premier roman a certes été conçu comme un roman noir à l’américaine – la diégèse a pour cadre les Etats-Unis – mais le genre auquel il se rapporte le plus est le thriller. L’héroïne est en effet en danger, et elle doit démasquer le coupable pour sauver sa vie.
Les choses pourraient sembler plus complexes pour Hervé Jaouen, l’une des figures phares du néopolar, à ce titre auteur incontournable du roman noir. Pourtant, Hôpital souterrain est peu marqué par la visée réaliste et sociale et par le registre tragique. Plus qu’à un roman noir, nous avons affaire à un roman à énigme, en forme de défi pour l’auteur et le lecteur : la fillette qui disparaît dans le musée sur l’île de Jersey n’en est pas sortie, semblant s’être volatilisée ; en outre, bien que l’Histoire soit présente –la Seconde Guerre mondiale – elle ne donne pas vraiment lieu à un discours dont la portée serait politique ou idéologique, mais fournit des éléments de résolution du mystère. Enfin, si l’issue est synonyme de mort, il s’agit de la mort de la coupable, et non de la fillette, qui finit par être retrouvée saine et sauve. Il ne s’agit pas de dire que ce roman n’a rien à voir avec le genre du roman noir ; mais il en actualise plutôt des traits, sans perturber la dominante, qui est le roman d’énigme. Un problème assez similaire se pose d’ailleurs avec Yvonne Besson et Virginie Brac. Nous avons évoqué la première à propos du tragique, parce que Meurtres à l’antique propose une intrigue criminelle composée en référence constante à Antigone et Œdipe. Pourtant, les apparences sont trompeuses : ce roman ne se caractérise pas par un registre tragique fort, car même s’il comporte trois morts, l’issue est positive. Bien plus, le mythe est utilisé comme un défi intellectuel. S’il permet au meurtrier d’élaborer sa stratégie criminelle, sa folie le conduisant à voir dans la réalité une reproduction du mythe, il permet surtout aux enquêteurs de remonter la piste et de démasquer le coupable avant qu’il ne commette un dernier meurtre ; Carole Riou, qui dirige l’enquête, lit en effet l’Antigone de Sophocle pour y trouver peu à peu les indices et les clés de compréhension des faits. Cette exploitation du mythe, ainsi que l’absence de visée sociale, fait de Meurtres à l’antique un roman d’énigme. Bien sûr, certains éléments sont directement empruntés au roman noir, comme le personnage de Carole Riou, version féminisée de l’enquêteur en rupture familiale ; le roman commence d’ailleurs comme un roman noir, dans la mesure où les premiers éléments laissent penser que les meurtres pourraient avoir un lien avec la politique ou avec les activités industrielles du patriarche dont la femme a été assassinée. Mais Yvonne Besson préfère à cette composante noire le jeu intellectuel permis par la référence au mythe.
Virginie Brac mêle elle aussi roman d’énigme et roman noir dans Tropique du pervers. Au contraire des deux œuvres précédentes, nous proposons de ne pas exclure ce roman du corpus, parce que son pessimisme quant à l’influence des sectes et quant aux aliénations familiales est plus net que dans les textes de Besson et de Jaouen, mais nous reconnaissons la part d’aléatoire de ce choix, guidé en partie par le fait que Virginie Brac a par la suite fait évoluer cette série (Tropique du pervers met en scène le personnage récurrent de Véra Cabral) vers un marquage noir plus netNote915. .
Deux romans sont encore des cas-limites de romans noirs : Transfixions de Brigitte Aubert et Visas antérieurs de Luc Baranger. Le premier offre certes une représentation des bas-fonds, en tout cas de leur version moderne, puisqu’il se déroule dans les milieux de la prostitution et de la délinquance. Néanmoins, Brigitte Aubert ne se cache pas de vouloir avant tout distraire son lecteur avec une intrigue pleine de suspense, et n’entend délivrer aucun message social dans ses romansNote916. . En outre, même si la trajectoire de Bo semble se dérouler sous de sombres auspices, il n’y a pas d’évolution du personnage vers le tragique, bien au contraire. Il semble accomplir, du moins en partie, sa quête de bonheur et d’amour, en dépit de péripéties violentes. Quant à Visas antérieurs de Luc Baranger, il mêle roman noir et roman d’initiation. Néanmoins, il relève selon nous du roman noir avant tout, dans la mesure où l’itinéraire du héros ainsi que l’évocation de ses grands-parents permet d’évoquer un parcours marqué par des déterminismes sociaux ressentis durement par le héros. Le roman se termine par la mort de l’un de ses amis, et dans une atmosphère très noire :
Le front contre la vitre froide j’ai regardé les vagues au loin écumer de rage sur le sable impassible. Je n’ai fait qu’écouter le blues qui suintait du tue-nerfs. Le Gypsy édenté se l’est joué tout en slide. J’aurais sûrement eu du mal à faire mieux. Quant au lippu de la gueule, il a parlé de train et d’amour qui se faisait la malleNote917. .
L’analyse du corpus à l’aide des critères croisés du réalisme et du tragique permet donc de détecter des cas-limites de romans noirs, soit des œuvres qui relèvent du genre malgré une contamination par d’autres genres ou une forte dilution des traits génériques. Cela permet aussi de réviser le corpus, c’est-à-dire d’en exclure certains textes, qui avaient été sélectionnés sur la foi du nom de leur auteur, comme Babylon Babies de Maurice G.Dantec ou Hôpital souterrain d’Hervé Jaouen, ou tout simplement sur la foi de leur appartenance éditoriale à des collections noires, comme ceux de Jean-Paul Delfino ou de Philippe Thirault. Néanmoins, il est d’autres auteurs ou œuvres sur lesquelles nous aimerions attirer l’attention, et qui constituent également selon nous des cas-limites, bien que ces titres n’apparaissent pas comme tels dans le tableau. C’est qu’ils sont des cas-limites pour d’autres raisons, selon des critères qui se superposent aux deux traits génériques évoqués en venant les compléter. Il s’agit d’une collection et de son héros, « Le Poulpe », et de trois auteurs que nous considérons comme atypiques dans le paysage noir au point d’avoir envisagé, pour certains, de les exclure : Maurice G.Dantec, Daniel Pennac et Fred Vargas. Tous constituent par ailleurs des phénomènes médiatiques et éditoriaux durant les années 90 (et au-delà).
4.2. Des cas-limites très médiatisés.
4.2.1. Le Poulpe : un héros populaire avant tout.
Les six volumes du Poulpe activent de toute évidence les traits génériques que sont le réalisme et le tragique, comme en atteste leur position dans le tableau. Néanmoins, ils occupent une place particulière dans le corpus. Selon la Bible de la collection, il s’agit d’une « collection de romans noirs populaires », et cette double qualification générique n’a rien d’anodin. Si les concepteurs de la collection entendent renouer avec les principes de production et de diffusion de la littérature populaire de la première moitié du 20ème siècle, ils souhaitent également créer un grand héros populaire, ce qui ne va pas sans ruptures et contrastes avec l’univers du roman noir tel que nous l’avons évoqué.
Le projet naît avant toute chose de la volonté de faire de « la littérature de gare » ; par ces romans, les fondateurs que sont Serge Quadruppani, Jean-Bernard Pouy et Patrick Raynal entendent à la fois créer un héros et une collection populaires et bénéficient d’un mode de diffusion aussi large que possible, qui engloberait les grandes surfaces et les librairies de gare. Nous ne reviendrons pas ici sur les modes de production sériels de la collection, déjà analysésNote918. . C’est parce que les trois initiateurs de la série sont des auteurs de roman noir, parce que leur réseau est avant tout celui de la littérature policière, et parce que Le Poulpe enquête sur « la maladie de notre monde » que le genre retenu est celui du roman noir. Mais tout autant que les traits génériques du noir sont activés les codes de la littérature populaire – policière et d’aventures –, comme le montrent les références convoquées par Jean-Bernard Pouy, directeur de la collection :
La littérature populaire c’est un fond incroyable d’histoires et de mythologies. On n’invente rien, le Poulpe c’est RouletabilleNote919. .
« Le Poulpe » part d’un constat – l’analyse est de J.B.Pouy : le marché de la littérature populaire a été confisqué par des séries fascisantes, impérialistes et réactionnaires, ou par des romans ultra-formatés du type Harlequin. De ce constat naît un désir :
Redonner un coup de pompe à la littérature populaire, celle qui traînait dans les gares, avant (je suis fils de chef de gare). Se rendre, tout à coup, compte qu’il n’y a plus, dans les édicules ferroviaires, que du livre de poche, la grande littérature en petit format, des romans sentimentaux ou érotiques, SAS et trois ou quatre séries crypto-polar, L’Exécuteur mondain, le Brigade du Fils de l’Exécuteur pas si mondain que ça, récits souvent machistes et quelquefois sponsorisés, écrits comme à l’usine, à plusieurs mains. Donc, il y avait urgence à faire revivre Rouletabille, Arsène Lupin, Judex, peut-être FantomasNote920. .
Le Poulpe, dont le nom est un clin d’œil aux « pulps » américains de l’entre-deux guerres, voit ainsi le jour en 1995. Le pari de donner jour à une collection populaire est en partie réussi, puisque chaque volume se vend entre 6000 et 8000 exemplaires, sachant que certains titres, grâce à la notoriété de leur auteur, peuvent atteindre 20000 voire 50000 exemplaires. La Petite écuyère a cafté, premier volume de la série signé de son directeur de collection, Jean-Bernard Pouy, obtient le Prix Paul Féval (du roman populaire). Mireille Piarotas note dans un article consacré à la collection que les médias reconnaissent dans ce personnage un héritier des grands héros populaires : dans Rouge, il est question d’un « nouveau Rocambole mâtiné avec le Saint », tandis que La Wallonie signale que « Le Poulpe désormais rejoint Robin des Bois au royaume des héros de légendeNote921. ».
Le personnage est en effet atypique dans le paysage du roman noir français. Loin du personnel dégradé dont il a été question plus haut, il s’apparente aux grands héros populaires sériels du 19ème siècle ou du début 20ème. Comme nombre de ces héros populaires, il est orphelin, et ses origines, si elles ne sont pas inconnues, sont cependant vagues, tout comme son mode de vie le rend insaisissable. La bible mentionne qu’il vit à l’hôtel et « se refuse à laisser des traces trop prégnantes, Impôts, EDF, Téléphone, etc. ». À l’image de Lupin ou de Fantômas, il « adore se déguiser, se grimer, jouer des rôles pour les besoins de son enquête », et n’hésite pas à se munir d’identités et de papiers tout aussi faux les uns que les autres. Dans les romans du corpus, il est entre autre journaliste pour Libération, chercheur du CNRS, employé du Conseil Régional de Haute-Normandie (dans La Petite écuyère a cafté), il endosse les patronymes de Van Pulpen (chez Raynal ou Carrese), Pierre Yung (dans Ethique en toc de Didier Daeninckx), Jérôme Le Prieur ou Wajman (chez Jean-Bernard Pouy). Fuyant et discret, il est d’ailleurs assez mystérieux pour son entourage même :
Parfois, il disparaissait pendant des jours, quelquefois des semaines, mais on avait des nouvelles, des cartes postales, il voyageait, et n’avouait jamais ce qu’il pouvait bien foutre dans toutes ses pérégrinationsNote922. .
Il apparaissait et disparaissait sans explications ou commentaires. C’était comme ça. Les autres imaginaient ce qu’ils voulaient et Gabriel laissait fleurir les hypothèses les plus démentes. Orphelin depuis l’âge de cinq ans, élevé par un oncle et une tante fanatiquement discrets, il n’avait jamais eu l’habitude de rendre compte de ses faits et gestesNote923. .
Le principe de la série oblige bien sûr les auteurs à le maintenir en vie, et de ce fait, il sort toujours sans encombre de périlleuses aventures. Mais ses caractéristiques héroïques viennent de sa capacité presque infaillible à anticiper et à adapter ses stratégies, y compris dans l’affrontement physique :
Il était maintenant sûr que, dans ces deux bagnoles, il y avait des gens pour lui, pensant à lui. En tout cas, il était prêt, le Beretta patientait sur le siège avant, coincé sous la mallette. (…) Tout était simple. En réalité rien ne se passait vraiment comme dans les films avec tir au pigeon et carambolage artistique. Il fallait simplement être très sûr de tout ce qu’on faisaitNote924. .
On pourrait voir là une simple ressemblance avec le tough guy du roman hardboiled américain. Pourtant, comme le fait remarquer Mireille Piarotas, « le Poulpe n’est pas vraiment un « privé », même simple amateur, mais bien plutôt un justicierNote925. ». Il est proche du Surhomme défini par Umberto Eco, à la suite de Gramsci, comme « un personnage aux qualités exceptionnelles qui dévoile les injustices du monde et tente de les réparer par des actes de réparation privéeNote926. ». Là réside une spécificité du personnage, qui le rapproche davantage des romans populaires que du roman noir des années 1990-2000. Certes, la bible précise qu’il n’est « ni un vengeur ni le représentant d’une morale quelconque ». Pourtant, il agit au nom d’une morale, d’une éthique. Jean-Bernard Pouy le souligne lui-même, dans L’Humanité dimanche :
Simplement quelqu’un qui contrebalançait la vacherie du monde en tatanant quelques indélicats, en remettant les salauds sur le chemin de la rédemption, en expérimentant une technique toute personnelle de reprise individuelleNote927. .
Il relève ainsi de ce que Daniel Couégnas appelle la « sphère du Vengeur ». Il est en effet le « personnage le plus approfondi, le plus présent, le plus autonome, le plus actif et le plus efficace dans le récit », et « il assume sans équivoque et au plus haut point les valeurs « positives ». » Ainsi, « l’extrême bonté/intelligence/énergie du Vengeur est à la mesure du scandale extrême qu’il doit faire cesserNote928. », même si, dans le cas du Poulpe, le scandale ne cesse que provisoirement, la lutte contre les fascistes et corrompus de toutes sortes étant à recommencer à chaque épisode. Il rend justice lui-même, en tuant – rarement –, en acculant au suicide les « méchants », en faisant pression de manière à ce que les victimes obtiennent réparation, en rassemblant des pièces qui mettent les coupables hors d’état de nuire, ou en les menaçant de mort, comme à la fin de Arrêtez le carrelage :
Ecoute-moi bien, maintenant. Je veux Kerletu mais je le veux comme il est. Le Polygone n’est plus à vendre, la Kerlinvest est dissoute et tu vas sagement faire ton boulot en attendant le prochain remaniement ministériel. Tu peux même garder les photos. Je ne fais chanter personne mais je peux tuer avec une grande facilité. Je vais confier l’autre jeu à un officier irréprochable, quelqu’un dont les pourris de ton acabit ne peuvent même pas soupçonner l’existence. Ça, c’est pour te limer un peu les dents mais ta véritable épée de Damoclès, c’est moi. Donne-moi une seule raison de te flinguer et t’es mortNote929. .
En outre, la structure même des aventures du Poulpe est sensiblement différente de celle de nombre de romans noirs. Alors que le genre mène souvent les personnages à la mort ou à la souffrance, « le Poulpe » propose un retour à l’ordre, même provisoire, dans la mesure où le personnage résout l’affaire qui a attiré son attention en dévoilant la vérité, et où pour lui-même, il y a retour au point de départ. Les romans se terminent généralement sur le retour au bar de Gérard, dans les bras de Cheryl, ou à l’aérodrome où il répare son avion. La structure est donc circulaire, remet le personnage en sa place initiale, prêt à repartir pour de nouvelles aventures.
Enfin, nous avons vu dans un chapitre précédent que le Poulpe est une exception dans le corpus, en ce qu’il relève, en tant que projet, du roman à thèse à structure antagonique.
Il ne s’agit pas de remettre en question l’appartenance du « Poulpe » au roman noir. Cette collection est clairement liée au genre par sa visée sociale et réaliste, et par une vision qui reste très sombre en dépit des victoires du personnage. Néanmoins, elle constitue un cas atypique dans le corpus, à cause de cette inflexion générique constitutive du projet même – un projet militant – vers le roman populaire d’aventures tel qu’il se développe à partir du 19ème siècle. À ce titre, « le Poulpe » représente une forme d’hybridité générique.
4.2.2. Maurice G.Dantec : d’un projet réaliste à une écriture épique.
Maurice G. Dantec, dès la parution de La Sirène rouge en 1993, est perçu comme un jeune auteur atypique dans le paysage du roman noir, un rebelle littéraire qui refuse les conventions génériques et les ghettos paralittéraires. Mais au fil des romans, il est également vu comme un prophète, littéraire et politique, dont les romans expriment de manière angoissée et violente les soubresauts d’un monde à l’agonie, le monde occidentalNote930. . Une analyse des romans de Dantec et de sa posture de romancier avait montré une inflation de discours commentatif, allant jusqu’à la publication du Théâtre des opérations, commentaires en forme de journal sur la littérature, mais aussi sur les mutations géopolitiques de l’Europe et du monde occidental. Dès Les Racines du Mal, il fait exploser le genre du roman noir, le mêlant à la littérature d’anticipation, désarçonnant les critiques par l’hybridité générique de ses œuvres. Dantec acquiert une grande visibilité médiatique du fait même de cette capacité à mêler les genres et à renouveler le roman noir. On convoque à son sujet de multiples étiquettes génériques, le qualifiant de visionnaire, de prophète littéraire, et ses romans, alors même qu’ils sont publiés dans des collections policières, font l’objet de critiques dans les pages des quotidiens et hebdomadaires généralistes, comme Libération, Le Monde, L’Humanité, Le Nouvel Observateur, Le Point, Les Inrockuptibles (dont il fait la couverture pour la parution de Babylon Babies), sans parler des magazines littéraires, qui associent souvent Dantec à Houellebecq, lequel partagerait sa conception prophétique de la littératureNote931. . Pourtant, Dantec se distingue par un recours à une écriture où affleure, à côté du registre tragique, le registre épique. Rappelons que le registre épique, selon Alain Viala, est lié au « sentiment de la merveille, de ce qui dépasse l’humain en grandeurNote932. ». Le Dictionnaire du Littéraire précise par ailleurs qu’il est caractérisé par « une vision du monde où les héros exceptionnels décident du sort des groupes qu’ils représentent, ou l’intervention de forces irrationnelles et surhumaines (le destin, le sort)Note933. . »
Le personnage récurrent de La Sirène rouge et des Racines du Mal (présent également dans Babylon Babies), Toorop, est un héros épique. Mercenaire pro-bosniaque, tueur à gages, il agit seul et a des facultés et des capacités d’analyse hors du commun, qui en font un surhomme combattant le Mal sous diverses formes. Il est certes aidé par des armes, des accessoires de haute technologie, ainsi que par des substances psycho-actives. Mais si ces adjuvants sont le fruit de recherches technologiques et scientifiques tout à fait rationnelles, ils n’en sont pas moins à la limite du surnaturel, tant ils semblent le rendre invincible. En outre, tout mercenaire qu’il soit, Toorop obéit à des valeurs fondamentales, celles de héros globalement positifs, notamment la protection des faibles et des orphelins. Ainsi, dans La Sirène rouge, il prend sous sa protection la petite Alice, alors qu’il ne peut en retirer aucun bénéfice matériel et que cela représente même une perte de temps pour lui. Très rapidement, il montre sa capacité à analyser une situation dangereuse et à réagir de manière appropriée :
Toorop n’eut besoin que d’un bref coup d’œil pour jauger l’ensemble de la situation. Il fit aussitôt semblant de poser son regard ailleurs, tout en les gardant à la périphérie de sa vision. (…) Il sut très exactement quoi faire. (…)
-Dis-moi, Alice, as-tu ce qu’on appelle du sang-froid ? Alice le regarda sans comprendre. Toujours calme et souriant et après avoir lampé une dernière goutte de Tuborg, Hugo lui souffla, bien nettement :
-Voilà, tu vas faire très exactement ce que je vais te dire, d’accord ? Sa voix était d’une intensité magnétique et Alice opina du chef, hypnotiséeNote934. .
Toorop combat, comme Darquandier dans Les Racines du Mal, des forces aussi mauvaises que puissantes. La lutte est par conséquent très difficile, mais d’autant plus valorisante. L’univers de Dantec est manichéen, et propose une vision morale de la société : le monde est en état de crise, au bord du chaos, en proie à une mutation terrible. Les figures de meurtriers sont bien plus que des personnages-types du roman noir, ce sont des figures archétypiques du Mal, ayant le visage de la modernité : psychopathes, mafieux, tueurs en série. Dans cet univers manichéen, les forces du Mal sont anéanties, au moins partiellement, et les meurtriers connaissent des morts symboliques, évoquant le châtiment et la rédemption : Schaltzmann, le terrifiant tueur psychopathe des Racines du Mal, s’immole par le feu, la mère d’Alice est à la fois déchiquetée par une grenade et engloutie par les eaux, Darquandier fait brûler Granada :
Et je lui ai envoyé la bouteille en la faisant tournoyer de telle façon qu’elle retombe pile à ses pieds. Un geste d’une simplicité effrayante. Je l’ai effectué sans l’ombre d’un remords, aucune émotion, comme dans un rêve délicieusement plat. (…) Granada s’est instantanément transformé en une torche vivante, hurlante et tournoyante, toupie de feu humaine devenue folle, derviche incendiaire et pathétique. Il tourbillonnait au centre d’une colonne de feu qui s’évasait sur l’herbe rase, alentour. Il a poussé un horrible hurlement en mettant les mains à son visage. Mais toutes les parties de son corps brûlaient. Il a tournoyé comme un robot détraqué, s’extirpant du foyer en suivant un parcours erratique, une plainte prolongée sortait de sa bouche, trou noir et bleu sous une peau de flammes orange. Il a foncé vers moi, dans un ultime réflexe kamikaze. J’ai vu venir une sorte de bélier humain, couronné de feuNote935. .
Le registre épique n’est toutefois pas dominant dans les romans de Dantec, mais dont la coloration est d’abord tragique. Darquandier est ainsi un personnage tragique, qui ne peut être certain d’avoir agi à bon escient, et qui ne peut a contrario trouver aucune consolation dans son acte meurtrier final :
Une idée s’entortillait dans mon cerveau, insidieusement. Quel qu’ait été le sort de la fille et de sa mère, j’avais quand même perdu. Si, dans le meilleur des cas, elles avaient survécu, cela signifiait que j’avais tué Granada de sang-froid, sans plus aucune excuse valable. Dans le plus mauvais scénario, ça signifiait que je n’avais pu empêcher leur sacrifice, en dépit de tous mes efforts.
Les Joueurs étaient peut-être morts, mais sûrement pas le Jeu. Et si les disciples des années précédentes n’étaient pas en service cette nuit-là, ça ne pouvait signifier qu’une chose : ils étaient en service, mais ailleurs. (…) Le monde s’est effondré autour de moi, dans le plus total silence. (…) Quel sens pouvais-je donner à tout cela ? À quoi avait servi mon intervention, sinon à amplifier le chaosNote936. ?
Les deux premiers romans de Dantec sont donc des romans noirs, mais la visée réaliste s’exprime par une vision à la fois tragique et épique du monde. Plus qu’un cas-limite, Maurice G.Dantec est un cas atypique, qui illustre toute la complexité de l’évolution générique du roman noir, œuvre tragique teintée de registre épique, dans laquelle le noir peut se mêler à la spéculation science-fictionnelle.
4.2.3. Le réenchantement du monde : Daniel Pennac et Fred Vargas.
Daniel Pennac apparaissait dans le tableau comme un cas-limite, puisque les deux romans présents dans le corpus, Monsieur Malaussène et Aux fruits de la passion, activent fort peu le trait générique du tragique. Cela n’est d’ailleurs pas surprenant, car dès la publication du précédent volume de la saga Malaussène, La Petite marchande de prose, Daniel Pennac était sorti des collections policières pour trouver place dans la collection générale, la « blanche », de Gallimard. Cela ne correspondait pas seulement à une migration éditoriale, mais à un réel infléchissement générique, les romans ainsi publiés proposant une vision beaucoup moins sombre et noire de la société. L’auteur accentue en outre une spécificité de son écriture, qui s’exprimait déjà dans les premiers romans, et qui correspond à un réenchantement du réel là où le roman noir s’emploie généralement à le démystifier et à proposer un regard désenchanté. Si l’univers diégétique est globalement réaliste, si les événements relatés sont violents, les personnages et le narrateur expriment une vision du monde optimiste, une joie de vivre. Le récit poétise le réel, introduisant dans l’univers diégétique des situations extraordinaires et des personnages hors du commun ayant le pouvoir d’embellir la vie de leurs proches. C’est un univers proche du merveilleux en ce qu’il poétise le cadre par ailleurs réaliste, et y introduit des phénomènes qui semblent à la limite du surnaturel par les effets qu’ils produisent et les sentiments qu’ils procurent aux personnages. Plusieurs procédés peuvent être observés dans les deux romans du corpus. Monsieur Malaussène adopte clairement le système narratif et énonciatif du conte, puisque le narrateur, Benjamin Malaussène, s’adresse tour à tour directement à son futur enfant et au lecteur selon une posture de conteur, comme en témoignent les extraits suivants :
Et ta future grand-mère apparut sur le seuil. Celle-là aussi, il faut que je te la présente. Elle a le cœur immédiat et l’entraille généreuse, ta future grand-mère. Benjamin-moi-même, Louna, Thérèse, Jérémy, le Petit, Verdun, nous sommes tous de la tribu Malaussène, sommes tous fruits de ses entrailles. Même Julius le Chien a pour elle des regards de puîné. Qu’est-ce que tu dis de ça, toi qui es le produit d’une longue interrogation procréatoire : « Faut-il faire des enfants dans le monde où nous sommes ?(…) »
Non, non, non, pas un mot sur mon procès. Reportez-vous à votre journal habituelNote937. .
Certains personnages sont dotés d’un nom et d’un prénom, mais nombre d’entre eux sont désignés par un surnom, lié le plus souvent à l’une de leurs caractéristiques ou aptitudes physiques ou psychologiques, ce qui accroît l’impression de distanciation avec les contraintes réalistes. Ainsi, les plus jeunes membres de la tribu Malaussène se nomment Le Petit, Verdun et C’est un Ange. L’éditrice qui emploie Benjamin comme bouc émissaire littéraire n’est désignée que sous le surnom de la Reine Zabo, tandis que le cocaïnomane Cissou est logiquement surnommé Cissou la neige.
L’univers de Pennac est enchanté en ce qu’il constitue parfois une négation des règles sociales généralement décrites par le roman noir – sous le signe de la violence interindividuelle. En effet, s’il n’est pas dépourvu de violence, il oppose à celle-ci des valeurs communautaires fortes, idéalisant le quartier de Belleville vu comme une gigantesque communauté défiant tous les particularismes ethniques, dans une communion et un partage de valeurs telles que l’entraide, la solidarité, la convivialité, et la disposition anti-institutionnelle. Ces valeurs s’expriment notamment dans l’épisode d’ouverture de Monsieur Malaussène, où la communauté bellevilloise exerce une réparation toute personnelle au déni de justice que constitue dans cet univers la saisie des biens d’une famille pauvre ; pour l’occasion, les habitants de Belleville se liguent pour organiser une farce dont les huissiers de justice font les frais. En effet, ceux-ci découvrent un enfant crucifié sur la porte de l’appartement, et des milliers de couches-culottes usagées à l’intérieur. Cette mise en scène est le fruit d’une résistance organisée par Cissou et la Tribu, avec l’aide des habitants de Belleville :
L’heure est à la rigolade. Et, comme toujours dans ces moments-là, la suite, c’est l’évocation du commencement : le désespoir d’Amar et de Yasmina débarquant la semaine dernière à la maison avec le papier de l’huissier, la résistance aussitôt proposée par Cissou, la mise en scène imaginée dans la foulée par Jérémy, l’entraînement du Petit qui en a encore les pieds cambrés, tous les après-midi, sur la scène du Zèbre (…), le choix des accessoires dans la mémoire cinématographique de Suzanne O’Zyeux bleus, la composition de la bouillie humaine due au génie culinaire de Yasmina et de Clara, le doute, les exhortations à l’optimisme (…)Note938. .
Un événement a priori révélateur de la misère d’une famille est donc converti en farce, en « rigolade », par la complicité dont font preuve les habitants de Belleville dans l’adversité. Ainsi, il y a immédiatement réparation et consolation, comme dans la suite du roman, où les meubles saisis sont replacés la nuit même :
Et on attaquait l’immeuble suivant. Et le jour passait. Et la nuit revenait. Et Graine d’Huissier reprenait le collier. Il s’agissait de remettre chaque meuble à sa place. Le frigo de Selim dans la cuisine de Selim, la vaisselle d’Idris entre les mains d’Idris. Que Belleville redevienne BellevilleNote939. .
Cette communauté bellevilloise se retrouve, dépassant tous les particularismes ethniques et religieux, autour de la fédératrice Tribu Malaussène :
D’autres fois nous remontions la rue Ramponneau où le nouveau Belleville, mort-né dans son architecture autiste, fait face à Belleville l’ancien, grouillant de sa vie gueularde, des mamas juives saluant Thérèse, leur cul somptueux débordant de leurs chaises, la remerciant de ce que grâce à elle « ça » s’était arrangé, nous invitant à partager leur thé ou à emporter des pignons et de la menthe pour le faire à la maison (…), ou nous grimpions la rue de Belleville jusqu’au métro Pyrénées, longue traversée de la Chine, et là encore reconnaissance éternelle à Thérèse, beignets de crevettes, bouteilles de nuoc-mâm, « Yao buyao fan, Thérèse ? (Tu veux du riz, Thérèse ?) tsi ! tsi !, emborte, tas me fait plaisir », et galettes turques chez les Turcs et la bouteille de raki en prime (…).
C’était une soirée douce. Amar, Hadouch, Mo et Simon avaient installé la télé du Koutoubia dans un arbre du boulevard et disposé chaises et table tout autour, sur le trottoir et la contre-allée. Tout Belleville s’était pointé. Les invités et les autres. Un fumet syncrétique de canard laqué et de mouton rôti liait ce monde dans un même parfum de coriandreNote940. .
Non seulement les situations irréalistes abondent – la reine Zabo propose ainsi à Malaussène de prendre un congé « maternité » de neuf mois à plein salaire, Malaussène est emprisonné dans un établissement pénitentiaire où la télévision est utilisée comme moyen d’infliger pénitence aux prisonniers – mais le merveilleux affleure, dans un univers où les phénomènes à connotation religieuse sont légion, à peine teintés d’une distanciation amusée. Le personnage de Clément, apparu dans Monsieur Malaussène, est en proie à une véritable révélation, produite par la pourtant farcesque crucifixion du Petit :
Et lui qui était si muet, si tellement terrorisé, voilà qu’il se lance dans un monologue vitesse grand V, comme quoi la vision de Petit déboulant cul nu dans l’escalier lui a fait opérer un virage existentiel à 180 degrés, que depuis cette révélation digne d’un pilier claudélien il n’est plus ce qu’il était, ou l’est enfin devenu, c’est selon, bref qu’il a rendu son bavoir à sa famille et son veston à son patron, que tout ce qu’il veut dans la vie dorénavant c’est vivre à Belleville et faire du cinéma, rien que du cinéma, toujours du cinémaNote941. …
De même, le fantôme de Stojil apparaît à Benjamin dans la prison où il est incarcéré, et où il occupe la même cellule que celle où l’oncle Stojil a fini sa vie. Certains personnages sont dotés de pouvoirs surnaturels, comme Thérèse, sœur de Benjamin, douée du pouvoir de prédire l’avenir par divers moyens divinatoires, ou comme Julius le Chien, dont les crises d’épilepsie sont prémonitoires de quelque malheur :
Mais l’épilepsie n’avait jamais choisi le bon moment chez Julius. Et ce qu’il était en train de me faire là, accroupi sous cette affiche de malheur, œil visionnaire, babines retroussées, crocs de vampires, langue de Guernica, longue plainte montante, c’était bel et bien une crise d’épilepsie ! Et son hurlement a très vite couvert les conversations de Belleville, et je me suis précipité au moment où il roulait sur le côté, hurlant toujours dans la même position, et j’ai saisi sa langue avant qu’il ne l’avale, et son hurlement a cessé tout soudain, mais l’atroce urgence que j’ai lue dans ces yeux, cette supplication hallucinée, qu’est-ce qu’il y a ? qu’est-ce qu’il y a ? qu’est-ce que tu vois, JuliusNote942. ?
Enfin, il faut noter que les romans de Daniel Pennac ont une fin heureuse, les événements tragiques eux-mêmes étant affectés d’éléments positifs dans ces deux textes. En effet, les coupables de Monsieur Malaussène, qui sont amants, meurent ensemble après un dernier instant de passion, « embrassés comme une allégorie de l’AmourNote943. », tandis que Gervaise met au monde son enfant. Le mari malhonnête et criminel de Thérèse, dans Aux fruits de la passion, meurt dans un éclat de rire inopiné, « d’un rire à ce point renversant qu’il en tombe à la renverse, justementNote944. », tandis que son argent est subrepticement confisqué au profit du jardin d’enfants associatif de Gervaise.
C’est un trait que partagent les romans de Fred Vargas, dont l’univers romanesque, quoique très différent de celui de Daniel Pennac, opère également un réenchantement d’un réel par ailleurs violent. La construction des intrigues des six romans présents dans le corpus les apparente largement au roman d’énigme. L’enjeu est en effet toujours d’identifier et de mettre hors d’état de nuire un meurtrier, et les romans se terminent toujours sur la solution du mystère, sans que subsistent des zones d’ombre. Il pourrait sembler tentant d’exclure Fred Vargas du corpus, car son univers est peu marqué par la visée réaliste et sociale, et l’est moyennement par le registre tragique, présent sans jamais dominer le récit. Pourtant, Fred Vargas est l’une des figures emblématiques du roman noir français, à la fois très implantée dans les réseaux de sociabilité du milieu « polar », et très médiatisée, grâce à un succès qui ne cesse de croître au cours des années 1990-2000. En dépit de sa discrétion, sa visibilité médiatique est au moins aussi importante que celle d’un Dantec ou d’un Pennac. Nous choisissons de garder les romans de Fred Vargas dans le corpus, parce qu’il nous semble qu’ils actualisent, même modérément, des traits génériques du roman noir. L’univers de Fred Vargas est marqué par le Mal, et ce mal est social : les personnages ne tuent pas parce qu’ils sont mauvais, ils tuent parce que leur famille, leur milieu professionnel les ont privés de la reconnaissance à laquelle ils estimaient avoir droit, parce que les rapports inter-individuels sont tissés de violence sourde. C’est aussi un univers dur pour les personnages récurrents. On a vu précédemment qu’Adamsberg avait des traits de personnage tragique, notamment dans ses relations chaotiques avec Camille. Les trois chercheurs, Marc, Mathias et Lucien, sont en proie à une misère économique à laquelle les condamne leur passion pour la recherche, et si l’auteur convertit leur pauvreté en ascèse aux accents poétiques, il n’en reste pas moins que ces personnages semblent sans avenir.
Le personnel romanesque de Fred Vargas pourrait à cet égard correspondre au personnel dégradé du roman noir. Cependant, en dotant ses personnages de traits et de capacités qui sortent de l’ordinaire, d’une forme de satisfaction face à leur condition, elle crée un univers poétique et décalé, ce qui compense l’angoisse née du tragique. Comme chez Pennac, c’est l’univers du mythe et du religieux qui affleure sans cesse, notamment par les dénominations ou l’histoire des personnages. Marc, Mathias et Lucien sont rebaptisés les trois évangélistes, Mathias devenant Matthieu et Lucien devenant Luc. Soliman, dans L’Homme à l’envers, a un destin extraordinaire d’enfant trouvé, ayant reconnu en Suzanne une mère d’adoption indiscutable :
Le jeune Africain avait été, comme dans les contes, déposé tout bébé dans un panier à figues devant la porte de l’église. (…) À l’aube de ce jour, la moitié du village tournait, éperdue, autour du panier et de l’enfant tout noir. Puis des bras de femmes, au départ réticents, s’étaient tendus pour le soulever, puis le bercer, tenter de l’apaiser. (…) Mais rien ne calmait le petit qui s’étranglait dans ses hurlements. (…) Puis la massive Suzanne s’était approchée d’un pas d’athlète, avait rompu les rangs, attrapé le petit et l’avait calé sur son bras. L’enfant avait cessé sur l’instant de hurler et laissé sa tête sur sa grosse poitrineNote945. .
D’autres personnages ont une identité floue, indéterminée, comme le Veilleux, dans L’Homme à l’envers, que l’on ne connaît pas sous un autre nom, ou Louis, dans Un peu plus loin sur la droite, au passé et aux fonctions mystérieuses :
Quand Sonia avait donné les premiers signes de départ, il avait été tenté de raconter, de dire ce qu’il avait fait, dans les ministères, dans les rues, dans les cours de justice, dans les cafés, les campagnes, les bureaux de flics. Vingt-cinq ans de déminage, il appelait ça, de traque aux hommes de pierre et aux pensées pestilentielles. Vingt-cinq ans de vigilance, et trop d’hommes rencontrés au cerveau rocailleux, rôdant en solitaire, oeuvrant en groupe, hurlant en horde, mêmes rocailles aux têtes et mêmes tueries aux mains, merdeNote946. .
Soliman, l’enfant trouvé, est doté d’une mémoire extraordinaire qui lui a permis de retenir les définitions du dictionnaire, qu’il aime à réciter :
« Amour », annonça Soliman, appuyé au vantail du camion, les mains posées sur les hanches. « Affection vive pour quelqu’un ou pour quelque chose. Penchant dicté par les lois de la nature. Sentiment passionné pour une personne de l’autre sexe. » Camille se tourna vers Soliman, un peu déconcertée.
-C’est le dictionnaire, expliqua Buteil. Il a tout là-dedans, ajouta-t-il en montrant son frontNote947. .
Adamsberg lui-même est un personnage atypique dans le roman noir, il n’a rien d’un « tough guy », et se caractérise par un fonctionnement intellectuel étonnant pour son adjoint lui-même :
C’est ainsi qu’Adamsberg cherchait des idées : il les attendait, tout simplement. Quand l’une d’elles venait surnager sous ses yeux, tel un poisson mort remontant sur la crête des eaux, il la ramassait et l’examinait, voir s’il avait besoin de cet article en ce moment, voir si ça présentait de l’intérêt. Adamsberg ne réfléchissait jamais, il se contentait de rêver, puis de trier la récolte, comme on voit ces pêcheurs à l’épuisette fouiller d’une main lourde dans le fond de leur filet, cherchant des doigts la crevette au milieu des cailloux, des algues, des coquillages et du sable. (…) Il avait remarqué qu’entre ses pensées et celles de son adjoint Danglard existait la même différence qu’entre ce fond d’épuisette plein de fatras et l’étal ordonné d’un poissonnierNote948. .
Contemplatif et rêveur, il est très intuitif, ce qui lui permet d’être un excellent enquêteur.
Ces différents éléments ne sont pas dus au hasard, mais découlent directement de la fonction que Fred Vargas assigne au roman policier et à l’ensemble de la littérature :
J’aime bien me raconter des histoires. Et, dans ces histoires, arrivent souvent des idées un peu « légendaires », comme dans les contes, tels ce loup-garou ou cette peste. (…) Je crois que la littérature nous aide à construire et surtout à reconstruire la vie, en réinjectant sans cesse des éléments de fiction nécessaires à notre réelNote949. .
Elle reconnaît ainsi la part d’irréel que comporte son univers, nécessité imposée selon elle par la catharsis :
J’adore le ressort du roman policier : anxiété-soulagement. À mon sens, c’est la littérature la plus archaïque du monde, celle qui donnera les contes et les mythes. On a peur : de l’assassin, du Minotaure, du dragon… Un héros surgit du néant, qui dénoue la situation, au prix d’un travail quasi irréel. C’est le principe du mythe : identifier, nommer les dangers qui gravitent autour de l’homme, et les annihiler en les comprenant, pour un temps. Le roman policier n’est pas le lieu de l’émotion esthétique, c’est celui de l’émotion vitale, de la catharsisNote950. .
Là réside une différence essentielle avec le roman noir tel que nous l’avons analysé, ce qu’elle formule d’ailleurs ainsi :
Mais je ne peux pas écrire des romans noirs, où tout finit par une grisaille qui rend triste, angoissé pour huit jours. Je ne peux me résoudre à laisser mon lecteur dans le pétrin, ou peut-être est-ce moi que je ne veux pas laisser toute seule. Je vais jusqu’au bout de la catharsis, c’est plus fort que moiNote951. .
Ainsi, Fred Vargas représente un cas-limite du roman noir, qui emprunte largement au roman d’énigme.
Somme toute, peu de romans sont finalement exclus du corpus, après examen de l’actualisation des deux traits jugés définitoires. L’hybridité générique n’est pas nécessairement un facteur d’exclusion, comme nous l’avons vu. En outre, certains romans superposent à ces traits génériques des particularités qui en font des œuvres atypiques, voire des cas-limites lorsque sont remis en cause, même partiellement, le réalisme ou le tragique.
Il est certain en tout cas que le genre du roman noir ne saurait se définir par la présence fermement déterminée de certains traits textuels, formels, mais peut l’être par l’actualisation à des degrés divers de deux traits articulés et complémentaires, la visée réaliste et sociale et le registre tragique. Ces deux traits s’expriment par des procédés variés, mais permettent de saisir le corpus dans son unité, dans sa cohérence. Ainsi, le roman noir se définirait avant tout par ce que Wittgenstein appelle « l’air de famille ». En comparant ces divers objets textuels que sont les romans du corpus, on ne trouve pas un ensemble de propriétés communes, nécessaires et suffisantes pour dégager la définition définitive du genre « roman noir ». On trouve dans ces textes « un réseau compliqué de ressemblances superposées et entrecroiséesNote952. », et donc l’entrecroisement seul, tel qu’il est réalisé par une œuvre singulière, permet de définir le roman comme roman noir. C’est pourquoi sont réunies sous l’étiquette « roman noir » un ensemble d’œuvres qui peuvent sembler à première vue très disparates, mais qui trouvent leur ressemblance dans un projet commun (réaliste et social) et une même expression (tragique).